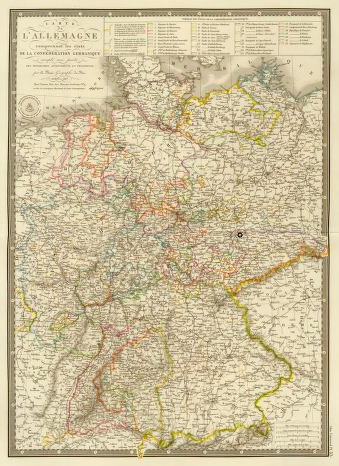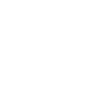
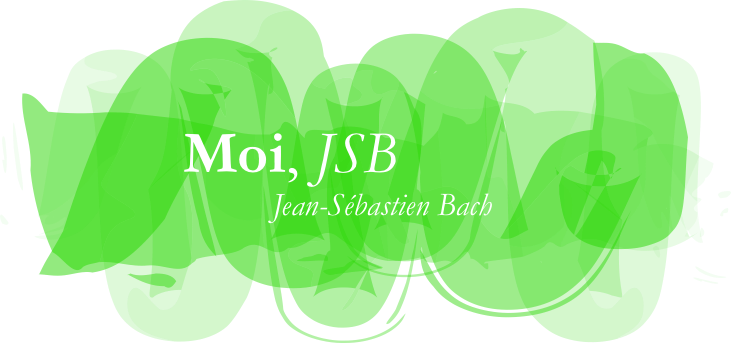
Leipzig (1723-1730)
Ainsi, la voie était toute tracée. J’allai pouvoir faire ici ce dont j’avais rêvé depuis toujours à Arnstadt, à Mülhausen, à Weimar : exécuter à la gloire de Dieu pour chaque dimanche et chaque fête de l’année une musique d’église régulière et selon les nouveaux genres musicaux. Pour cela avec les élèves, je devais faire comme Bauer à Lünebourg: atteindre un bon niveau de qualité et surtout éviter ce qui s’était passé à Arnstadt où, on s’en souvient, le niveau, malgré mes efforts, était resté détestable.
Je décidai donc de consacrer les premières semaines à la formation des élèves en reprenant et en adaptant d’anciennes musiques d’église que j’avais composées à Weimar.
Toutefois à la fin du mois de juin de cette année 1723, un mois à peine après mon intronisation, la mort de la femme du directeur de l’école Saint Nicolas vint contrecarrer mes plans. Il était de tradition de faire pour les personnages importants une cérémonie du souvenir, au cours de laquelle le chœur chantait à plusieurs voix, soit avec des instruments pour doubler certaines voix, soit sans instrument.
J’avais à peine quinze jours pour élaborer une œuvre de ce type, qu’on appelait un motet. Je connaissais bien cette forme de musique : on en chantait à tous les offices. Je n’en avais jamais composé qui soit vraiment achevé et dans le style que je souhaitais. Je me mis à la tâche en reprenant d’anciennes ébauches et ce fut passionnant. À chaque fois que je composais un motet, je me plongeais, je m’immergeais dans la conception de ces œuvres qui comportaient jusqu’à huit voix superposées, chacune suivant sa courbe, l’ensemble formant un tout dont la complexité envahissait totalement mon esprit. Je pouvais rester ainsi des heures dans cet état de création. Gare à celui ou à celle, fusse ma chère Anne, qui s’avisait alors de m’interrompre en entrant dans mon bureau. Rarement ai-je éprouvé le sentiment aussi fort d’entrevoir ce que peut être la perfection divine : je pensais dans ces instants me rapprocher de sommets inaccessibles.
Les répétitions de ce premier motet furent assez laborieuses. Même pour les meilleurs élèves, c’était un exercice difficile mais salutaire. Je pus ainsi leur faire comprendre ce qu’est une vraie discipline musicale. Il se trouve que j’avais alors un premier chœur formé d’élèves dont la plupart étaient assez doués. En les faisant travailler, j’obtins à peu près ce que je voulais. La cérémonie fut un succès et je fus chaleureusement remercié.
Dès la fin du mois de juillet de cette année 1723, je pus recommencer à composer une série de musiques religieuses avec chœur, récits chantés et airs variés ou cantates pour chaque dimanche de l’année. Je voulais absolument tenir ma promesse de donner une nouvelle musique ou un nouveau concert d’église chaque semaine. Je travaillais avec joie et ferveur à la plus grande gloire de Dieu par ma musique !
Je conçus des musiques totalement nouvelles.
Ainsi, pendant cette première période à Leipzig, selon mon inspiration, parfois je supprimai toute référence à des thèmes de chorals dans les chœurs et les airs. Parfois au contraire le thème d’un choral m’inspirait particulièrement 𝄐.
Je voulais surtout affranchir mes musiques d’habitudes du passé et y mettre plus de profondeur.
***
Ardeur et Joie.
Ardeur à chercher et à combiner des textes de la Bible et de Luther bien sûr, mais aussi, selon l’office et le sermon du jour, des écrits religieux récents incitant les fidèles à la réflexion sur le péché, la vanité du monde, le salut par le seul Christ et bien d’autres aspects de notre religion. Je choisissais ces textes avec l’accord des pasteurs : l’accord du pasteur de l’église Thomas, Christian Weiss, m’était toujours acquis ! Il était d’autant plus ravi de discuter avec moi que depuis plusieurs années le Seigneur l’avait privé de l’usage de la voix ce qui l’empêchait de faire des sermons ! Il ne pouvait parler qu’avec une voix basse et rauque. Son second, l’archidiacre était le frère de Régine Ernesti qui venait souvent nous voir. Avant leur publication, Salomo Deyling, le superintendant, exigeait lui aussi un contrôle de ces textes. Je veillais à ce que des copies en soient distribués aux fidèles plusieurs semaines avant le jour où la musique était jouée. Il est impossible de comprendre ma musique d’église sans lire en même temps les textes !
Joie de composer des musiques qui me venaient souvent à l’esprit comme des évidences. Mais c’était là le fruit d’un travail acharné et d’une réflexion incessante, menés depuis plus de 30 ans, avec l’aide de Dieu, de mes élèves, de ma famille et des instrumentistes.
Il arrivair que ma musique exprime (faut-il l’avouer ?) mes propres sentiments. Alors elle devenait ma confidente et traduisait ma tendresse, ma lassitude, mes soucis, mes colères, la maladie, le sommeil, l’amour, le désir de la mort… Je pensais être alors le seul à exprimer en musique mes propres émotions. Les musiques des autres me faisaient l’effet de descriptions de sentiments venus d’ailleurs plus que du fond d’eux-mêmes.
Joie, dans les chœurs en particulier, de faire surgir des harmonies, des constructions, des architectures, des thèmes, des chiffres, des correspondances, des symboles, des alternances que je n’avais entendu jusque là chez aucun autre musicien, puis de les mettre ensuite sur le papier : ils exprimaient la splendeur de Dieu et la misère des hommes.
Joie, dans les arias, d’utiliser souvent des formes de musique à la mode, en introduisant par exemple des rythmes de danse, ce qui me permettait d’exprimer une mélancolie, une gaieté, bref une joie de vivre pour la gloire du Seigneur bien dans l’esprit de Martin Luther.
Joie de donner aux récits chantés une expression musicale parfois un peu… théâtrale (mais oui !) par des descriptions instrumentales (le rire, le vent, le temps, la cloche de mon enfance, l’orage…).
Je demanderai au lecteur avant de poursuivre sa lecture d’écouter les musiques d’église que je jouai en 1723 et 1724. Il comprendra mieux qu’avec tous les mots du monde toute mon ardeur créatrice pendant cette période. J’avais l’impression que tous ceux que j’aimais et qui travaillaient auprès de moi y participaient et l’appréciaient, même si leur talent parfois était loin d’être parfait.
***
Dès le mois d’août 1723, j’eus l’occasion de composer par deux fois de grandes musiques officielles. La première fut chantée en latin à l’université au début du mois pour l’anniversaire d’un prince, l’autre le 24 août, le jour de la saint Barthélémy, qui était celui de l’élection du conseil municipal : cette année là Monsieur Steger succédait à Monsieur Lange comme Bourgmestre, qui avait contribué à mon élection comme Cantor.
Ces musiques avec chœurs et trompettes me valurent des félicitations de toutes parts : tout le monde aimait beaucoup cela, mais ce n’était pas le genre de musique que je préférais composer.
***
Avant de raconter les soucis que j’eus en cette fin de 1723, je voudrais parler de ma rencontre avec un personnage dont je ne savais pas qu’il allait plus tard tenir une grande place dans ma vie de compositeur de musique chantée, aussi bien pour l’église que pour les fêtes et anniversaires profanes.
Un dimanche du mois d’août, je crois, comme je m’apprêtai à quitter l’église avec mes fils après l’office, je vis s’avancer vers moi un jeune homme d’une vingtaine d’années, plein de déférence :
– Monsieur le Cantor, je ne veux surtout pas vous déranger, vous connaissez peut-être mon nom et peut-être avez-vous lu…
– Que puis-je pour votre service, monsieur… monsieur
– Mon nom est Henrici, Chrétien Frédéric Henrici, cela vous dit quelque chose ?
– À vrai dire, non… vous êtes italien ?
– Non, non pas du tout. Je suis né près de Meissen.
Que me voulait donc ce jeune homme, à me raconter ainsi sa vie ? Il y eût un silence. Mes deux garçons jetaient des regards furtifs et moqueurs sur cet homme qu’ils ne connaissaient pas. Il nous regarda encore puis, comme s’il se jetait à l’eau, il dit d’un ton rapide :
– Voilà… monsieur Bach… j’ai entendu vos œuvres… j’ai… j’ai… lu les livrets des textes des musiques d’église qui sont distribués aux fidèles, j’ai, enfin, je… moi-même j’écris aussi des textes.
– Ah oui, dans quel domaine ?
– Un peu de tout, des articles, des histoires, des poèmes religieux, et, depuis que je suis au service de Monsieur Koch… Vous connaissez monsieur Koch ?
– Ce nom me dit quelque chose…
– C’est un marchand, il est très riche… Oui, je donne des cours à son fils… C’est un jeune homme à qui il me faut apprendre beaucoup… Mais et je vous ennuie avec mes histoires, monsieur le directeur… Tenez je vous ai amené…
Puis il se mit à sortir de la poche de son pourpoint une feuille de papier qu’il commença à déplier. Un coup de vent soudain… et son manuscrit s’envola. Nous voilà tous les quatre en train de courir après le document volant. Guillaume fut le plus rapide : il l’attrapa et le rapporta, un peu froissé. Je ne sais pourquoi, mais je trouvai en cet homme, avec sa gaucherie et son bavardage, quelque chose qui m’attendrit.
– Allons jusque chez moi, monsieur, vous me…
– Monsieur c’est me faire trop d’honneur…
Il remit le document dans sa poche et nous suivit. En arrivant à la maison, je dis aux garçons :
– Guillaume et Emmanuel, allez donc voir votre mam…, allez voir Anne. Moi, je vais monter avec monsieur dans mon cabinet de travail.
Je montai l’escalier tout droit, comme toujours avec une sorte de recueillement. À chaque fois, c’était comme si je me rapprochais un peu du Seigneur. Là haut, au 1er étage, il n’y avait plus que Lui, Moi et la musique… Ce jour-là, la pièce était inondée de soleil. Elle comportait deux fenêtres: de l’une, qui donnait au sud, on pouvait voir la rue et la maison Bose, et de l’autre, qui donnait à l’ouest, on apercevait le mur de la ville, la rivière, le petit pont, puis les champs qui s’étendaient à perte de vue.
Henrici entra dans la pièce sur la pointe des pieds, comme s’il voulait ne pas faire de bruit. Il se mit à parler en chuchotant, tout bas et très vite, en me montrant son papier froissé.
– J’ai écrit ce poème après un incident de chasse qui s’est passé récemment chez Monsieur Koch, à Niederglaucha près de Düben, (c’est là que monsieur mon Maître a son domaine de chasse). J’ai cru tirer sur un oiseau, une pie ou un pic, mais je ne sais comment, j’ai atteint un paysan qui passait par là. J’ai été arrêté par les soldats. Depuis on me surnomme « pic-autre » ou confond-pie, en allemand « Picander ».
Je retins un sourire.
– Cela nuit à ma réputation et m’attriste énormément. Alors je me suis mis à écrire encore plus qu’avant et en particulier des textes religieux…
– Et le pauvre homme ?
– Ah oui, comme vous me comprenez, monsieur Bach.
– Ce n’est pas de vous que je voulais parler mais de ce paysan que vous avez blessé… enfin ça ne fait rien.
– Oui, monsieur Bach, je fais des poèmes, comme celui-ci, écrit comme je vous le disais après cette malheureuse chasse qui m’a inspiré ceci… écoutez…
Il me regarda, hésitant, puis se mit à lire :
– Tout comme un cerf qui brame quand il veut de l’eau fraîche, ainsi je crie, mon Dieu, vers toi
Il continua sa lecture et il le faisait sur un tel ton de sincérité que je me laissai bercer par les mots : pourquoi ne pas utiliser ce texte ? Après tout je puisais depuis longtemps dans les mêmes recueils les textes de mes musiques d’église: ceux de Lehms ou de mes amis Neumunster et Franck ou de quelques autres.
Pourquoi toujours prendre des textes existants et les mettre en musique sans vraiment les modifier ? Pourquoi ne pas demander à des gens qui écriraient sur place, auprès de moi, et ce qui me permettrait de changer leurs mots en fonction de ma musique ?
– Monsieur Henrici, pouvez-vous me prêter votre manuscrit ? Revenez me voir jeudi après-midi, c’est le jour où je n’ai pas de cours et nous pourrons discuter.
– Monsieur Bach, c’est pour moi un immense…
Le jeudi suivant, j’entendis sonner. J’étais dans mon bureau, au second étage. J’allai voir par la fenêtre qui était là. Je reconnus Henrici et criai :
– Montez, monsieur Henrici.
Je pouvais ouvrir la porte depuis mon cabinet grâce un système de bobinette qui n’était pas sans me rappeler certains mécanismes de l’orgue. J’accueillis Picander dans la pièce du bas où étaientt le clavecin et la grande table. C’est là que mes fils et mes élèves travaillaient à copier des partitions.
– Guillaume, mets-toi au clavecin et toi Jean-André, tu vas chanter (Jean-André était le petit fils de Kuhnau). Moi je jouerai du violon.
– Oui papa,
– Oui maître,
– Avez-vous terminé de copier le premier air ?
– Oui.
– Alors allons-y ! Six croches par mesure 1,2,3,4,5,6
Henrici écoutait, médusé.
– Alors qu’en pensez-vous ? Monsieur Henrici.
– Votre musique…
– J’ai un peu modifié votre texte mais la musique, enfin… les idées sont là. Venez là-haut avec moi.
Nous avons discuté longuement ce jour-là. Nous nous entendions à demi-mot. Il comprenait la raison des modifications que j’avais faites à ses textes.
Le ciel était clair : par la fenêtre, nous pouvions voir le soleil se coucher.
…Puis j’ai oublié Henrici.
***
Comme je le disais, c’est à cette époque que je connus quelques difficultés, en particulier quand, peu après début septembre 1723, je reçus ma paye. Je la montrai à Anne.
– Anne vois-tu ce que je vois ?
– Qu’y a t’il avec cette paye ?
Elle dit cela sur un ton agacé qu’elle avait très rarement. En fait elle était moins concernée que moi par les problèmes d’argent car elle n’avait jamais connu le vrai manque d’argent.
– Regarde, ils ne m’ont donné que 6 florins pour mon service à l’Université. Ça fait la moitié de ce qu’ils me doivent. C’est un coup de Görner : ce type est un envieux. Il se prétend compositeur : mais c’est un médiocre tant comme compositeur que comme organiste. J’en sais quelque chose, je l’entends souvent à l’église Saint Nicolas… Sous prétexte qu’il est aussi organiste à l’église de l’Université, il se croit tout permis. Dès le début, il s’est posé en concurrent vis-à-vis de moi. Tiens, je parie que c’est lui qui a dû demander… et obtenir l’autre moitié.
– Allons calme-toi,… tu es injuste, l’autre jour tu en disais du bien : après tout avant que tu n’arrives, il avait la charge la musique de l’Université
– Comment ? Tu prends son parti ?
– Mais non, mais non, ne te mets pas en colère pour si peu: six florins sur les 700 que tu gagnes par…
– Comment c’est très peu ? Mais Anne, tu oublies que mon salaire fixe n’est que de 100 florins (50 000 F) par an et que tout le reste ce sont ces « si peu » dont tu parles. Ah non, ça c’est trop fort. Même toi… Eh bien je vais écrire au Bourgmestre.
– Ne fais pas ça, tu sais bien que ce n’est pas de son ressort.
– Bon, alors je vais écrire au Conseil de l’Université… Je vais leur dire ce que je pense… et qu’il faut que justice soit faite. Je ne tolérerai pas cela… jamais je ne lâcherai… Je suis aussi directeur de la musique à l’Université. Tu vas voir… Tu ne m’as jamais vu vraiment en colère…
– Jean-Sébastien ! Calme-toi… je vais t’apporter ta pipe.
Elle se leva et eut une légère faiblesse. Je me précipitai vers elle :
– Anne, Anne, mais qu’as-tu ?
– Je… Je… Je… Je ne suis pas complètement sûre… mais je crois que je suis enceinte !
Ma colère tomba d’un coup, je me sentais vaguement ridicule. Ces trois je… je… je… me résonnèrent dans la tête. En fait je me souvins que je venais de les réutiliser au mois de juin dans une de mes musiques d’église : « Je… Je… Je… J’avais bien des tourments ». Je regardai Anne tendrement… Je l’aidais à monter dans notre chambre.
Quand elle se fut endormie, je me glissai hors du lit et j’écrivis ceci sur une feuille blanche qui restait inutilisée :
Quand je prends ma pipe
Remplie de bon gros tabac
Pour passer un moment agréable,
elle me fait voir une image de deuil
et y ajoute cette leçon
que je suis tout pareil à elle
La pipe est d’argile et de terre
Dont je suis fait également
Moi aussi, je retournerai à la terre
Elle tombe sans crier gare
S’est brisée souvent dans ma main
Mon destin est comme le sien
Je glissai la feuille sous son oreiller.
Le lendemain matin Anne vint me voir avec le papier à la main. Elle dit d’un ton un peu las :
– C’est bien joli, mais c’est un peu triste.
– Je te promets qu’un jour je te ferai un menuet sur ces paroles.
La réponse à ma lettre à l’Université arriva quelques jours après, fin septembre. On me répondait que j’avais fait ma demande trop tard. J’étais découragé. Je ressentais toute la profondeur de la pensée de Luther. Oui, il y avait bien deux univers en moi, deux univers bien réels : d’un côté il y avait l’univers de mes relations quotidiennes au monde, à ce monde de peines, de soucis, d’argent, de péchés et de joies éphémères, ce monde d’attente de la mort, et d’un autre côté il y avait l’univers de la musique, de la création, de l’ineffable et de la gloire de Dieu.
Dans le premier univers je rampais maladroitement, hargneux, teigneux, exaspéré et exaspérant. Vers l’autre je volais irrésistiblement dans un immense et indicible ciel de joie et j’essayais d’y entraîner tous ceux que j’aimais.
La réponse de l’Université à ma lettre me consternait…Et, curieusement, la nouvelle de la venue d’un nouvel enfant, le second d’Anne, qui aurait dû me remplir de joie, m’inquiétait, ce qui n’avait jamais été le cas pour les autres…
Je savais que parfois, devant l’adversité, je pouvais sombrer dans une telle mélancolie que le désir même de la mort et du désespoir pouvait m’envahir. Et ce fut le cas, quand j’appris une autre mauvaise nouvelle : le règlement de l’école allait être modifié avec comme conséquence une diminution de mes salaires. Je vis alors tout en noir : j’étais ruiné, mes enfants mendiaient,dans les rues, les épidémies et la guerre revenaient…
En cette fin de 1723, je manifestai mes sentiments dans plusieurs musiques qui étaient d’une brève intensité et montraient ma hargne, ma colère et ma mélancolie. A part moi qui pouvait le comprendre ? Anne, peut-être s’en doutait. Mais Guillaume lui, ne s’y trompait pas.
Un soir, tard, comme la nuit était tombée, et que tout était silencieux, j’étais en train de travailler dans mon cabinet de travail. Je mettais la dernière main à un air pour alto. La chandelle jetait une lueur vacillante sur mes papiers et mes livres. Par la fenêtre, je pouvais voir la campagne éclairée par la triste lumière de la lune. Tout me semblait triste. J’avais du mal à retenir mes larmes. J’entendis très nettement un petit frottement sur ma porte fermée, puis ce frottement se répéta sous la forme d’un petit coup. J’entendis alors une petite voix (qui n’avait pas encore mué) :
– Père, père…
J’essuyai machinalement mes yeux, pris la chandelle, me levai et allai ouvrir la porte.
– Père, Père, regarde… mais qu’est ce que tu as ? Ton visage est comme le jour de la mort de maman ! Père, père…
Je pris Guillaume dans mes bras sans pouvoir dire un mot. Ces mots : père, père et la façon dont mon fils les avait prononcés restèrent à jamais gravés dans ma mémoire. Ce mot de père…
– Père, je n’arrivais pas à dormir.
– Mais Guillaume, il faut que tu dormes…
– Père, tu as l’air si triste en ce moment. Alors je t’ai amené un poème que m’a montré Régine Ernesti. Tu sais que son père aimait beaucoup faire des sermons sur les artisans ?
– Oui, je le sais, mon fils.
– Eh bien ce texte a été écrit par un cordonnier de Nürnberg, qui s’appelait Hans Sachs. Et comme la semaine dernière, pour le 14ème dimanche après la Trinité, tu as choisi de parler des médecins…
– Comment cela ?
– Oui tu te souviens bien de ce texte si triste ? Tiens, montre moi la partition !
Mon fils me fit une telle impression que sans rien dire j’allai chercher les feuillets.
– Tiens, écoute : alors que l’Évangile nous parlait de la guérison de lépreux par Jésus, ce qui est plutôt gai, voici le triste texte que tu as choisi: "Le monde est comme un hôpital, où les humains innombrables et aussi les enfants au berceau sont terrassés par la maladie : l’un sent dans sa poitrine la chaude fièvre de l’envie, …un autre est rongé par l’argent… car le péché a souillé tout le monde. Ah ! ce poison pénètre aussi dans mes membres. Où est le médecin qui m’aidera ?"
Père, je comprends que tu sois triste: moi aussi, il m’arrive d’être triste. Alors la musique me console. Quand je suis triste, c’est la musique triste qui me console. Et alors je reprends espoir.
J’étais sidéré que cet enfant soit aussi proche de moi.
– Père je me disais donc que comme tu as parlé des médecins, tu pourrais prendre le texte de cet artisan de Nürnberg, Hans Sachs. Voici ce texte :
"Ah ! je suis pauvre et de gros soucis m’oppressent. Du soir jusqu’au matin ! …Qui me libérera de ce monde si… méchant ? La misère est autour de moi. Ah si seulement j’étais mort ! Dieu traite correctement les animaux… moi, je ne sais pas comment me procurer un morceau de pain ! Ah vous, les soucis, chaque matin, chaque jour, vous revenez".
Et maintenant, écoute, Père, voici l’espoir qui revient :
"Le monde entier peut me haïr, je lance mes soucis à mon Seigneur. S’il ne m’aide pas aujourd’hui, il m’aidera bien demain : mes soucis, je les mets sous l’oreiller. Vous, mes soucis, je vous demande le divorce : alors je pourrai aller vivre comme au ciel !"
Ce texte me séduisit tout de suite. Les pasteurs l’apprécièrent aussi.Pour le traiter en musique, j’eus l’idée de revenir aux formes archaïques que j’avais utilisées autrefois, ce qui marquait mes doutes face à l’avenir.
Je montrai souvent mon travail à mon fils Guillaume. Il fut enchanté quand pour le 22° dimanche après la Trinité, le 24 octobre 1723, j’utilisai des passages qui évoquaient les problèmes financiers (l’artisan usurier ?):
"Il me manque beaucoup, ce que je veux avoir est tout à mon profit
Toi, juste Dieu, est-ce que tu comptes ?
Vous pressez vos débiteurs, la vengeance doit s’allumer.
Ah ! Mets la somme à mon compte'..
Mais le fonds de ma mélancolie fut atteint, je crois, quand je mis en musique, sans même en parler à Guillaume, le 21° dimanche après la Trinité, le 17 Octobre, mes doutes en choisissant ce texte : " La main du Père… me viendra en aide : mais non, j’enfonce dans la terre devant les soucis et je tombe au sol avec eux… Le Très Haut n’entend pas les pêcheurs".
Heureusement j’avais Guillaume, heureusement, dans ces périodes de mélancolie, j’avais tous les miens car je suppose que dans la solitude, je serais devenu triste et inerte, un peu comme le serait mon pauvre fils qui allait naître quelques mois plus tard et dont Anne était enceinte. Mais je n’avais pas le temps d’être seul : la solitude est un luxe accessible aux nobles ou aux jeunes hommes (comme moi autrefois à Arnstadt) et aux vieillards.
J’avais autour de moi Anne, mes enfants, mes élèves, mes disciples, tous ceux qui avaient fait de la musique leur métier et venaient chez moi quand ils passaient à Leipzig.
On venait de bien loin pour me voir : on appréciait mes qualités d’organiste, d’instrumentiste et de musicien et j’en étais heureux. Je remerciais le ciel de m’avoir donné ces dons et cette capacité à les travailler. Cela me donnait aussi l’occasion de faire la connaissance de gens souvent fort agréables, presque toujours intéressants. J’avais aussi en permanence sur place une dizaine d’élèves privés. Ils participaient à la vie de la maison : les copies à organiser, les enfants à éduquer ou à soigner, le courrier à écrire. Tout mon petit monde mettait la main à la pâte.
Les élèves de l’École de Thomas n’avaient pas toujours la vie facile : pour dormir, ils n’avaient en général qu’une seule paillasse pour deux ou trois, ils ne mangeaient pas toujours à leur faim, et en hiver ou en cas d’épidémie, ils tombaient souvent malades. C’est à la fois avec envie et admiration que l’on considérait la partie du bâtiment où nous habitions, avec sa chaleur, sa joie de vivre et ses allées et venues constantes, reflets des heurs et malheurs de la vie.
Les autorités savaient tout cela et, à défaut d’apprécier ma conduite, avaient à cette époque pour moi une certaine indulgence. De plus, ces messieurs savaient que j’avais une grande réputation en tant qu’organiste et en tant que musicien. J’étais d’ailleurs souvent convié à expertiser des orgues nouvelles qui se construisaient dans la région. C’est ainsi qu’au début du mois de novembre : je me souviens, c’était un mardi, j’eus une grande joie, grâce au recteur Ernesti.
Comme le lecteur l’aura remarqué, Ernesti, le vieux recteur de l’école de Thomas, avait pour moi beaucoup de gentillesse. Nous avions souvent l’occasion de nous voir, et j’ai même l’impression qu’il recherchait ma compagnie :
– Bach, je vous fais une totale confiance en ce qui concerne la musique. Vraiment Kuhnau avait raison de vous apprécier ! Mais essayez tout de même de satisfaire aussi à vos obligations de professeur.
– Mais je ne peux pas perdre mon temps à donner des leçons à des enfants qui n’ont aucun don ! Je préfère faire travailler les meilleurs pour qu’ils arrivent à chanter les chœurs que je compose !
– Il est vrai que vous leur faites faire des prouesses. Kuhnau se plaignait toujours de voir le nombre d’élèves et le niveau musical diminuer, ce dont il m’attribuait bien sûr la responsabilité ! Eh bien je suis sûr qu’il aurait été heureux d’entendre le résultat de votre travail en quelques mois. Mais Bach, montrez-vous un peu arrangeant avec les autres élèves et nos dirigeants de la ville.
– Comment ? Avec des gens qui ne tiennent pas leurs engagements ?
– Écoutez, Bach. De nos jours, dans l’enseignement, tout le monde n’apprécie pas la musique autant que moi. Je suis de la vieille école : vous vous rendez compte que je suis là depuis bientôt quarante ans ? Moi je pense que la musique est la meilleure formation.
– Et d’autres… ?
– …considèrent que le droit, les sciences et tout cela est plus important.
– Monsieur le Recteur, j’ai une immense faveur à vous demander… Je voudrais… Enfin, on m’a demandé…
– Mais dites… monsieur Bach
– Eh bien voilà, vous savez que l’église de Störmthal est en réparation ?
– Ah non… euh… attendez, je vais demander à ma femme. Régine… Régine…
– Oui, qu’y a t’il, Jean-Henri ?
Régine entra : elle était beaucoup plus jeune que son mari. On disait qu’il l’avait épousée quand lui avait plus de 40 ans, alors qu’elle était loin d’avoir 20 ans. Régine Carpzov avait l’air un peu austère : elle était sans doute bien la fille de son père, qui avait été pasteur à Saint Thomas et était réputé dans toute la Saxe pour sa rigueur dans notre foi luthérienne, mais aussi pour son originalité. C’est lui qui, pendant toute une année, chaque dimanche, avait fait des sermons sur les différents types d’artisans. Quand on connaissait bien sa fille Régine et qu’elle était en confiance, elle devenait une femme pleine d’esprit.
– Ma chère, dit le Recteur, vous qui savez toujours tout, savez-vous qu’à Störmthal…
– Il n’y a que vous, Jean-Henri, pour ne pas savoir ça ! Je sais même qu’on cherche quelqu’un pour expertiser le nouvel orgue construit par Monsieur Hildebrandt et pour organiser la musique de l’office.
Elle dit cela en me regardant avec un sourire appuyé. Et je crois même savoir que certains amis de monsieur Bach…
– Pardonnez-moi de vous interrompre, madame, dis-je tout d’un trait, mais je voulais justement demander à Monsieur le Recteur de m’accorder la permission d’aller à Störmthal pour expertiser l’orgue et pour emmener le premier chœur et les instrumentistes. Nous pourrions y jouer une de mes musiques.
– Mais Bach, il n’en est pas question, vous avez votre office à assurer le dimanche.
– Mais Monsieur le Recteur, cela ne se passera pas un dimanche mais un mardi.
– Dans ce cas, Jean-Henri, dit Régine, je n’y vois que des avantages. Notre Cantor est mis à l’honneur et nos choristes sortent un peu de leur école !
– Mais que vont dire les autorités de l’église de Thomas ?
– Ne vous inquiétez pas de cela, vous savez bien que mon frère y est archidiacre et que notre ami Christian Weiss, le pasteur, est hors d’état de parler depuis quatre ans.
– Dans ce cas, je me rends, dit le recteur Ernesti.
– Et vous pourrez ainsi entendre Anne chanter en public !
– Comment, vous feriez ça ? Vous savez qu’à Leipzig les femmes ne sont pas autorisées…
– J’ai demandé au pasteur Fischer…
– Ah oui, le pasteur Fischer : c’est lui qui exerce actuellement à Störmthal ! Je me souviens bien de lui… Il avait écrit une thèse quand il faisait ses études ici, sur le fait de savoir si on pouvait imiter les apôtres…
– Et il est tout à fait favorable à ce qu’Anne vienne chanter.
– Mais Anne est enceinte, dit Régine, elle ne doit pas…
– Au contraire, elle ne rêve que de cela. Et d’ailleurs pourquoi les femmes enceintes ne pourraient-elles pas chanter à l’église ? Peut-être vos universitaires pourraient-ils écrire une thèse là dessus ?
Je devais avoir l’air furieux… Des images confuses me remontaient à la mémoire du temps où je chantais avec une jeune fille dans l’église d’Arnstadt…
– Oh monsieur Bach, ne vous moquez pas de l’université ainsi ! dit Le Recteur Ernesti sur un ton très sérieux. Je crois qu’effectivement ce serait un sujet intéressant.
– Mais vous-même, Madame Ernesti, qu’en pensez-vous ? Des femmes enceintes peuvent-elles chanter à l’église ?
– Oh moi… eh bien… je pense que Martin Luther ne s’y serait pas opposé !
– Bien, dis-je soulagé.
Il y eut un silence, comme si plus personne ne savait quoi dire. Je pris mon courage à deux mains.
– Monsieur le Recteur, je voudrais vous demander une faveur.
– Que voulez-vous encore ? Aller jouer à Berlin chez le Roi de Prusse ?
Il avait dit cela comme une chose tout à fait inconcevable, lui qui n’avait pas quitté Leipzig depuis quarante ans.
– Non, non, rassurez-vous ce n’est pas cela. Ce que j’ai à vous demander vous concerne beaucoup plus directement.
– Ah oui et qu’est-ce donc ?
– Eh bien voilà, monsieur le Recteur, accepteriez-vous d’être le parrain de l’enfant qu’Anne porte en son sein ?
– Oh vous savez, Bach, moi je suis trop vieux, ce ne serait pas un bon service à rendre à l’enfant
– Oh ! Monsieur le Recteur…
– Allons Bach, pas de faux semblants entre nous. Approchez-vous, je voudrais vous dire un mot.
Puis, il me chuchota à l’oreille
– Je suis sûr que Régine…
– Mais bien sûr, dis-je tout haut, j’en serais très honoré et Anne aussi, j’en suis sûr… Madame Ernesti, vôtre époux propose que vous soyez marraine de l’enfant qu’Anne porte.
Régine Ernesti ne trouvait plus ses mots :
– Oh Monsieur Bach… Comme c’est gentil à vous. Mais je n’accepterai que si votre épouse accepte…
– Je vais chercher Anne…
Juste à ce moment, on cogna à la porte, c’était justement Anne. Elle était resplendissante : avec ses 22 ans, elle paraissait parmi nous trois comme une enfant… Elle accepta avec joie. Les deux femmes s’embrassèrent.
– Et savez-vous quoi ? dit Anne de sa voix claire. Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule !
– Non
– Eh bien, je vais chanter à Störmthal…
J’étais confus. Je venais à peine de demander au recteur si je pouvais aller à Störmthal… Mais un regard entre le recteur, sa femme et moi et tout le monde éclata de rire devant Anne éberluée…Et c’est ainsi que par une belle journée d’automne 1723, quelques temps après avoir fait l’expertise du petit orgue de Störmthal, situé à deux heures de marche de l’école, je dirigeai une des musiques d’église que j’avais composées au temps où j’étais à Cöthen. Anne chanta très bien.
Après ce charmant intermède, la vie habituelle reprit à Leipzig. Ma mélancolie avait fait place à de la hargne. Décidément, cette histoire de salaire à l’université ne passerait pas comme ça. Je ne voulais pas m’avouer vaincu. Je n’ai jamais songé à m’avouer vaincu. Passé le premier découragement, les plus grandes difficultés, les paris apparemment impossibles, les obstacles insurmontés, me donnent une énergie farouche : je m’y incruste, j’y adhère, je m’y accroche, je ne lâche pas prise. D’où cette réputation d’opiniâtreté et d’entêtement, dont je m’accommode d’ailleurs fort bien.
Il ne restait plus que quelques semaines avant le temps de Noël, si bien que je décidai de ne plus créer de nouveau grand chœur, ce qui était à chaque fois un travail considérable. J’avais entrepris en effet de composer pour le mois de décembre une œuvre sur le texte de la prière du Magnificat. J’aimais beaucoup cette prière du Magnificat : Marie la dit pour remercier le divin Créateur au moment où elle apprend qu’elle attend un fils qui sera Jésus, le fils de Dieu. Alors elle court dans la montagne annoncer la nouvelle à sa cousine Elizabeth. Marie, la Mère par excellence, chante la gloire et la puissance de Dieu. Quand je fermais les yeux et que je me représentais la scène, cette Mère de Dieu avait toujours le visage de ma propre mère. Je portais en moi tant de hargne, tant d’ardeur, tant d’énergie, tant de zèle que je tentai par ma musique d’en exprimer les forces d’éternité. Des idées surgissaient sans cesse pour ce Magnificat dont je sentais les tressaillements en moi ! J’étais comme Marie dans une sorte de travail d’enfantement.
Tout ce travail et cette rage firent qu’au moment où se réalisèrent les mauvaises nouvelles annoncées et qui m’avaient tant tourmenté (nouveau règlement, diminution de salaire, non-paiement de mon dû pour l’université etc…), je n’en fus pas impressionné. Ainsi, quand le nouveau règlement fut publié, j’envoyai simplement et comme automatiquement, une protestation. Ce n’est pas pour autant que je n’avais pas l’intention de continuer à me battre.
Pour moi, quand les choses prévues arrivent, elles appartiennent déjà au passé : c’est exactement ce que j’éprouve quand j’improvise. Au moment où je joue les notes sur le clavier, elles appartiennent déjà au passé car je pense déjà à ce moment, à celles que je jouerai plusieurs dizaines de secondes après.
Avant le grand jour du Magnificat, je rendis visite au prince de Cöthen pour son anniversaire, en décembre. Cette visite devenait pour moi une sorte de tradition. Je me contentai de prévenir le recteur de ce voyage sans lui demander désormais l’autorisation de partir. Je n’aimais pas me sentir contraint ainsi dans mes voyages ou mes absences. Le prince Léopold, encore mal remis de la mort de sa femme, entouré de l’affection de sa mère, n’avait d’yeux que pour sa petite fille qui commençait à marcher et à parler. Il prit la peine de s’inquiéter de ma vie à Leipzig et regretta le temps passé. J’avais l’impression d’avoir quitté Cöthen depuis des années.
Autre bonne nouvelle et qui me remplit de fierté. L’inscription de Guillaume à l’Université. Bien sûr dans mon impatience, je m’y étais peut-être pris un peu en avance (plusieurs années), mais il était inscrit.
Et puis il y avait la satisfaction que me donnait mes bons élèves comme Wagner, que j’avais formé au violon, au clavecin et aussi à la composition et qui devait rester avec moi encore deux ans.
Enfin arriva le jour tant attendu de ce Magnificat que j’avais fait beaucoup travailler à mes élèves. C’était le jour de Noël, 25 décembre 1723. Tout se passa bien. À la fin, je vis mon petit Emmanuel venir vers moi, l’œil brillant d’excitation :
– Père, crois-tu qu’un jour je pourrai faire une aussi belle musique ?
J’entendis derrière moi une voix de fausset qui cherchait à imiter la mienne :
– Oui, mon fils, si tu travailles autant que moi.
C’était la voix contrefaite de Guillaume qui prétendait m’imiter : je ne voulus pas le gronder en un si beau jour, mais c’était là encore une des facéties de mon cher aîné. Je lui souris en lui pinçant l’oreille.
Toute la période de Noël, du Nouvel an et de la fête des Rois Mages est pour moi une période de fête qui se situe hors du temps de l’année. Les musiques que je compose pour cette période prennent toujours un caractère plus doux et plus serein. Je suis alors dans une sorte de bonheur, de joie calme, de détachement que rien ne saurait ébranler.
À partir du 6 février, je ne composai plus rien, repris quelques anciennes musiques et me concentrai entièrement sur la musique que je préparais pour le dimanche de Pâques qui tombait, en cette année 1724, le 9 avril.
Mais le destin semblait m’être contraire. Le second enfant d’Anne, son premier garçon dont j’attendais et, je ne sais pourquoi, redoutais tant la venue, naquit à la fin du mois de février : il était malingre et faible.
Autre mauvaise nouvelle, on m’annonça que Monsieur Pezold ne pouvait plus assurer ses cours de latin et j’étais obligé de les faire moi-même.
Je n’avais plus que deux mois devant moi pour préparer les fêtes de Pâques! Les difficultés décuplaient mes forces. Ces messieurs de Leipzig avaient autorisé depuis quatre ans une grande représentation de la Passion à Saint Thomas. J’allais produire l’œuvre la plus grandiose jamais conçue sur le récit de la Passion et la mort de Jésus le Christ, d’après l’évangile de Saint Jean.
Une œuvre capable de rivaliser avec la Passion de mon ami Telemann sur le fameux texte de Brockes. Mais moi je voulais que ce soit le texte même de l’Évangile qui soit le socle de l’ensemble. Je commençai par faire un plan impressionnant : le texte de l’Évangile était chanté dans des récits et commenté dans des airs, des chorals, des chœurs dont j’avais pris les textes un peu partout, y compris dans Brockes lui-même. Je m’aperçus que j’avais conçu pas moins de 68 morceaux. Ce chiffre n’était pas voulu mais on peut faire dire à ce chiffre que 6+8=14, chiffre de B A C H
Comme d’habitude, mais plus encore que d’habitude, je mis à contribution tous ceux qui autour de moi aimaient la musique.
Je permettais à Guillaume de venir me voir fort tard dans la nuit :
– Père, pourquoi ne pas réutiliser comme vous le faites souvent vos musiques déjà composées à Weimar ou à Cöthen : cela vous fera gagner du temps.
– Pas question, mon fils : j’écris sur le texte même de l’Évangile et je veux que tout ce que je conçois autour de cette passion soit totalement nouveau.
– Père, pourquoi fais-tu des chœurs si compliqués au moment où la foule crie ? Par exemple quand au début les brigands viennent arrêter Jésus. Jesus demande : « Qui cherchez-vous ? » et ils répondent : « Jésus de Nazareth » !
– Mais je ne peux pas faire un chœur qui ne va durer que quelques secondes !
– Et pourquoi pas ?
– Attends, je suis dans le récit et là, tout le chœur se lève et crie « Jésus de Nazareth » ? Tu vois ça dans l’église de Saint Thomas ?
– Mais pourquoi pas ?
- Mais on dira que c’est du théâtre !
– Et alors ? Ce pourrait être si beau, ce cri, dans l’église !
J’eus alors l’idée de faire un chœur apparemment tout simple sur les mots « Jésus de Nazareth », où tous chanteraient en même temps en prononçant trois fois « Jésus de Nazareth ». L’ensemble durerait moins de vingt secondes.
Je dis à Guillaume :
– Chante avec moi, mon fils et voyons ce que cela donne.
Alors je me mis au clavicorde et nous avons crié ensemble : « Jésus de Nazareth » si fort qu’Anne se réveilla et vint nous voir :
– Mais qu’est-ce qui vous prend en pleine nuit…
– Attends Anne, écoute ! et puis chante avec nous : « Jésus de Nazareth » !
Et Anne chanta.
Alors Emmanuel arriva et il chanta avec nous :
– « Jésus de Nazareth » !
Puis un élève qui logeait chez nous se joignit à nous en criant :
– « Jésus de Nazareth » !
Guillaume avait raison : l’effet était extraordinaire. Et nous nous laissions emporter par notre enthousiasme jusqu’à ce que le préfet chargé de la discipline cette semaine-là arrive et nous dise :
– Mais on vous entend jusque dans les dortoirs là-haut !
Alors tout le monde alla se coucher. Mais une fois Anne endormie, je revins à mon cabinet de travail et continuai mon œuvre.
Une autre fois, je mettais en musique le moment où Pierre, le disciple de Jésus, a si peur, lorsque Jésus est emmené par les soldats, qu’il prétend par trois fois ne pas le connaître. Jésus, pourtant, quelques heures avant, avait prédit à Pierre qu’au moment où il le renierait pour la troisième fois, on entendrait un coq chanter.
Guillaume regarda attentivement le texte que je mettais en musique et me dit :
– Mais, Père, il manque une phrase !
– Comment cela, il manque une phrase ?
– Mais oui. Après « Et aussitôt le coq chanta », il y a dans le texte « …et Pierre pleura amèrement ».
– Mais non, mon fils, tu confonds avec l’Évangile selon Matthieu. Tiens regarde !
Et je lui montrai la Bible traduite par Luther dont je prenais fidèlement le texte. Guillaume lut attentivement : il était à l’âge où l’on ne croit plus sans preuve. Il avait l’air plongé dans un abîme de réflexions. Puis il plissa le front.
– Père…
– Oui, mon garçon, qu’y a t-il ?
– Père, tu ne peux pas laisser ce passage comme ça… Il faut que Pierre pleure… Écoute.
Et il se mit à me chanter une vocalise qui m’impressionna tellement que j’avais du mal à retenir mes larmes. Je m’empressai de la noter sur le papier. Et c’est ainsi qu’elle paraît telle quelle dans ma Passion.
Les deux mois avant Pâques passèrent si vite que je ne pensais pas beaucoup à l’organisation matérielle. Je répétais le plus souvent avec mes élèves à Saint Thomas. Le « Jésus de Nazareth » et les chœurs brefs où ils devaient crier leur haine, leur plaisaient tellement que les difficultés techniques disparaissaient comme par enchantement. J’avais prévu au début un double chœur, comme Dieu l’avait lui-même décrit au début de la Bible, au chapitre 15 verset 1 à 21 de l’Exode. Je voyais déjà le jour où ils chanteraient dans cette église de Saint Thomas le vendredi saint, avec la foule. Devant moi la tribune, avec les instruments et à ma gauche dans la tribune le 1° chœur, à ma droite dans l’autre tribune le 2° chœur. Derrière moi en bas, au milieu de la nef, les femmes, et, sur les bas côtés, tous les hommes assemblés. J’étais heureux que cette première Passion soit jouée à Saint Thomas, car j’avais donné aux chœurs une grande place.
La semaine avant celle qui précédait Pâques, je fus convoqué devant le Conseil. Le Président de l’église Saint Nicolas était là.
– Monsieur Bach, vous avez commis une erreur !
– Laquelle, monsieur ?
– Nous devons vous dire que vous nous mettez dans une position difficile.
Je m’attendais à quelque catastrophe… j’étais dans un tel état de tension, en raison de l’effort que m’avait demandé mon travail !
– Mais qu’ai-je fait encore, que trouvez-vous donc tous…
– Monsieur Bach, je vous arrête avant que vous ne prononciez des paroles excessives. Voilà, je crois savoir que vous pensez jouer votre Passion à Saint Thomas alors que vous devrez la jouer à Saint Nicolas. Et en tant que Directeur de cette Église je me dois de vous dire qu’il a été prévu que, pour la première fois cette année, la Grande Passion doit être jouée dans mon Église et…
– Mais ce n’est pas possible. J’ai prévu un double chœur d’entrée et seules les tribunes de Thomas sont assez vastes pour me permettre de jouer ce chœur avec tous les garçons et puis le clavecin de Nicolas est injouable et puis mes textes sont imprimés à l’adresse de l’église de Thomas… et puis…
– Et puis… quoi ? Monsieur Bach ?
– Et puis… ce n’est pas possible…
– Monsieur Bach, ceci est un ordre. Je veux bien faire réparer ce clavecin et payer une nouvelle impression du programme…
– Mais mon double chœur au début… je le voyais… avec tous mes garçons, disposés en deux groupes dans la grande tribune de l’Église de Saint Thomas.
– Demandez au sacristain qu’il vous aide pour aménager la tribune de Saint Nicolas. Et, puisque nous parlons de vos chœurs, monsieur Bach, nous sommes plusieurs à penser que depuis quelque temps, on y entend pas assez les thèmes de choral et qu’ils sont souvent fort longs.
– Mais… le chœur d’entrée à deux chœurs dont je vous parle est couronné par un choral. D’ailleurs il… il… n’y pas une note à changer à ma musique.
– Je ne dis pas cela, monsieur Bach. Je dis que, depuis quelque temps, on n’entend pas assez les thèmes de choral… On dit que votre amour pour les parties d’alto et de ténor…
Je sentis que j’allais exploser. Mais heureusement, comme en plusieurs occasions déjà, je réussis à rentrer en moi ma colère et fis une grimace plutôt qu’un sourire et je quittai les lieux le plus vite possible. Sur le chemin du retour, je fus pris d’une sorte de vertige.
J’entendais, venant du fonds des temps, une musique inimaginée. J’entendais une immensité d’eau, frémissante de mouvements immobiles, de pulsations divines d’où allait surgir un cri créateur. C’était ce que j’avais commencé à percevoir à Lübeck quand je m’étais trouvé face à la mer. J’entendais maintenant les cris d’enfants en train de naître. J’entendais chanter, venant des quatre coins du ciel, tous les peuples du monde…et je voyais au dessus de moi, dans un ciel clair, le Christ en croix inondé de soleil : je ne distinguais que sa couronne d’épines et ses cheveux sanglants, tout près de moi, et ses pieds, très loin, à l’autre bout du ciel, là où le ciel rejoint la terre.
Les paroles du Psaume 8 résonèrent à mes oreilles : « Seigneur, ton nom est puissant à travers toute la terre… »
Je courus à la maison, ne vis personne, je n’entendis personne, je me jetai dans mon cabinet de travail. Je restai toute une journée et toute une nuit sans même entendre qu’on voulait me déranger.
Le lendemain je réunis tout le chœur et les instrumentistes.
– Venez, je vous emmène à l’église Saint Nicolas
Ils ne m’avaient jamais vu dans cet état. Certains se jetaient des regards pleins de doutes et d’interrogation.
– Allez, entrez, serrez-vous un peu ! Serrez-vous ! De toutes façons on m’a promis plus de place pour le jour où le public sera là ! Le sacristain va s’en occuper, paraît-il ! Messieurs, vous allez devoir apprendre en quatre jours le chœur d’entrée de ma Passion selon l’Évangile de Saint Jean.
Quelques voix s’élevèrent :
– Mais nous l’avons déjà appris !
– Non, j’ai tout changé, comprenez-vous ? J’ai tout changé. Car ce chœur, nous devrons le chanter ici, à Saint Nicolas.
– Mais nous pensions…
– Moi aussi, mais tout est changé. Vous m’entendez ? Tout est changé ! Alors écoutez-moi bien. Ce n’est pas souvent que je vous dis de crier. Mais là, sur la première note, sur le mot « Père », chantez le plus fort que vous pourrez, de toute votre voix, comme si vous vouliez faire écrouler l’église ! Imaginez que vous êtes dans la nuit depuis toujours et que pour la première fois vous allez voir le ciel.
Les instruments commencèrent, sans fausse note, doucement ; les garçons prenaient leur respiration au rythme de ce doux balancement des cordes et tout à coup leur cri emplit toute l’église. Bonheur immense, joie divine !
Je m’aperçus que ce chœur impressionna tellement les enfants qu’ils s’en trouvaient un peu distraits pour les chœurs suivants. Je décidai donc les deux années suivantes de le mettre à la fin et de le remplacer par un choral. Plus tard, beaucoup plus tard, lorsque j’approchai la vérité suprême, je revins à mon idée première. Mon œuvre était accomplie, j’étais certain d’avoir fait plus grand, plus haut, plus fervent que Telemann ou même que Kuhnau.
Plus d’un mois après je fus convoqué par le surintendant Deyling qui avait en charge toute l’organisation financière et matérielle de la ville de Leipzig. Il était de plus Pasteur de l’Église de Nicolas.
– Monsieur Bach, malgré la sympathie que j’ai pour vous et pour votre musique, je dois vous confirmer que vous me mettez dans l’embarras… Ce billet que voici m’est venu par hasard entre les mains… il a été distribué… avant la Passion. Écoutez : « Il a plu au très sage conseil de décider que l’exécution aurait lieu à Saint Nicolas… » Qui a rédigé ce billet, Monsieur Bach ?
– Mais c’est moi…
– Ah vous le reconnaissez ! Avouez que cela manque d’élégance. On a l’impression que notre décision est une sorte de caprice. C’est une offense à notre conseil, Monsieur Bach. À qui avez-vous montré ce papier avant de le distribuer ?
– Mais à personne, pourquoi ? C’était une simple annonce !
– À l’avenir je veux voir tout ce que vous faites publier…
– J’espère qu’on me pardonnera, mais je ne connais pas encore bien les usages, dis-je en baissant les yeux, surpris de ma propre mauvaise foi.
Le superintendant Salomon Deyling fit comme s’il n’avait rien entendu.
– Ah autre chose, Monsieur Bach, je vous confirme aussi que beaucoup d’entre nous pensent que dans vos musiques, on entend pas assez les thèmes de choral.
– Que voulez-vous dire ?
– Quand les enfants chantent, on doit entendre les chorals qui font partie…
– Mais je peux faire un chœur sans y introduire un choral…
– Je ne vous le conseille pas, monsieur Bach. En tant que Pasteur, je dois enseigner par ces chorals, la doctrine de Luther, et c’est également vôtre rôle.
– Mais depuis que Neumunster a écrit ses recueils, on ne joue plus de musiques avec choral. Le choral vient seulement à la fin, pour conclure. Car la musique, même sans choral, élève l’âme…
– Pas quand elle est trop savante. D’ailleurs les thèmes des sermons qui vont être faits par le prédicateur cette année seront des commentaires de chorals de Luther et de ses disciples.
– Mais… alors, je ne devrai plus composer un seul air sans qu’on y entende un thème de choral ?
– Il suffit, Monsieur Bach. Ne tombez pas dans l’extrême inverse… Les gens de Leipzig sont sensibles à de jolis airs, même sans thème de choral. Cela marque un moment de détente pendant l’office. Mais quand les enfants chantent en chœur… il faut qu’on entende les chorals.
J’avais réussi à garder mon calme. Je n’aimais pas que les autorités interviennent trop dans la conception de mes musiques. Cet impératif était contraire à l’évolution que j’avais entamée. Puis je me mis à trouver dans cette exigence de chorals, une nouvelle inspiration. Je composai des musiques et des polyphonies totalement nouvelles à l’époque et même encore maintenant : je n’ai jamais entendu rien de comparable ailleurs, même dans les compositions de mes fils aînés et des gens de leur âge. Je ne cherchais plus des textes de révolte contre mes soucis quotidiens et le monde en général comme certains de ceux que j’avais mis en musique l’année d’avant. J’avais repris confiance en Notre Seigneur et dans les chemins par lesquels il nous conduit vers la mort. J’étais plus serein.
C’est ainsi que, pour tous les dimanches après la Trinité de 1724, je repris la tradition ancienne : je composai des musiques avec des chœurs et même de nombreux airs et récits, dans lesquels on pouvait facilement entendre les thèmes des chorals.
Cela ne m’empêchait pas de progresser dans le projet que j’avais toujours eu depuis que j’avais 20 ans : composer assez de musique d’église pour pouvoir les jouer régulièrement tous les dimanches pendant plusieurs années. Anne riait quand je lui disais que j’arrêterais un jour de composer des musiques d’église pour me consacrer à nouveau au clavecin, à l’orgue, à d’autres musiques :
– Mais mon Sébastien, ce n’est pas possible. Depuis que je te connais, tu travailles des nuits entières pour les cérémonies religieuses à la gloire du Seigneur. D’ailleurs, regarde tes collègues, Telemann par exemple : ils continuent avec les années pour chaque dimanche à composer une musique.
– Oui, mais ils se répètent et moi je ne sais pas me répéter. Ce qu’ils font est beau et souvent original, mais après, dès qu’ils ont du succès, ils se copient eux-mêmes et leurs œuvres se ressemblent. Moi, je ne peux pas. Ou je reprends une pièce ancienne ou je fais quelque chose de nouveau : il faut que je progresse, toujours. Et puis j’ai tellement d’autres choses en tête… Tu verras dans deux ou trois ans j’arrêterai de composer ce type de musique.
– Tu serais bien le premier ! Et puis tu dois respecter les souhaits des pasteurs et des prêcheurs. Et notre avenir, Jean-Sébastien…
– Ne t’inquiète pas, Anne. Tu verras…
Anne m’embrassa alors sur le front comme si elle n’en croyait pas un mot.
Après plus d’un an passé à Leipzig, nous connaissions de plus en plus de monde : j’avais un poste officiel et obligation d’assister à certaines réceptions. Heureusement, j’avais la chance de pouvoir penser mes musiques à tout instant, n’importe où. Une fois ces musiques conçues dans ma tête, il me restait à les mettre sur le papier : pour cela tous ceux qui étaient autour de moi m’apportaient une aide essentielle. Il y avait dans une des pièces du bas une table autour de laquelle je faisais travailler tous mes « copistes ». Parfois, pour la musique du dimanche suivant, il y a avait plusieurs dizaines de copies à faire, une pour chaque instrument et chaque groupe de chanteurs.
J’ai toujours besoin de contact avec des gens : c’est en partie pour cela que j’aime tant notre religion luthérienne et sa vie communautaire. Ainsi, tout près de nous, habitait la famille Bose : la porte de notre logement et la leur se faisaient presque face dans la petite rue. Ils faisaient commerce de bijoux et de joaillerie. Ils étaient très riches. Mais la différence de fortune ne nous gênait absolument pas. Ils avaient fait aménager en dehors de la ville de beaux jardins où nous allions parfois nous promener. Ils adoraient la musique. Nos aînés avaient à peu près le même âge : les Bose avaient des filles qui guettaient toutes les occasion de venir écouter de la musique, d’aider Anne et Fridélène et… de voir les nouveaux nés.
Nous voyions aussi souvent bien d’autres amis, des musiciens, des professeurs à la Faculté, juristes, théologiens, écrivains : avec eux j’adorais discuter et parler par exemple des textes liés à la religion.
Après la période de Pâques 1724, je fis deux voyages : en juin à Gera j’allai inaugurer un orgue à environ 100 km au Sud, ce fut un long voyage mais qui me rapprochait de ma chère Thüringe. Le second voyage, je le fis à Cöthen, en Juillet, avec ma femme : le prince, qui avait tenu à ce que je garde le titre de Maître de Chapelle de Cöthen, nous accueillit chaleureusement. Sa mère était là aussi, toujours vaillante.
Ma chère femme, Anne, nous fit entendre sa fort jolie voix et elle eut beaucoup de succès.
L’automne 1724 se passa dans une surabondante activité de création et de mise au point de musiques d’église, pratiquement chaque semaine, de surveillance d’élèves et de musiciens, de leçons données à mes élèves.
Un jour de décembre, je revenais de contrôler des trompettes à l’Hôtel de Ville de Leipzig. J’avais emmené mon troisième fils, Bernard (10 ans), un petit garçon espiègle et encore plus fantasque que ses deux aînés : les enfants (sauf Guillaume) adoraient voir « mes » trompettes qui sonnaient des chorals en haut de la tour de l’Hôtel de Ville. Au retour, nous en avions profité pour regarder par la même occasion les petites échoppes des commerçants de la petite foire du marché de Noël.
Avant de rentrer à la maison, je passai comme souvent voir mon ami Georges Bose. Au moment où j’allais entrer dans sa boutique, une femme en sortit. Elle me regarda avec un sourire que je perçus ironique et narquois. Nos regards se croisèrent. Elle hésita un instant, puis s’éloigna. J’avais eu le temps de voir son visage : elle devait avoir une trentaine d’années mais j’avais cru voir dans ses yeux une vivacité d’esprit rare chez les femmes.
J’entrai dans la boutique :
– Ah ! Sébastien, comment allez-vous ?
– Bonjour, ami Georges, mais je ne veux pas vous déranger. Je vois que vous recevez du beau monde en ce temps de Noël.
– Comment, vous ne savez pas qui est cette dame qui vient de sortir ?
– Au risque de vous décevoir, je vous assure que non.
– Mais c’est Christiane de Ziegler !
– Comment ? La fille de Romanus l’ancien maire ? À propos est-il toujours en prison ?
– Oui, depuis… vingt ans, je crois.
– C’est elle dont on dit qu’elle est femme de lettres et qu’elle va créer une revue ?
– Mon pauvre Sébastien, me dit Georges Bose, que va t’on devenir si les femmes se mêlent de tout ?
– Ici, à Leipzig, ça me paraît difficile puisqu’on leur interdit même de chanter dans les églises…
À ce moment la porte de la boutique s’ouvrit et j’entendis une admirable voix de femme, grave et bien timbrée qui disait :
– Finalement, je vais vous le prendre…
– Quoi donc, madame ?
– Mais ce collier bien sûr…
Je restai là, un peu gêné, tenant mon garçon par la main, sans savoir trop quoi faire… Alors Georges Bose se retourna vers moi et dit :
– Ah mais… Ah… où avais-je donc la tête ? Je n’ai même pas fait les présentations : Sébastien je vous présente Madame Christiane de Ziegler, connue dans toute la ville pour la qualité de son esprit et ses talents de femme de lettres.
– Madame je vous présente…
– Inutile, Monsieur Bose. Quand on suit, comme moi, régulièrement les offices, on connaît forcément Monsieur Bach.
– Très Honoré, madame.
– Je vous avoue, monsieur, qu’à l’église, chaque dimanche, j’attends la fin du sermon avec impatience car je sais que j’entendrai après, un peu de votre musique. Un sermon, quand il est en quelque sorte inséré entre des œuvres de Monsieur Bach, me paraît si long qu’il me met au supplice…
– Mais madame…
– Je dois vous dire que j’apprécie d’autant plus votre musique qu’elle est en bonne harmonie avec ces petits livrets de textes qui nous sont distribués d’avance.
– Mais madame…
– Mais quand je vous entends diriger vos chanteurs et vos instrumentistes depuis le clavecin…, j’avoue que je me surprends parfois à écouter davantage le clavecin que les instruments. Vous me pardonnerez ma franchise mais je ne sais plus mentir…
Cette femme parlait avec une ironie mordante sur un ton qui me rappelait singulièrement le pédantisme des Français à Celle. Mais à travers cette ironie on sentait poindre comme une grande tristesse.
À ce moment, entra Christine, l’aînée des Bose, petite jeune fille épanouie chez qui on sentait déjà percer la future femme. Elle avait décidé, je ne sais pourquoi, de m’appeler « papa Bach ».
– Papa Bach, papa Bach, tout le monde vous attend. Vous nous avez promis de nous faire chanter ce soir avec Anne, votre femme !
– Ah oui, c’est vrai, l’air de ma musique de Noël.
Je ne sais pourquoi, mais je m’entendis dire alors :
– Madame, si vous vouliez me faire l’honneur… J’ai voulu créer un effet particulier dans un récit en y incluant un choral.
Anne chantera le récit, les enfants le choral et moi je jouerai l’orchestre… avec mon clavecin ! Je serais heureux d’avoir votre sentiment sur l’harmonie entre textes et musique, dis-je avec un petit sourire.
– Monsieur, je ne saurais…
– Oh si, madame, venez, dit mon jeune fils Bernard, qui depuis son entrée dans le magasin semblait subjugué par madame de Ziegler, venez, s’il vous plait.
Christiane de Ziegler sourit en caressant la tête de mon garçon avec une tendresse triste qui me surprit. Je ne savais pas alors que ses enfants avaient déjà rejoint le Seigneur, ainsi d’ailleurs que ses deux maris.
– Votre petit garçon ferait fondre n’importe quelle femme… Eh bien, c’est d’accord, mon garçon, dit-elle sans me regarder, je vais venir, mais je ne voudrais pas…
Je fis semblant de ne pas écouter. Je me tournai vers George Bose :
– Mais je suis sûr que vous aussi Georges, vous allez venir, si vous voulez entendre chanter vos filles. D’ailleurs pour vous, il est l’heure de fermer boutique… Vous autres commerçants, vous avez des heures pour fermer. Moi, je ne ferme jamais dis-je en montrant ma tête et mes oreilles et en me baissant vers mon fils pour lui faire une grimace.
C’était le temps de Noël. Je voulais que tout le monde soit heureux.
Mon fils Bernard avait alors 10 ans : il éclata de rire. Il ne perdait pas une occasion de faire le pitre, ce qui ne l’empêchait pas d’être aussi doué que ses deux aînés dans notre art.
Christiane de Ziegler paraissait tout à coup pleine de gaieté et d’espièglerie. Elle prit la main de Bernard et nous suivit. Avant d’entrer chez nous, nous sommes allés chez les Ernesti pour leur demander s’ils voulaient venir. Régine accepta avec joie mais son mari préféra aller se coucher.
Anne nous accueillit avec le sourire. Rien ne la surprenait : elle accueillit cette femme comme si elle l’avait toujours connue.
– Anne, je te présente Madame de Ziegler…
– Madame, dit Anne, je suis très honorée de vous accueillir dans notre modeste demeure…
– Madame, c’est moi qui suis confuse…
– Allons, dis-je, prenez place… Les enfants, mettez-vous devant moi, que je vous voie bien. Anne, viens près de moi, tu liras sur la même partition que moi. Catherine, peux-tu avancer quelques sièges pour nos invités ?
À 18 ans ma fille Catherine était devenue une jolie jeune femme et, comme il sied à son âge, un peu réservée. Elle regardait madame de Ziegler, comme hypnotisée. Guillaume et Emmanuel ne la lachaient pas des yeux non plus.
– Non, pas trop près, là, voilà. Le siège de Madame de Ziegler sera celui-ci, à côté de Fridélène. Tout le monde est prêt ? Allons-y 1, 2, 3…
Christiane de Ziegler écouta attentivement. Après la fin de la musique, le silence dura quelques secondes. Puis madame de Ziegler demanda :
– Mais… de qui est le texte ?
– C’est… euh… une adaptation d’un texte de Luther !
– Ça, je m’en doute ! Mais une adaptation de qui ?
– C’est sans importance. Vous savez… c’est une collaboration des uns et des autres…
– Tiens à propos, papa, dit Guillaume, j’ai croisé Andreas Stübel, tout à l’heure. Il avait l’air étrange. Il m’a raconté qu’il avait été co-recteur de notre école et qu’il travaillait avec toi sur des textes.
– Oui, c’est vrai, il a bien été co-recteur, mon fils. Il a été mis à l’écart parce qu’il se prenait pour un prophète. Mais c’est un homme remarquable, un grand théologien et spécialiste du latin.
– En tout cas, il m’a impressionné en me disant : « Je te prédis qu’avant la fin du mois je serai mort ». Sa voix paraissait venir d’un autre monde…
Christiane de Ziegler regarda Guillaume puis me dit d’air entendu :
– Alors, ainsi, vos textes sont de lui ?
– Je n’ai rien dit de tel, madame…Euh…si vous le voulez bien, nous allons faire de la musique, maintenant.
Ensuite, nous avons chanté. Après un silence Christiane de Ziegler se tourne vers moi :
– Monsieur Bach, j’aime beaucoup les émotions qu’exprime votre musique.
Quelques pièces suivirent, chantées par les uns et les autres. Puis arriva l’heure où les enfants devait aller dormir.
– Allons, au lit tout le monde.
– Papa, ne pourrais-je pas rester un peu ? dit ma fille aînée
Régine intervint :
– Elle a raison, c’est une jeune femme maintenant
Christiane de Ziegler semblait ailleurs. Je devais sans doute avoir la même expression car je pensais très fort à une de mes compositions. Tout à coup, elle sembla descendre d’un songe.
– Monsieur le Cantor, pensez-vous que vos supérieurs et vos pasteurs accepteraient que j’écrive des textes de musique d’église ?
– Comme Messieurs Frank ou Neumunster ? dit Fridélène, à qui ces noms rappelaient les souvenirs de Weimar et de Cöthen, époque bénie où sa sœur, ma défunte épouse, était encore de ce monde.
– Ou comme Henrici ? dit Guillaume
Tout le monde, sauf moi, éclata de rire.
– Cet Henrici est impayable ! Vous savez qu’il se fait appeler Picander ?
– Ah oui et pourquoi donc ?
– Mais parc…
– Allons parlons sérieusement : moi je trouve l’idée de Mme de Ziegler excellente.
C’était Régine Ernesti qui avait parlé : elle connaissait tout le monde grâce à son mari et à son frère. Si elle disait oui, c’est qu’elle ferait tout pour que les autorités acceptent.
– Pour une fois qu’une femme…
Je me mis à taquiner Régine.
– Mais, Régine, ne pensez-vous pas qu’il faudrait faire d’abord demander à des théologiens de faire une thèse sur le sujet : « Une femme a t’elle le droit d’écrire des tex…
– Vous vous moquez de moi, dit-elle en souriant
– Eh bien moi, je trouve que le sujet de cette thèse est une bonne idée, dit Georges Bose. Après tout, les femmes…
Anne, Régine et Christiane ne lui laissèrent pas le temps de finir et couvrirent sa voix.
– Monsieur Bach je vous propose de faire des textes pour les prochaines fêtes de Pâques
– À une condition, Madame…
– ?
– C’est que nous travaillerons ensemble…
– Qu’est-ce que vous entendez par là, Monsieur Bach ?
– Eh bien, vous écrirez les textes selon votre inspiration et…
– Et ?…
– Et nous verrons ensemble, si, en fonction de la musique que j’écris, il ne convient pas de modifier, disons certains mots ou certaines tournures de phrases…
Christiane sembla très étonnée. Elle ouvrit la bouche, comme si elle allait dire quelque chose, puis elle sembla se raviser et dit :
– Mais… tout à fait d’accord, Monsieur Bach.
– Dès mon retour de Cöthen où je vais fêter l’anniversaire du Prince, nous commencerons à travailler.
Je tenais beaucoup à ce voyage à Cöthen chaque année, d’une part parce que j’avais toujours le titre de Maître de Chapelle, mais aussi parce que j’y retrouvais le Prince et ses amis. Cette année-là, toute une délégation de Weissenfels était là, à commencer par le Prince Christian lui-même, ainsi que plusieurs membres de la famille Wilcke, celle de ma chère femme.
Le Prince Christian de Weissenfels était accompagné de plusieurs personnes de qualité parmi lesquelles je reconnus Henri Scherling, un commerçant de Leipzig, ami de George Bose.
– Monsieur Scherling, comment se fait-il que j’ai l’honneur et le plaisir de vous voir ici ? lui dis-je
Il m’emmena à l’écart et me dit :
– Monsieur le Cantor, vous voyez le jeune homme là bas ?
– Oui…
– C’est monsieur Frédéric Lösner. Son nom ne vous dit rien ? Vous l’avez peut-être vu quand vous êtes allé à Dresde ?
– Peut-être, vous savez, on voit tellement de monde là-bas !
– Bon, ça ne fait rien. Eh bien ce monsieur a en charge tous les problèmes de transport sur les fleuves et les rivières au nom de notre Roi, sa Majesté Auguste le Fort, l’Électeur de Saxe et roi de Pologne !
– Ah bon ? Et pourquoi est-il ici ?
– Il est venu avec le Prince Christian de Weissenfels : il ont des projets de bateaux sur la Saale, la rivière qui passe à Weissenfels et ces projets m’intéressent pour mes affaires mais aussi parce que ce monsieur… va épouser ma propre fille.
– Je vous félicite, monsieur Scherling !
– Merci, Monsieur Bach. Tenez, approchons-nous !
Le Prince Christian était en grande discussion avec ce Monsieur Lösner et une charmante jeune femme. Je m’inclinai respectueusement devant le Prince de Weissenfels.
Le Prince Christian me reconnut tout de suite :
– Monsieur le Maître de Chapelle, bonjour !
– Permettez-moi de vous présenter Monsieur Lösner et la fille de Monsieur Scherling, Elisabeth.
– Monsieur et moi-même sommes de vieilles connaisances : vous rappelez-vous, Bach, quand vous avez fait de la musique pour mon anniversaire : c’était… attendez…
– Il y a presque 22 ans Prince !
– Vous avez une bonne mémoire, monsieur Bach.
Monsieur Scherling fit un signe à sa fille, d’un air de dire « Vas-y, c’est le moment ! ». La jeune fille s’avança vers moi en faisant une révérence :
– Monsieur le Cantor, nous savions que vous seriez ici aujourd’hui et nous avons une grâce à vous demander. Monsieur le Cantor, vous savez que mon futur mari s’occupe des fleuves et des rivières. Votre nom, Bach veut aussi dire rivière. Nous avons pensé qu’il y avait là un signe. Et alors… nous nous marions le 12 février prochain et nous voudrions que vous nous fassiez une belle musique.
– …
– Votre prix sera le nôtre, bien sûr.
– C’est quel jour ?
– Un lundi. Mais j’ai quelque chose à vous montrer.
Elle sortit un papier sur lequel étaient griffonnés quelques mots.
– Regardez. Ce sont des passages de la Bible dans lesquels la parole de Dieu se réfère à l’eau, aux fleuves, aux bateaux. À commencer par les fleuves du Paradis décrits dans le Livre Saint, au début de l’Exode.
J’étais étonné de l’ardeur et du sérieux de cette jeune fille. Tout le monde la regardait avec admiration puis les regards se tournèrent vers moi. J’étais bouleversé de ce signe venu de Dieu lui-même : Dieu et l’eau, Dieu et Bach-Le Ruisseau.
– Je vous promets un beau mariage, mademoiselle.
– Oh merci, Monsieur le Cantor, je…
Le Prince Christian lui coupa la parole :
– Mais au fait j’y pense : pourquoi ne pas faire pour moi aussi une nouvelle musique à l’occasion de mon anniversaire en février prochain ? Avec une histoire de chasse ou de bergers, comme il y a 20 ans.
Les bergers, la campagne, je ne sais pourquoi, mais je pensai aussitôt à Picander. Cela lui irait sûrement très bien. Il aimait bien mettre en scène des gens et des choses, il aimait les grecs et les romains, comme c’était alors la mode. Il ferait sûrement un bon texte. De notre travail commun naquit notre musique composée pour beaucoup d’instruments, qui fut jouée à Weissenfels le vendredi 23 février 1725, tout juste 22 ans après la cantate de la Chasse. De mon ami Salomon Franck à Picander, combien de textes avais-je cherché, lu, choisi, parfois remanié ou adapté !
Ce voyage à Cöthen avait été fructueux à tous points de vues. Dès mon retour je me mis au travail pour les musiques d’église avec Christiane de Ziegler. Le plus souvent, nous avions choisi de placer en entrée les textes de l’évangile de Jean, choisis comme d’habitude pour les lectures des offices de cette période d’après Pâques. J’ai une telle vénération pour ces textes des Évangiles, que je les mets plus souvent sous forme de chœurs ou de récits chantés par la voix de basse. Les textes de Christiane de Ziegler ne venaient qu’en appoint.
Notre collaboration me permit d’apprendre beaucoup de choses sur la vie et les salons de la ville. Nous avions déjà travaillé sur 9 textes de cantate, lorsqu’un jour, ce devait être au mois de mai, elle m’invita à venir chez elle. Elle me dit qu’elle recevait quelques amis. Quand j’arrivai, je pus constater qu’il y avait là tout ce que la ville comptait de beaux esprits. Je fus surpris de la jeunesse de la plupart d’entre eux. D’ailleurs, je fus accueilli comme par un murmure de respect qui montrait bien qu’ils me considéraient comme leur aîné.
Christiane de Ziegler s’avança vers moi suivie d’un jeune homme d’une vingtaine d’années dont le regard hautain m’effraya chez un homme aussi jeune.
– Je vous présente Jean-Christophe Gottsched, poète et professeur, membre du collège marianiste.
– Professeur, déjà ? dis-je en voulant être aimable.
Ce trait d’esprit involontaire fit rire toute l’assemblée. Tout le monde me regardait d’un air entendu, comme s’ils voulaient dire : «Ah, ces artistes, il n’y a qu’eux pour dire des choses pareilles »
– Jean-Sébastien Bach, directeur de la musi…
– Ne me présentez pas monsieur Bach, chère amie, c’est lui faire offense et faire offense à la musique de notre pays.
Puis il me regarda de toute sa hauteur un peu méprisante :
– Avec Telemann et Haendel, vous êtes, monsieur, l’une des trois grandes gloires musicales actuelles de notre Allemagne et votre renom s’étend en Italie et en France.
Sa phrase terminée, il alla vers d’autres invités. On avait un peu l’impression qu’il était le maître de maison. Je vis alors s’approcher de moi un homme assez jeune que je ne reconnus pas tout de suite tant son apparence avait changé. Il est vrai que cela faisait plus de deux ans que nous nous étions vu et qu’à cet âge, on change beaucoup. C’était Henrici : il avait l’air plus sûr de lui qu’avant mais sans arrogance. Je reconnus son sourire interrogateur, comme s’il demandait toujours s’il ne dérangeait pas.
– Monsieur Henrici ! Comment allez-vous ? Que devenez-vous ? Justement je voulais vous voir. Le Prince de Weissenfels veut une musique pour son anniversaire avec des bergers grecs, alors j’ai pensé à vous.
Henrici devint rouge de joie contenue.
– Oh Monsieur le Cantor, je vous en suis si rec…
– J’ai vu que vous avez publié chaque semaine jusqu’à Noël un recueil des poèmes religieux.
– Vous les avez lu ?
– Hélas quelques uns seulement mais, faute de temps, pas tous. Mais cela m’a permis de penser à vous de temps en temps et je l’avoue de m’en inspirer parfois, jusqu’à ce que je rencontre Madame de Ziegler, avec qui j’ai travaillé neuf textes de cantate. Nous arrivons au dixième, au début de la période de Pâques. Vous ne m’en voulez pas j’espère ?
– Oh Maître… Vous savez bien qu’au contraire…
Tout à coup on entendit des chchchchch ! ce qui signifiait qu’on demandait le silence. Le jeune Gottsched prit la parole :
– Mes amis, vous savez que nous vivons une période passionnante : les Français nous ont ouvert la voie en nous apprenant comment faire régner la raison dans nos pensées et donc dans nos écrits. « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement », disent-ils. Il nous faut être simples, rester naturels et abandonner toutes les exagérations et les outrances des siècles passés. Je pense, pour ma part, que cela vaut en particulier dans les écrits religieux.
– Que veut-il dire ? soufflai-je à l’oreille de Henrici, sentant monter mon irritation.
– Je vous expliquerai.
– Nous avons la chance d’avoir dans notre ville de Leipzig, des livres provenant de tout l’univers. Nous avons aussi le bonheur d’avoir des esprits ouverts aux idées nouvelles. Parmi eux, il est des femmes de grand talent : Christiane de Ziegler est l’une d’entre elles.
Christiane sourit d’un air modeste.
– Elle a souhaité que je vous annonce une grande nouvelle : elle va publier avec d’autres femmes une Revue qui s’appellera : « La Critique des Femmes de Raison ». Cette revue diffusera des textes conformes aux nouvelles idées.
Tout le monde applaudit.
– Mais qu’est-ce qu’il veut dire sur les écrits religieux ?
– Il pense qu’il ne faut plus utiliser des comparaisons ou des correspondances trop expressives.
– Par exemple ?
– Je ne sais pas… Ah si !… Par exemple la comparaison entre le cerf qui cherche de l’eau et le chrétien qui cherche le Christ, comme dans notre texte d’il y a deux ans…
– Mais j’ai trouvé votre texte excellent au contraire, c’est même ce qui m’a convaincu lors de notre première rencontre : toutes ces comparaisons, ces mystérieuses correspondances, ces allusions à la création divine élèvent notre esprit vers Dieu…
– Oh, vous savez, je crois qu’il se fait de Dieu une idée différente de la vôtre.
– Ah oui ? Et pourquoi donc ? Il vient souvent à l’office à Saint Thomas… C’est apparemment un bon chrétien qui croit en Dieu.
– Oui, mais disons que, peut-être, il croit aussi beaucoup en la Raison…
Je compris alors pourquoi je trouvais les textes de Christiane de Ziegler trop abstraits, pas assez intenses, pas assez tendus vers Notre Seigneur… Je décidai à cette minute de cesser toute collaboration avec cette femme.
Toute cette histoire de Gottsched me fit revenir pour mes musiques suivantes à des textes de Salomo Franck
et d’autres « anciens ». Sans doute avais-je fait fausse route avec Christiane de Ziegler.
En sortant je passai prendre congé de Christiane de Ziegler. Henrici était derrière moi. Elle était entourée d’un groupe d’admirateurs au milieu desquels était l’inévitable Gottsched. J’entendis ce jeune homme dire à voix basse :
– Celui-là, c’est un poète qui écrit parce qu’il a faim, une sorte de poète affamé !
Puis il jeta un regard vers Henrici qui était derrière moi et il mit son doigt sur ses lèvres en chuchotant
– Mais chut le voici !
Je mis cette impolitesse sur le compte de la jeunesse. Je pris congé. Mme de Ziegler me dit :
– À très bientôt, cher Cantor. Comme j’aimerais que nous puissions continuer à travailler ensemble !
– Mais, madame…, vous allez avoir tant à faire avec votre Revue.
Et je quittai les lieux.
Un groupe de jeunes hommes sortit en même temps que moi. Parmi eux je reconnus des étudiants qui aimaient la musique et avaient des dons suffisants pour venir chanter ou jouer mes musiques d’église avec les élèves de l’école de Thomas. Ils étaient en compagnie d’un homme de mon âge qui souriait et avait l’air très bon.
Henrici était toujours près de moi, comme s’il attendait quelque chose.
– Monsieur le Cantor, bonjour, dit l’un des étudiants sur un ton un peu moqueur en tirant une révérence.
– Bonjour mes amis, je compte sur vous dimanche prochain, c’est la fête de la Trinité !
– Y aura t’il un beau Chœur ?
– Comment ! Vous n’avez pas lu le livret distribué à tous les fidèles ?
– N…nnnon !
– Eh bien oui, il y aura un beau chœur sur un texte du prophète Jérémie.
– Et les autres parties, airs et récits : toujours sur des textes de votre amie Christiane ?
– Oui, mais ce sera le dernier !
– Ah bon ? Euh… Monsieur le Cantor, permettez-nous de vous présenter monsieur Auguste Frédéric Müller, membre éminent de notre Université et qui enseigne le droit.
– Mais nous nous connaissons déjà !
Je ne sais pourquoi, mais j’étais tout à coup gai et détendu.
– Mais bien sûr, dit Müller, monsieur le Cantor m’a déjà parlé de son fils qui veut faire du droit… dans quelques années !
– Mais… dit un étudiant, nous pensions que vous étiez en mauvais termes avec l’Université !
– Mais pas du tout, c’est elle qui est en mauvais termes avec moi : elle ne veut pas me payer !
Tout le monde était joyeux en cette chaude fin d’après-midi.
Je les quittai et me dirigeai vers l’École. Je traversai la place du marché. Comme je m’engageais dans la rue qui mène vers l’Église de Thomas, je fus rattrapé par deux étudiants, Frédéric Wild et Christophe Wecker, que je connaissais bien. Ils avaient couru jusqu’à moi. L’un d’eux, tout essoufflé, me dit :
– Nous… voudrions… vous dire maître… il y a certains professeurs que nous aimons beaucoup monsieur… Müller et d’autres… nous voudrions leur faire une surprise… pour leur anniversaire et ce serait des musiques chantées et jouées… par nous. Pour Monsieur Müller, nous avons déjà trouvé le thème… ce serait l’histoire du dieu du vent qui tout à coup se met à déchaîner les tempêtes et ne veux plus s’arrêter et ce serait monsieur Müller qui apaiserait le vent et en plus il a pour prénom Auguste ce qui fait très romain, et puis… Si vous vouliez bien faire la musique…
– C’est vous qui avez eu l’idée de cette histoire ?
– Oui, enfin, c’est plutôt Monsieur Henrici qui vient souvent à l’Université…
– Mais c’est une excellente idée mais il a d’autres fêtes prévues ?
– Oui, Monsieur Mencke par exemple qui va fêter ses cinquante ans.
– Quand ?
– Le 9 avril.
– Et monsieur Müller ?
– Le 3 août.
– Mais vous maître, si vous…
– J’ai tant à faire déjà… Croyez-vous que j’ai bien le temps ? Et puis mon épouse est enceinte… Savez-vous que c’est très cher d’organiser une musique comme cela. Il vous faut des musiciens…
– Mais nous jouerons et chanterons, cela se passera en plein air, on voudrait des tambours, des timbales, des chœurs, des airs.
– Mais… il vous faut des textes !
– Monsieur Henrici nous a dit qu’il voulait bien…
– Et la musique et les chanteurs et les chanteuses solistes ?
– Nous avons pensé que vous… nous… vos fils et peut-être votre épouse si elle est en bonne santé…
– Savez-vous combien ça coûte, rien que pour la musique ?
– N…non
– Minimum 25 000 F
– Rien que pour la musique ?
– Mais oui, bien sûr, avec tous les frais de papier et de copie !
– Cela devrait aller : nos parents, les professeurs, les notables, nous irons voir tout le monde.
– Écoutez, je ne dis pas non, et puis vous êtes parmi mes bons élèves.
Et effectivement, le lundi 9 avril et le 3 Août furent célébrés ces anniversaires. Le professeur Müller était rayonnant. J’avais un imposant orchestre avec de nombreux instruments à percussion au début et à la fin. Quelle joie de diriger ces étudiants enthousiastes, capables et pour qui la musique était une passion. Tout le monde était enchanté.
Notre petit Christian fut baptisé le samedi suivant. Le choix des parrains montrait combien, moi, le petit musicien de province, j’avais acquis une reconnaissance auprès des autorités les plus influentes de la ville. À Cöthen le prince avait choisi pour nous des grands pour être parrains et marraines. Maintenant, c’est moi qui choisissait parmi les grands: un membre de la suite du Prince électeur, des femmes de commerçants importants, et le fils d’un des maires les plus prestigieux de Leipzig, Paul Wagner qui m’avait tant aidé lors de mon arrivée à Leipzig.
Un jeudi après-midi, Anne s’était rendue je ne sais plus où, je restai seul avec Fridélène.
Fridélène, la sœur de… Maria-B…, la mère de mes premiers enfants.
Elle était devenue une vieille femme. Nous avions fêté cette année-là ses cinquante ans. Elle parlait peu et était sans cesse occupée aux travaux de la maison. Mais elle avait toujours été la confidente de mes moments de doute.
– N’est-il pas temps de prendre un peu de repos, Fridélène ? Tu es toujours la première levée, la première à l’ouvrage.
– Le seul repos que nous méritons, Sébastien est celui que nous accordera un jour le Seigneur dans sa maison. Pour toi non plus, tu le sais bien, le repos n’existera jamais. Toi aussi, tu dois travailler, pour tes enfants, pour la Musique, pour la Gloire de Dieu. Tu as la chance d’avoir reçu de notre divin maître des dons dont tu es le seul dépositaire. Tu dois transmettre aux autres cette parcelle de Dieu qui est en toi.
– Mais je cours toute la journée. Je vais de leçon en cours, de requêtes en recommandations, de cérémonies en fêtes. Et pourtant, il me reste tant à dire !
– À dire ?
– En musique, Fridélène, bien sûr ! Sois tranquille jamais je n’écrirai de mots sur la musique. Les autres, les sourds (j’avoue que mon allusion à Mathesson manquait de gentillesse) par exemple, le font très bien.
– Oui… qu’est-ce qu’un livre, même très savant, devant une belle musique !
– Comme tu comprends les choses, Fridélène ! Mais quand trouverai-je le temps, Fridélène, quand ?
– Je te regarde, Sébastien. Je sens que tu deviens différent. Tes musiques d’église ne te suffisent plus. D’ailleurs tout devient différent : plus rien n’est respecté, même les préceptes de Luther ne sont plus respectés. Depuis longtemps déjà, notre Prince a renié notre foi et s’est fait catholique pour devenir Roi de Pologne. Il paraît qu’il vit dans la débauche. Maintenant j’entends parler partout de libelles et de revues qui sont rédigées par des femmes apparemment pieuses mais qui, au fond de leur cœur, j’en suis sûre, méprisent la religion. Les gens racontent des choses que je ne comprends plus. Même les offices et la musique, dans nos églises, ne sont plus suivis comme avant. Je vois déjà que certains dimanches, tes musiques si belles ne sont plus jouées. Tous ces gens autour de toi, aiment de moins en moins notre musique faite à la gloire du Seigneur. Ici, le vieil Ernesti est fatigué. Il ne fera plus rien pour changer les choses. Ah où est le temps…
Je souris. Oui, vraiment Fridélène, était restée la même qu’il y a vingt ans, la même qu’à Arnstadt. Elle était bien la seule à ne pas changer. Et pourtant, c’était bien vrai : tout changeait autour d’elle, autour de nous.
– Tu as raison, Fridélène, tout change, mais moi, je dois changer avec les temps qui viennent. Les gens veulent des œuvres plus grandioses, même en musique d'église. J’ai de grands projets…
– Mais pourquoi, Sébastien, ce que tu fais est si beau. Ainsi, encore une fois, tu vas douter, peut-être repartir ailleurs, toujours ailleurs. Tu as toujours voulu aller ailleurs.
– Eh bien oui, je suis comme ça !
À ce moment Anne passa la tête par la porte :
– Qu’est-ce que vous mijotez tous les deux ? Savez-vous ce qu’on m’a dit ? Pisendel, Weiss, et Quantz sont de passage à Leipzig. Le violon, le luth et la flûte ! Ils reviennent d’un voyage en Italie. Ils vont venir nous voir.
– Quand, mais quand sont ils arrivés, Anne ?
– Ce matin, je crois.
– Mais pourquoi ne sont-ils pas venus ce soir ?
– Mais je ne sais pas !
Le lendemain matin, mes trois amis vinrent nous rendre visite.
– Racontez-moi ! Alors qu’y a t’il de nouveau en Italie ?
– Tout est opéra là-bas. Tout le monde chante. Vivaldi lui-même ne fait plus que des opéras, toutes les scènes s’illuminent. Il faut que tu voies ça. La prochaine fois, nous t’emmenons.
– Vous savez bien que ce n’est pas possible. J’ai tant à faire. Et la musique est-ce qu’ils en font vraiment ?
– Mon pauvre Sébastien !
– Dites-moi qu’ils ne font pas que des chansonnettes, des traits brillants à l’orgue ou au clavecin ! Dites-moi qu’ils font aussi de la vraie musique, cette musique profonde qu’on ne peut tenter d’atteindre qu’en travaillant, travaillant, encore et toujours. Je voudrais que tous les gens doués pour la musique fassent de la musique… Je voudrais…
– Écoute Bach, tu es vraiment un être à part ! Tu sais très bien que personne ne peut arriver à ton niveau… pour l’orgue ou pour le contrepoint par exemple.
– Mais si, celui qui travaillera autant que moi arrivera à la même chose !
– Tu ne penses pas un mot de ce que tu dis !
Je devais avoir un regard d’une telle sincérité qu’ils s’arrêtèrent de raisonner pour me dire :
– Ne te vexe pas, Sébastien, mais nous avons l’impression à la fois que tu es un des nôtres et que pourtant tu es si différent. On dirait que tu vis hors du temps !
– Mais non ! Je m’intéresse à tout ce qui se fait de nouveau.
– Oui bien sûr, mais tu as ta façon à toi de t’y intéresser. Peux-tu te libérer ce soir, nous pourrions faire un peu de musique !
– Eh bien d’accord, j’ai promis à mon fils de l’aider à compléter notre nouveau cahier, je vous montrerai quelques pièces pour clavecin !
– Votre nouveau cahier ?
– Oui, c’est un cahier que j’ai fait relier spécialement aux initiales de ma femme. Tenez, le voici, il est toujours à portée de main… Regardez cette belle couverture verte avec les trois lettres dorées A M B : Anna Magdalena Bach. Eh bien toute la famille y note les musiques jugées intéressantes. Bien sûr, j’y ai écrit quelques pages. Écoutez !
Je me mis au clavecin et commençai à jouer des œuvres de ce nouveau cahier qui était toujours à portée de main. Quand j’eus fini, l’un d’eux (je crois que c’était Pisendel) me dit :
– J’aurais tant aimé t’entendre aussi jouer de l’orgue ! Peux-tu nous emmener à Saint Thomas ou à Saint Nicolas ?
– Non, c’est impossible aujourd’hui à cause des offices.
– Écoute, cher confrère, je te propose de venir à Dresde jouer sur le nouvel orgue de Sainte Sophie, nous pourrons t’accompagner avec nos instruments. Nous donnerons des concerts dans cette église de Sainte Sophie. Qu’en penses-tu ?
– Mais mes élèves ? L’école ?
– Bah, tu te feras remplacer !
Quelques temps après, je partais. Au moment du départ, je remarquai l’air désespéré de Guillaume, comme si je l’avais trahi !
Dresde était en permanence transformé en chantier par la volonté d’Auguste le Fort, Prince Électeur et Roi de Pologne.
Le château était en pleine rénovation. Ce Roi faisait construire une sorte de théâtre et de lieu pour les fêtes en plein air appelé Zwinger.
Je retrouvai l’orgue de Sainte Sophie qui sonnait si bien. Et, avec les instrumentistes de la cour, nous avons fait pendant ce séjour de la belle musique d’église. Mes amis me racontaient leur vie : le salaire d’un simple musicien de cour était presque deux fois plus élevé que le mien pour simplement jouer d’un instrument! Il y avait beaucoup de postes à pourvoir : par exemple, il y avait un Cantor Catholique et un Cantor Luthérien. Tous voulaient que je vienne à Dresde.
Mais qu’aurais-je pu faire à Dresde au milieu de tous ces faiseurs de chansonnettes ? De l’opéra, de la musique imposée par le Prince ? Je pensai à ce que Fridélène m’avait dit : que je voulais toujours être ailleurs. Finalement rester à Leipzig ou j’étais le Directeur de toutes les musiques et chercher à y améliorer la situation de la musique en ayant des relations privilégiées avec la cour de Dresde, n’était-ce pas la meilleure solution ?
J’avais toujours en tête cette histoire de salaire pour l’Université payée à moitié de ce qui m’était dû. J’avais rédigé avant de partir une lettre destinée au Roi lui-même pour qu’il règle cette affaire. Je comptais la remettre au château. Au moment où j’arrivai, je vis descendre quelqu’un que j’avais vu lors d’un de mes précédents voyages à Dresde : c’était le comte Fleming. Nos regards se croisèrent mais il ne me reconnut pas. Un instant, il jeta un regard sur moi. Je n’osai lui parler. Une autre fois peut-être…
Le soir nous jouions avec les autres musiciens de bien jolies musiques. Je découvris d’excellentes choses, chez Zelenka par exemple. Il faisait parfois preuve d’une grande tendresse. Cela me comblait le cœur… mais pas complètement. Pourquoi ? Je ne comprenais pas et cela me mettait dans un état de grande songerie.
La période de Noël 1725 arrivait avec la douce magie qu’elle exerçait toujours sur moi.
Je commençais toutefois à me lasser de ce rythme trop exclusif des musiques composées ou reprises chaque semaine, sans compter les jours de fête. Pour moi, les élèves de l’école devenaient un fardeau. La discipline se relâchait. Ernesti vieillissait. Dans ces conditions en 1726 et début 1727, c’est de plus en plus rarement que je composais de nouveaux grands chœurs sauf à l’occasion de fêtes comme la Saint Michel ou quand je trouvais vraiment une piste nouvelle. J’en profitais alors pour donner à ces chœurs une ampleur telle qu’elle correspondait à des ébauches pour un nouveau grand projet : une Passion selon l’Évangile de Matthieu.
Désormais, seuls les élèves doués m’intéressaient vraiment : à ceux-là j’adorais enseigner et voir le plaisir qu’ils éprouvaient à progresser chaque jour. C’est pourquoi je faisais pour eux, pour mes fils, ma fille ou Anne des airs chantés à un ou deux : je pouvais m'y exprimer plus intimement. Nous les jouions à la maison et Anne était si heureuse ! Cela me permettait d’explorer de nouvelles musiques en particulier pour mon grand projet. Rien, pas mêmes les autorités, ne pourraient m’empêcher de proclamer la gloire de Dieu, par le langage le plus proche de Lui : la musique ! Ce que j’étais en train de concevoir, ce projet immense commençait à prendre forme. Je devais m’éloigner de mes tâches quotidiennes !
Cela me fut rendu plus facile grâce à la visite de mon cousin Jean-Louis.
Vous vous souvenez peut-être que je vous avais parlé du cousin Jacques et de sa mauvaise réputation dans la famille : on disait qu’il avait volé, avait voulu se marier trop jeune et avait été obligé de se faire soldat pour pouvoir survivre.
Je vous ai aussi parlé de ces fêtes entre membres de la famille Bach. Avec le temps et la famille grandissant, elles devenaient de plus en plus difficiles à organiser. Mais cela arrivait encore de temps à autre. Ce fut le cas cette année-là.
Au moment où nous commencions, comme le voulait la tradition, par la prière chantée tous en chœur, nous avons vu apparaître à cheval un homme d’une si grande beauté qu’on ne pouvait pas lui donner d’âge. Il avait fière allure et je me dis qu’il devait être quelque dignitaire de la Cour de Dresde. Mais je fus surpris de la tristesse sereine de son expression qui disparaissait dès qu’on le regardait. Comme je m’apprêtai à venir le saluer respectueusement, il sauta de son cheval fort élégamment et s’avança vers moi. Son beau visage triste s’illumina alors d’un sourire. Ce sourire, je pouvais le reconnaître entre mille : ce sourire à la fois interrogateur, dubitatif et profond, ce ne pouvait être que le sourire d’un Bach.
– Jean-Sébastien, me dit-il comme je suis heureux de te voir !
– Mais…
– Souviens-toi, la première fois que je t’ai vu, c’était en 1703, je me souviens de la date car c’est l’année où le Prince de Meiningen venait de m’accorder la fonction de Cantor. Tu parcourais la Thüringe à la recherche d’un emploi. Tu avais peut-être 17 ou 18 ans… Tu es passé à Meiningen. J’avais été sidéré par tes dons à l’orgue. Mais je me présente : je suis Jean-Louis, le fils de Jacques Bach…
Ce nom de Jacques m’avait toujours paru comme une honte pour la famille, bref c’étaient pour nous les cousins à ne pas fréquenter. Il fut néanmoins accueilli unanimement par la famille et participa à notre prière. J’avais pour l’occasion fait une musique sur le thème « Je suis content de moi » sur un poème de Menantes.
Suivirent des chansons et des « quodlibet » (improvisations collectives) dans lesquels, Jean-Louis fit preuve de telles qualités musicales, que cela se transforma en une sorte de duel amical entre lui et moi. Plus la journée avançait et plus ce duel se transformait en une connivence. Après la fête, il vint vers moi. Je ne pus m’empêcher de lui dire avec mon habituelle, maladroite et brutale franchise :
– Tu sais, cousin, ton père Jacques, n’avait pas très bonne réputation dans la famille.
– Oh je sais, il y a des médisants partout. Je vais te dire quelque chose mais… surtout ne te fâche pas.
Ainsi ma réputation d’avoir un caractère parfois difficile était connue partout, même à Meningen !
– Je te promets de rester calme.
– Eh bien, voilà, mon père comme tu le sais a volé quand il était à Eisenach: il n’avait plus aucune ressource !
– Mais cela se passait quand ?
– Environ quinze ans avant ta naissance…
– Mais à l’époque notre cousin « Panier percé » était déjà en poste à Eisenach, à l’orgue de l’Église Saint Georges. Il n’a pas cherché à l’aider ?
– Justement… non. Un geste de lui aurait suffi. Et pourtant mon père était un organiste remarquable…
Une vague de souvenirs déferla dans ma tête. Je ne sais pourquoi, mais je fis tout de suite confiance à Jean-Louis.
– Il était à l’école de latin où j’étais avec mon frère ?
– Oui, sûrement la même… Et il s’est fait renvoyer
– Et le cousin n’a rien fait ?
– …Non, je te le dis, rien…
Je restai songeur et tout à coup je compris pourquoi mon cher grand frère avait tant tenu à m’emmener avec mon frère à Ohrdruf et à m’éloigner de Eisenach. Ah si j’avais su !
Jean-Louis me dit :
– N’en parlons plus. Mon père a eu ensuite une fort belle carrière et il a fort bien éduqué ses enfants, comme tu peux le voir ! Mais… parlons plutôt de toi. Tu sembles faire une carrière magnifique, à Leipzig.
– Oui, à première vue cela semble vrai. Mais la vie est si chère. Les tracasseries de mes supérieurs sont insupportables, les gens s’intéressent de moins en moins à la musique d'Église…
– Comment, Jean-Sébastien, tu parles sérieusement ? On vient de partout pour te voir et suivre ton enseignement. Dans une ville immense comme Leipzig, tu dois avoir de bons revenus : les fêtes, les enterrements, les leçons, les ventes de partitions, les réceptions de princes… Et en plus tu fais une musique que tout le monde admire. Les personnalités les plus célèbres t’encensent. Tu sais, j’ai vu des partitions de toi qui circulent. C’est splendide.
– Allons… Allons… Et toi Jean-Louis, que fais-tu ?
– Oh moi, tu sais, je n’aime pas me plaindre, mais en ce moment j’ai quelques problèmes. J’ai été engagé comme je te l’ai dit en 1703 par le Prince Bernard de Meiningen. Bernard était fort bon avec moi. Mais il avait un petit problème : il croyait pouvoir s’enrichir en créant de l’or par magie ! ! ! Les conséquences pour les finances de son état étaient désastreuses ! J’étais engagé comme Cantor, et, tiens-toi bien, comme chef des pages. Je devais tout leur enseigner.
– Comme moi à Leipzig avec mes élèves !
– Sauf que toi tu n’es pas page en tenue et tu as donné à d’autres le soin de faire certains enseignements !
– Oui, c’est vrai, tu vois, je me plains encore.
– Mon père voyant que je ne pouvais pas vraiment me consacrer à la musique…
– Un peu comme moi ici, dis-je en souriant
– …m’a proposé pour remplacer Monsieur Dedekind à Eisenach…
– Quoi, Dedekind, celui qui était Cantor du temps de mon père ? Mais c’était donc à l’époque où mon frère Jean-Jacques travaillait comme musicien à la mairie avec Monsieur Halle, le successeur de papa ?
– Exactement !
– Mais c’est une coïncidence incroyable…
– Finalement, comme tu le sais, c’est notre cousin Jean-Bernard qui a eu le poste de Cantor (il était déjà sur place au palais du Prince comme Maître de Chapelle) et moi je suis resté à Meiningen. Le nouveau Prince de Meiningen, Ernest-Louis, le fils du Prince Bernard m’a nommé directeur de l’orchestre.
– C’est cet orchestre qui joue de ville en ville ? C’est la première fois qu’un orchestre voyage ainsi. Et l’idée est de toi ?
– Si l’on veut. Et toi qui es toujours inquiet pour tes revenus, réfléchis à une solution d’orchestre. Sais-tu que tu peux bien gagner ta vie avec ça.
– Mais j’ai ma musique d’Église, mes élèves.
– Tu ne vas pas écrire toute ta vie des musiques d’église. Quand tu en as deux ou trois prêtes pour chaque dimanche…
Jean-Louis parlait d’or, il disait tout haut ce que je pensais encore tout bas et que j’avais avoué un soir à Anne. Il m’ouvrait des horizons nouveaux.
– À propos, monsieur le directeur de la Musique à Leipzig, j’ai écrit des cantates que je voudrais te montrer.
– Tu les as apportées ici ?
Il alla jusqu’à son cheval et ramena un cahier.
– En voilà 18.
Je les parcourus en tournant chaque page avec attention.
– Mais ce que tu fais là est merveilleux. L’idée de mettre un grand chœur en avant dernier et un choral après. Je vois que tu prends à chaque fois des textes de la Bible tirés de l’Ancien et du Nouveau Testament. Je vois aussi que quand tu fais parler le Christ, tu mets toujours des cordes à l’Orchestre. Et puis… bravo pour l’utilisation du hautbois et surtout de l’orgue… Il faudra que j’y réfléchisse. D’ailleurs…
– Mais, Jean-Sébastien, …comment as-tu pu voir tout cela en feuilletant simplement ? C’est absolument incroyable !
– Oh, l’habitude, tu sais. Tiens, si tu veux bien, nous allons chanter cet air là, le n°5 de cette cantate n°4. Tu te mets au clavecin et moi je chante.
Je réunis la famille encore présente et, à la surprise de mon cousin, après l’avoir relu une nouvelle fois, je chantai par cœur la partition qu’il venait de me montrer. Tout le monde nous applaudit. Après cet intermède, je le pris par le bras et l’emmenai un peu à l’écart.
– Dis-moi, Jean-Louis, les textes de tes musiques, comment les choisis-tu ?
– C’est le prince qui les écrivait… Il avait même eu l’idée de faire des textes assez généraux pour qu’ils puissent convenir à n’importe quel dimanche !
Décidément Jean-Louis me surprenait. Jamais, à l’époque, je n’aurais imaginé cela. Et pourtant, plus tard, je repris certaines de ses idées. Il se mit à me dévisager comme s’il ne me connaissait pas, j’en fus surpris et gêné, puis tout à coup il me dit :
– Tu sais que tu as un visage, et un regard surtout, qui n’est pas banal du tout. J’aimerais faire ton portrait…
– Ah, parce que tu es peintre aussi ? Et sans doute, homme de loi, avocat, enseignant l’hébreux, le grec et le latin, et poète, jongleur et saltimbanque par dessus le marché, comme tous mes confrères.
J’étais hors de moi. La musique était pour moi un métier si sacré, si plein, si proche de Dieu et de toutes ses créations que je ne comprenais pas qu’un musicien fasse autre chose que de la musique.
– Moi je n’ai de temps que pour la musique, pour la créer, la jouer et l’enseigner aux autres et d’ailleurs…
Jean-Louis m’interrompit d’un air de dire : calme-toi, voyons.
– Mais, la peinture est une autre forme d’art, comme la musique. Tout comme l’architecture que pratique le père de ma femme. Tous ces arts ont pour seul but d’exprimer la beauté et sois sûr, Jean-Sébastien, que c’est là tout mon souhait : exprimer la beauté. Et toi, par ta musique, tu le fais mieux que personne.
Je me jetai dans ses bras, j’avais les larmes aux yeux. Je me confiai à lui, comme un enfant à son père :
– Pardonne-moi, cousin, mais il y a tant de mal autour de nous, de gens qui ne cherchent pas Dieu et sa beauté mais uniquement les richesses de ce monde. Je croyais que tu étais l’un d’entre eux. Je vais te faire une confidence : il m’arrive de considérer mes partitions comme des dessins. Je soigne le tracé des courbes et des notes pour que l’ensemble ait une belle apparence. Je fais des pleins et des déliés qui soulignent ce que je ressens.
Jean-Louis sourit.
– Jean-Sébastien, écoute-moi. Mon prince, Ernest-Louis de Meiningen, est mort l’année dernière. J’ai composé une cantate pour sa mort sur des paroles qu’il avait écrites lui-même. Depuis je ne suis plus payé. Je vis d’expédients. Mais finalement, je n’en suis pas mécontent. Cela me donne une nouvelle jeunesse.
– Comment ? Mais… Mais tu… tu as des enfants ?
– Oui, cinq : l’aîné a 12 ans et la petite dernière 4 ans. Et j’ai une femme aussi !… qui est fille d’un architecte. Tu comprends pourquoi je n’ai pas pu venir avec tout ce petit monde !
– Mais… mais…
Devant mon air affolé, il poursuivit en disant :
– Mais ne t’inquiète donc pas pour moi. Papa nous a appris qu’on pouvait toujours s’en sortir et il l’a prouvé ! D’ailleurs, je ne comprends pas ton inquiétude : tu sais bien qu’avec tes dons et ta réputation, tu as tort de t’inquiéter…
En entendant ces mots de Jean-Louis, je bénis Dieu de m’avoir accordé mon poste à Leipzig, malgré tous mes problèmes. Si j’étais resté à Cöthen mon poste aurait pu être supprimé et alors…
Pourquoi donc avais-je si peur ? À cause de ma nombreuse famille ? Non, cette peur de manquer était plus profonde en moi. Je ne pouvais y résister. Peut-être était-elle due au fait que mon père était mort et que j’avais vu alors ma famille sans ressources. Mais au fonds de moi-même, je savais que Jean-Louis avait raison. C’était une grande âme : il me parlait de moi alors que c’était lui qui avait des problèmes.
Je me pris d’admiration pour le courage de Jean-Louis :
– Écoute, Jean-Louis. Je vais te demander une faveur : puis-je copier ces belles partitions. Tu comprends pourquoi ?
– Je crois que oui.
– Je pourrai les jouer ici, ce qui ne peut être que bon pour toi.
– Mais bien sûr, ce serait merveilleux !
Mon cousin était venu juste au bon moment, il m’avait ouvert les yeux sur tout ce que je ressentais confusément. Le temps que je passais à composer chaque semaine une musique d’église me semblait prendre sur les autres travaux qui m’attendaient. En jouant les musiques de mon cousin le dimanche à l’église, je lui rendais service et cela me permettait de m’en imprégner pour en tirer des idées pour mon grand projet.
Ainsi en 1726, je jouai 18 dimanches les 18 musiques de mon cousin et le vendredi Saint, je dirigeai une Passion selon Marc de Reinhardt Keiser, oui le Keiser que j’avais rencontré un certain soir avec mon cousin, à Hambourg où il dirigeait un opéra. J’y apportai certaines modifications. Comme tout cette période de Hambourg était loin dans mon esprit ! Ainsi, de février à l’été, pendant près de 6 mois, je ne dirigeai aucune œuvre de moi dans les églises de Leipzig ! L’année suivante je serais peut-être prêt pour mon grand projet de Passion selon Saint Matthieu !
J’avais en tête tant d’autres idées !
Guillaume faisait de surprenants progrès à l’orgue. Il était sans cesse avide de découvrir de nouvelles œuvres. C’est peut-être une des raisons pour lesquelles, durant cette période, je fus saisi d’une furieuse envie de retourner plus souvent à mes chères orgues. Je me mis à écrire des musiques d’église dans lesquelles les orgues prenaient une part importante, aussi bien dans les chœurs que dans les airs. Je l’avais fait en partie pour que Guillaume puisse montrer ses capacités à tenir un orgue.
Et, de plus en plus souvent, j’allai à l’Église Saint Paul, accompagné de mes fils et de 3 ou 4 étudiants qui voulaient m’entendre et à qui je demandais d’actionner les soufflets, et restai de longues heures à jouer combinant les jeux, touchant les claviers et le pédalier de cet instrument que j’aimais tant. J’avais alors une prédilection pour les pièces en forme de trio: j’en repris et adaptai certaines anciennes, j’en ajoutai de nouvelles. C'étaient des œuvres non religieuses, légères et dans l'humeur du temps !
Je submergeais mon esprit de lignes mélodiques entrelacées, plus épurées et plus joyeuses que celles de l’Orgelbüchlein.
Je voulais que mon fils me surpasse dans cet art de l’orgue comme dans toute la musique. Il était plus doué que moi, il ne lui restait qu’à travailler autant.
Quand je jouais ainsi, je ne pensais plus à des musiques construites sur des textes religieux avec leurs mystérieux symboles et leurs correspondances mathématiques qui s’inspiraient de ma religion, transmise par mes parents. Parfois je pensais que cette religion n’étaient peut-être qu’un moyen que Dieu avait trouvé pour nous donner une croyance commune et une volonté de vivre ensemble.
La musique dépourvue de symboles est peut-être ce qui nous permet le mieux d’approcher notre créateur… et de mieux transmettre mes connaissances. Cette interruption dans la composition de la musique d’église me permit de réaliser un autre projet : une série de partitas pour clavecin.
J’aimais me promener dans les rues de Leipzig avec mes enfants, particulièrement pendant les périodes de foire : il y a alors tant de choses à voir et à apprendre ! Déjà à cette époque Leipzig était une ville de livres et d’imprimerie. Ce jour-là, je me promenais avec Emmanuel et Bernard: je tombai en arrêt devant une boutique de livres avec un ours comme enseigne. Je la connaissais bien, c’était celle de Monsieur Breitkopf. Je ne sais pourquoi, mais je ne peux pas passer devant une de ces boutiques sans y entrer. Mon fils Emmanuel est comme moi. Au fonds du magasin, il y avait une étagère avec de la musique :
– Regarde papa, ce qui est écrit sur cette partition, dit Emmanuel : Telemann ! Des œuvres de mon parrain, imprimées et puis de Keiser aussi… et ton ami Mathesson ! Mais, papa, il n’y a rien de toi !
– Pour une bonne raison mon fils, c’est que, à part une musique du temps de Mühlhausen et récemment une musique de mariage, je n’ai jamais eu d’œuvres imprimées.
Bernard, 11 ans, nous écoutait, il s’écria :
– Mais pourquoi, papa ? Alors c’est pour ça que tu nous fait toujours tout recopier !
– Toi, Bernard, tu n’es pas le premier à la tâche !
– C’est toujours la même chose dans cette famille, on me critique tout le temps, je suis considéré comme un incapable, mais vous verrez plus tard !
– Bernard, ce n’est pas le moment ni le lieu pour parler de ces choses !
– Avec vous, ce n’est jamais le mom…
Ma main partit. L’enfant reçut une taloche qui le fit fondre en larmes… Puis il releva la tête l’air plein de haine :
– Tout le monde me hait, personne ne m’aime !
Et il s’enfuit dans la rue. Je courus pour le rattraper. Je ne le voyais plus. Je regardai autour de moi. Il s’était caché derrière une porte. Il bondit sur moi en éclatant de rire. Je me mis à courir après lui. Tout le monde nous regardait. Certains me reconnurent et paraissaient éberlués. Je le rattrapai et le serrai dans mes bras : comme il était attendrissant, ce petit homme avec ses colères et son caractère difficile ! Comme nous revenions vers la librairie pour retrouver Emmanuel, nous avons vu de dos un jeune homme qui s’amusait à marcher à cloche pied et tenait des documents sous le bras. Au fur et à mesure que nous nous approchions de lui, nous pouvions entendre qu’il chantait à tue tête, à la surprise des passants qui se retournaient sur lui. Bernard et moi l’avions reconnu : c’était Guillaume.
Nous l’avons alors dépassé sans qu’il nous voie et sur un signe, nous sommes retournés d’un coup. Il était tellement absorbé qu’il mit une fraction de seconde à nous reconnaître.
– Mais… qu’est-ce que vous faites là ?
– Mais… et toi ?
– Je viens de l’église Saint Paul où, avec quelques amis étudiants qui m’ont aidé, je me suis entraîné à jouer ta musique de dimanche prochain.
– Mais où as-tu trouvé la musique ?
– J’ai recopié la partie d’orgue cette nuit.
– Tu vois papa, copier toujours copier…
– Allons retrouver Emmanuel chez Breitkopf.
– Ça, c’est une bonne idée ! Il y fera plus chaud que chez nous, avec ce poêle qui ne marche plus. À propos, papa, sais-tu quand ils vont venir remplacer le poêle ?
– Allons, tu exagères, il marche encore…
– Tu vas voir, ils viendront au printemps, quand il fera chaud !
Tout le monde sourit de la plaisanterie du petit Bernard.
En entrant, j’aperçus Breitkopf et lui fit un signe.
– Bonjour Monsieur Breitkopf. Vous voyez, la famille Bach se réunit chez vous ! Vous connaissez mes trois fils aînés ?
– Oui, bien sûr, mais je crois que c’est la première fois que je vous vois tous les quatre ici, vous me faites un grand ho…
– Serait-il possible d’en profiter pour leur montrer vos ateliers ?
Les machines m’ont toujours subjugué : qu’il s’agisse d’orgues, de clavecin, de luth, de clavicorde ou de machines à imprimer, je suis pris d’une irrésistible envie de comprendre comment ça marche. Je demandai à Breitkopf :
– Mais pourquoi ne faites vous pas une machine pour imprimer la musique ?
– Monsieur Bach, cela reviendrait beaucoup trop cher : d’abord, il faut graver des plaques, c’est très long et très coûteux et puis pour imprimer, il faut des centaines d’exemplaires, pour récupérer les frais !
– Mais pourquoi ne pas faire des caractères mobiles pour les notes, comme vous le faites pour les lettres ?
Breitkopf me regarda d’un œil incrédule et en hochant légèrement la tête, l’air de dire : « Ah ces artistes, on se demande parfois ce qui leur passe par la tête ». Il ne croyait pas aussi bien dire…
– Mais papa, dit Emmanuel, tu es connu, ce serait facile pour toi d’en vendre des centaines de tes œuvres.
– Tu sais que ton parrain, qui sait tout faire, grave lui-même ses plaques pour l’impression ?
– Mais… il y a toute une technique, dit Monsieur Breitkopf. Un amateur ne p…
– Tiens, vous avez un livre splendide, ici.
– Oui, c’est le premier livre que j’ai édité, il y a 6 ans maintenant : une bible de Luther !
– Quelle belle édition !
Je regardai fixement M. Breitkopf. Monsieur Breitkopf me regarda, eut un petit toussotement, puis me dit :
– Eh bien Monsieur Bach, pour fêter votre visite, je vais vous faire découvrir un livre paru récemment à Vienne et qui fait fureur, c’est un livre de Monsieur Fux, le titre est plutôt curieux…
– Oui, c’est Gradus ad Parnassum, mais je voulais tant l’avoir. Ah ! c’est merveilleux… Combien est ce que je vous dois ?
– Comment, mais monsieur Bach, vous êtes au courant de tout ! Ce livre est sorti il y a quelques mois seulement. Tenez, je vous le laisse pour… 6 thalers.
– Monsieur Breitkopf…
– 5 Thalers, monsieur le Cantor.
– Monsieur Breitkopf…
– Mais il est relié, monsieur le Directeur.
– Monsieur Breitkopf…
– 4 Thalers et 20 groschen
– Retirez 8 groschen et je vous le prends.
Les enfants me regardaient en riant sous cape…
Comme nous allions sortir de la boutique, nous nous sommes heurté à un homme qui, plongé dans sa lecture, nous barrait le passage. Il leva la tête, l’air d’être complètement ailleurs : c’était Picander.
– Monsieur Picander, comment allez-vous ? Nous ne nous sommes pas revus depuis la Saint Michel quand j’ai dirigé une musique sur vos textes.
– Maître, c’était merveilleux !
– Vos paroles ont très bien sonné avec ma musique : le furieux serpent, cet horrible dragon.
Vous avez entendu le sifflement du serpent dans ma musique ?
On entendit une petite voix
– Ah oui, le jour de la Saint Michel ? Moi, j’ai adoré, on avait l’impression que toute l’église allait exploser ! Boum !
– Bernard… tu exagères.
– À propos, Henrici… Picander, dites-moi, je voudrais vous parler de quelque chose…
Je vis alors que mes trois fils faisaient discrètement un mouvement de retraite vers la sortie de la boutique en croyant que je ne les voyais pas. Ils savaient que, quand je commençais à discuter avec Henrici Picander, je pouvais en avoir pour des heures. Je leur criai :
– Attendez-moi dehors, j’arrive… Deux mots, cher ami, avez-vous pensé à notre projet de musique pour la Passion du Vendredi Saint? J’ai déjà de nombreuses idées !
– Mais j’y pense sans cesse. Nous allons faire encore plus grand que Telemann ou Haendel avec le texte de Brockes.
– Oui
– Il faut que comme dans votre Passion selon saint Jean, on retrouve le texte exact de l’Évangile. D’ailleurs ces messieurs du consistoire l’exigent.
– Oui
– …Mais il faut que les textes des airs des récits et des chorals enserrent ce texte d’un écrin merveilleux et aux couleurs harmonieuses. Qu’à la révolte de votre première Passion selon Jean succède la Paix selon Mathieu. Que les fidèles…
– Comme vous maniez les mots, cher ami. Et encore vous oubliez la Passion que j'ai composée à Weimar… Moi, je préfère dire tout cela en musique. Nous avons du travail, beaucoup de travail… Je voudrais vous voir chaque Jeudi après-midi chez moi…
– Mais Maître, vous savez bien que jeudi, je dois aller à la mairie…
– Pour votre poste aux douanes ? Mais vous n’êtes pas encore nommé !…
– C’est que le maréchal von Fleming m’a promis…
– S’il vous dit quelque chose, nous irons le voir ensemble.
– Le Maréchal de Fleming, mais c’est un homme important : il est frère du ministre de sa majesté et dirige toute la garnison de la ville.
– Ne vous inquiétez pas pour Fleming, vous dis-je… Et bien, c’est d’accord, à Jeudi… Veuillez m’excuser, je vais rejoindre mes fils…
Je laissai Picander éberlué de la désinvolture avec laquelle je parlais de Fleming. Depuis des années il faisait des travaux d’approche auprès de von Fleming pour avoir un poste aux douanes…
– Papa, tu es fâché avec Picander ? dit Guillaume au moment où je sortais du magasin.
– Pourquoi ?
– D’habitude, tu restes des heures avec lui…
– …
– Papa, dit Emmanuel, le Sérieux de la petite bande. J’ai eu une idée en t’attendant : pourquoi ne pas éditer et vendre nous-même tes œuvres ? Il y a toujours quelqu’un à la maison ! Et beaucoup d’amis passent, viennent du monde entier pour te voir, te parler, t’écouter et puis repartent. Au début, nous n’en tirerons que quelques dizaines.
– Je n’y avais pas pensé.
– Mais cela me paraît une excellente idée, dit Guillaume le Fantasque… Et pourquoi ne pas commencer par cette partita que tu viens de terminer avec des danses : Sarabande, Allemande, Menuet et cette Gigue très gaie que j’aime tant et que tu as récemment terminée. Tu sais, je me suis exercé à la jouer au clavecin. Je suis sûr qu’elle remporterait un franc succès dans toute notre famille et auprès de tes élèves et de tes amis.
– Ah oui, tu croisais sur le clavier les mains comme ça, dit Bernard le Pitre qui se mit à faire des gestes de jongleur de foire tout en chantant la gigue avec une parfaite justesse et en esquissant un pas de danse. Les passants le regardaient en souriant.
– Arrête de faire le pitre, Bernard. Mes fils, je vais vous dire un secret…
Nous remontions le passage qui mène de la Grand Place à l’école, quand nous avons vu arriver deux jeunes femmes portant chacune un enfant dans les bras. Avec le contre-jour, je ne les reconnus pas tout de suite : c’était Anne et ma fille aînée, on aurait dit qu’elles avaient presque le même âge. Anne portait notre pauvre petit Henri qui avait du mal à marcher. Ma fille Catherine portait Elizabeth que nous avions surnommée Liesgen, notre dernier bébé qui devait avoir cinq ou six mois… Catherine, qui ressemblait tant à sa mère… Dieu avait-il voulu cette ressemblance afin que la disparue soit toujours présente à mon esprit ?
Anne souriante comme toujours dit :
– J’avais fini de copier l’air que tu m’avais demandé de mettre dans notre cahier, nous sommes sortis pour voir si l’un de vous, messieurs, arrivait. Et justement, vous voilà tous les quatre.
– Eh bien, toute la mille est là : attendez que je compte, 1, 2… 6, mais non. Où est donc le petit Christian ? Et tante Fridelène ?
– Ils ont préféré rester à la maison.
Comme nous remontions vers l’École, je pris Emmanuel à part et lui dit en chuchotant :
– Après tout, je vais te dire le secret à toi seul, mais tu ne le diras à personne : je sais que toi, tu peux garder un secret. Voilà, c’est une surprise pour l’anniversaire d’Anne. En réalité je voudrais que cette première partita soit le début d’une série que j’ai l’intention d’écrire pour « la délectation de l’âme des amateurs », c’est la formule que j’écrirai sur la page de titre. Et en mémoire de mon cher prédécesseur Kuhnau, je l’appellerai « Études de Clavier ». Je veux montrer la page de titre et l’annoncer le jour de l’anniversaire d’Anne.
– Mais alors tu pourras faire imprimer toute cette série ?
– Mais oui, l’idée me paraît excellente.
Et c’est ainsi que, tout comme Telemann, et d’autres musiciens de Hambourg, je me décidai à me lancer dans l’édition d’une de mes œuvres, en l’occurrence cette partita. Et, à la grande fierté de mes enfants et de ma femme, le 1° Novembre 1726 parut dans le journal « Les Nouvelles de Leipzig » l’avis suivant :
"Nous faisons part, de l’intention du très Honorable Maître de Chapelle d’Anhalt Cöthen et Directeur des Chœurs et Musiques à Leipzig, monsieur Jean-Sébastien Bach, d’éditer des Suites pour Clavecin, et qu’il en a déjà fait le début avec une première partita, qu’ainsi, étape par étape, il a l’intention de continuer jusqu’à ce que l’œuvre soit terminée : cela sera ainsi porté à la connaissance de ceux qui aiment le Clavier. Il faut ajouter pour ceux que l’information intéresse, que l’auteur est le propre éditeur de cette œuvre".
Les enfants étaient enchantés de voir le nom de leur père dans le Journal.
Je décidai de dédier cette partita au tout jeune Prince Emmanuel Ludwig d’Anhalt-Cöthen qui venait de naître : son père était mon cher Prince Léopold (dont c’était le premier enfant mâle) et sa mère était la princesse Charlotte, sa seconde femme.
Cette année là, je ne fis pas de grandes œuvres pour Noël ni pour la fête des rois mages que j’avais pourtant mis en musique chaque année depuis que j’étais à Leipzig. J’étais si absorbé dans mon grand projet de Passion ! Plus qu’au moment de ma Passion selon saint Jean, j’avais alors trouvé une certaine sérénité et mon esprit était complètement accaparé, concentré, tendu sur l’histoire de Jésus et de sa Passion. J’écoutais chaque scène, j’entendais les sentiments de chacun.
Je voulais que ma musique commence par une entrée grandiose, encore plus grandiose que tout ce que j’avais entendu jusque là. Je me souvins du double chœur que j’avais voulu faire pour une Passion deux ans auparavant et que j’avais supprimée parce qu’on m’avait obligé au dernier moment à la jouer à Saint Nicolas. Je décidai d’aller au delà. Le jeudi suivant notre visite chez Breitkopf, j’accueillis Henrici. J’étais dans un grand état d’excitation :
– Cher ami, j’ai en tête de commencer notre passion par un triple chœur
… Trois groupes de personnes…
– Qui ?
– D’abord le chœur des voix célestes, qui dans une lente marche, pleure le martyr de Jésus. Ensuite le chœur de la foule inquiète (c’est à dire nous, vous et moi, nous tous qui vivons dans ce bas monde). Le troisième groupe chante un choral, le choral de l’Agneau (c’est-à-dire Jésus). Chaque groupe joue un rôle symbolique. Le premier groupe avance…
– Comment ?
– …en exprimant sa tristesse devant…
– Quoi ?
– L’Agneau sacrifié, symbole de Jésus mourant : c’est le choral. J’entends tous ces groupes qui marchent en procession et avancent.
– Où, mais où ?
– …Henrici, savez-vous que vous êtes extraordinaire ? Grâce à vous, je viens de trouver les paroles du deuxième chœur.
– Mais comment est-ce possible ? C’est la première fois que nous en parlons.
– Justement, je cherchais comment exprimer l’inquiétude de la foule des fidèles que nous sommes. Eh bien, comme vous à l’instant, ils diront, mais en chantant : Qui ? Comment ? Quoi ? Mais où ?
– Ah maître, vous… vous… mais… moi aussi j’ai une idée : et si nous prenions pour le thème du groupe céleste les Filles de Sion, symbole des voix célestes, cher à Brockes ?
– Excellente idée Pican…, Monsieur Henrici : voilà l’ébauche de notre chœur d’entrée. Il ne vous reste qu’à trouver des paroles.
– Mais maître, j’ai déjà écrit des textes pour la Passion…
– Il faut prendre le meilleur de ce que vous avez fait. Pour le reste, nous travaillerons ensemble.
À ce moment entra Guillaume :
– Mon fils, nous avons commencé à travailler avec Monsieur Henrici. Nous allons faire une passion imposante.
– Mais tout de même pas aussi importante que la passion de Brockes mise en musique par Telemann ?
– Si, elle sera beaucoup plus importante ! À propos, Henrici, vous connaissez Müller ?
– …Nnnnon
– Heinrich Müller.
– …Nnnnon
– C’est un pasteur qui a écrit des sermons merveilleux, sur la Passion.
– J’ai parcouru cela l’autre jour en passant chez Breitkopf. Oui, il me faut ce livre. Tenez, voici 4 thalers, allez prendre l’air, les jeunes ! (il y avait 10 ans d’écart entre eux). Et revenez vite ! Et en descendant dites qu’on ne me dérange pas, dis-je avec un petit signe à Guillaume qui disparut avec Henrici.
En fait j’avais besoin d’être seul : j’entendais ce chœur d’entrée. J’avais devant moi une heure environ. Et alors, la foule m’apparut en sons. Le chœur se construisit. Et je sus que j’avais créé quelque chose de grand. J’eus l’idée d’intégrer des doubles chœurs très brefs, chacun accompagné d’un orgue, car il y avait deux orgues, un à chaque bout de l’église.
Bien plus tard je retrouvai dans la Bible commentée par Carlov dont je m’étais procuré un exemplaire, un passage concernant les chants des hommes et des femmes durant l’Exode ch15, vers20 : « et de l’un et de l’autre chœur ont du s’élever un chant puissant et un bruit extraordinaire répercuté de l’un à l’autre chœur, puisque des centaines de milliers d’hommes se trouvaient rassemblés et chantaient ». Je mis en marge : « Premier Prologue à exécuter à la Gloire de Dieu ». J’avais créé quelque chose de grand et je pensai que la Bible est « le vrai fondement de toute musique d’Église ». Je n’ai jamais écrit rien d’autre sur la musique.
Pour le reste, je ne peux que me répéter : écoutez cette Passion !
Henrici et Guillaume étaient de retour.
– Voici le livre de Müller.
– Ami Henrici, je vous le prête et revenez avec de bonnes idées.
– Mais j’ai déjà écrit pour le comte Sporck…
– Oui, je sais vous avez déjà eu de bonnes idées dans d’autres écrits. Et je connais bien le comte, vous savez qu’il m’a demandé d’écrire une musique pour lui. Il aime tous les arts… Il a des théories troublantes sur Un Grand Architecte. Henrici, écoutez-moi bien : partout dans nos pays, il y a des églises mais il paraît qu’en France, il y a les plus belles cathédrales du monde. Partout on joue des musiques d'église : eh bien moi, je voudrais que notre Passion soit construite pour être la plus belle Passion du monde !
– Maître, je peux me flatter que peut-être le manque de grâce poétique de mes écrits sera racheté par le charme…incomparable de votre musique !
– Allons, ami, pas de grandes phrases entre nous.
Et il partit. Avec Henrici, nous avions trouvé une unité, une ambiance homogène pour décrire la tragédie de la mort de Notre Seigneur Jésus. Ainsi, avant presque tous les airs, je mis un commentaire qui expliquait l’évangile et l’air qui suivait. Henrici m’aida beaucoup pour donner à l’ensemble une structure pleine et pour me suggérer des symboles musicaux à inclure dans ces textes :
– Là, monsieur Bach, peut-être pourriez-vous mettre une forme de mélodie suggérant le symbole de la Croix
– Ici, Picander je vais symboliser par des chiffres les paroles de vos textes.
J’eus aussi l’idée de superposer airs et chœur, avec toujours cette idée du commentaire de la foule soulignant le texte que chante le soliste.
Les répétitions furent longues et difficiles (depuis quelque temps les élèves étaient de plus en plus distraits) mais le vendredi 11 avril 1727, on joua cette Passion à Saint Thomas. À la fin, plusieurs personnes restaient assises dans l'église, alors que d'habitude tout le monde sortait. Je fus surpris aussi de voir Gottsched venir me féliciter.
– Monsieur Bach me dit-il, l’Allemagne vous sera à jamais reconnaissante pour cette œuvre, l’Allemagne et peut-être le monde entier. Avec Telemann et Haendel, vous êtes, monsieur, l’une des trois grandes gloires musicales actuelles de notre Allemagne et votre renom s’étend en Italie et en France.
J'avais l'impression d'avoir déjà entendu cette phrase…
***
Mais il ne fallait pas perdre de temps, car 15 jours après, à l'occasion de la Foire de Pâques, la Ville accueillait le Prince Électeur et Roi de Pologne, le Très Puissant Auguste le Fort. Il vint lui-même du 3 au 18 mai. Le sommet des fêtes données en son honneur était le 12 mai 1727, jour de son anniversaire.
Ce Prince faisait régner la prospérité sur le Pays et il aimait tous les plaisirs et en particulier les fêtes. Qui s’en plaindrait ? Leipzig connaissait une richesse extraordinaire. Les Foires étaient toujours plus importantes. On y voyait des gens du monde entier. Les occasions de fêter la paix, notre joie et notre santé devaient être aussi nombreuses que possible.
Tout le monde savait qu’à Cöthen j'avais eu pour fonction de faire de la musique presque uniquement pour le plaisir et les fêtes de mon cher Prince Léopold.
J’avais ainsi à Leipzig une solide réputation d’organisateur de fêtes en musique. Mes "amis" organistes Görner et Gerlach proposaient souvent de faire des musiques pour ces fêtes. Mais il se trouve qu'étant directeur de la musique et peut-être aussi à cause de mes modestes talents, c'était moi qu'on choisissait le plus souvent.
Il fallait donc pour le 12 mai organiser une grande fête. Monsieur Haupt avait pour l'occasion rédigé un poème que j'étais chargé de mettre en musique. Le titre était « Éloignez-vous, sereines étoiles ».
Autrement dit : quand arrive le Souverain, symbole de la lumière, du jour, du soleil, à ce moment les étoiles et donc la nuit sont chassées.
Le soir du 12 mai, on avait justement attendu la tombée de la nuit, après 8 heures du soir. Alors commença le grand défilé à travers toute la ville.
D'abord, il y avait les Anciens qui marchaient fièrement et s'éclairaient avec des flambeaux.
Suivait l'auteur du texte, Monsieur Haupt, portant l'exemplaire destiné au Souverain : le livre reposait sur un coussin de velours d'argent avec des franges d'or. Deux autres personnes le suivaient présentant chacune des parties du poème.
Suivaient après d'autres personnages de l'Université.
Suivaient plus loin mes musiciens, les trompettes et les tambours, comme toujours dans ces fêtes, qui rythmaient le défilé.
Suivait enfin le reste de l'assistance avec des flambeaux qui illuminaient les rues.
Pour protéger le Souverain, des soldats formaient, tout au long du cortège, une barrière humaine.
Au total plus de 300 personnes défilèrent ainsi.
Puis tout ce monde arriva à l'immense jardin Monsieur Apel. Là, je dirigeai, dans le recueillement et le respect dû au puissant Auguste le Fort, ma musique de fête. J'avais avec moi plus de 40 musiciens, plus nombreux encore que pour ma Passion selon Matthieu !
Tout ce monde revint ensuite vers le Collège de Paul où eut lieu l'embrasement général sous les vivats de la foule.
À la fin de la cérémonie, j'étais en train de discuter avec mes musiciens quand j'entendis dans la foule une voix :
– Monsieur Bach, Monsieur Bach !
Je me retournai : c'était Joachim Frédéric Fleming, le Gouverneur militaire de la ville, que j'avais déjà rencontré souvent, homme jovial et toujours prêt à rire, sauf quand il était en uniforme devant ses soldats.
– Monsieur Bach, je tiens à vous féliciter de votre musique de ce soir, c'était fort beau… mais je vous avoue que je suis content que le séjour de notre Souverain se termine bientôt : la sécurité, comprenez-vous, la sécurité, et s'il arrivait quelque chose ?
– Mais, Monsieur le Gouverneur…
– Appelez-moi Général : n’oubliez pas que je serai toujours d’abord un militaire, général de cavalerie…
Je pensais que devant le Prince…
– Appelez moi Général, vous dis-je. Vous disiez ?
– Mon Général, que voulez-vous qu'il arrive, tout le monde est heureux ici.
– Un militaire doit toujours être sur ses gardes monsieur Bach, dit-il en éclatant de rire. À propos, mon jeune frère Jacob est là. Lui se fait appeler Comte, Ministre et accessoirement Maréchal : c’est toute la différence entre nous, moi j’aime d’abord qu’on m’appelle Général…
– Le comte Fleming ? Mais…
– Oui, c’est bien lui, et il m’envoie vers vous car il vient de suggérer au Prince Héritier et à son épouse de vous rencontrer. Comme vous le savez, ils sont ici. Lui adore la chasse et tous deux adorent les Arts.
– Mais… mais, jamais je n'oserai… Moi, avec mes si modestes talents ?
– Allons, allons Bach, ne faites pas le timide. Depuis le temps : vous avez fréquenté assez de Princes pour savoir leur parler. Venez, suivez-moi…
Parmi tous ces grands personnages au milieu desquels j'avançais en suivant le Général Fleming, je vis un homme que j'avais connu autrefois chez le Prince Christian de Weissenfels, prince pour qui j'avais composé ma première musique de la Chasse. Cet homme était alors jeune page : il s’appelait Bruhl. Depuis, il était devenu un des plus hauts personnages de l'État, après le comte Fleming. Au passage je lui fis un sourire mais il fit semblant de ne pas me reconnaître.
Nous arrivions enfin vers le Prince Héritier qui était accompagné de son épouse, la Princesse Marie-Josèphe, fille de l'empereur d'Autriche. Le Prince Héritier devait avoir alors une trentaine d'années. Il avait le visage épais. La Princesse n'était pas très belle ; elle avait l'air d'une petite fille un peu triste d'être devenue femme.
Le Général Fleming s’approcha de son frère Ministre et lui dit à l’oreille :
– Tu vois, petit frère, je l’ai trouvé, notre Bach.
Il ne laissa pas le temps au comte de réagir et se tournant vers le Prince, il annonça triomphalement :
– Prince je vous présente notre Champion ! Monsieur Jean-Sébastien Bach, Maître de Chapelle du Prince de… de…
– Cöthen, lui soufflai-je
– De Cöthen, Directeur des Musiques de Leipzig et Cantor de l’Église de Saint Thomas
– Ah oui, dit le Prince, c'est lui qui, en présence de mon père, a vaincu ce français dans une bataille… en musique dont on a beaucoup parlé.
– Racontez-moi, dit la Princesse.
Je vis alors Bruhl se rapprocher de moi et me saluer ostensiblement comme s'il venait de m'apercevoir.
Le Général s'empressa de prendre la parole avant son frère. Il toussota, bomba légèrement le torse, prit une pause comme s’il commençait un grand récit :
– Eh bien, voilà, euh… cela se passait chez mon frère à Dresde, il y a bien… euh.
– Exactement 15 ans, dit son frère le Comte
– Il se trouve que Monsieur Bach, qui était à l'époque en poste à Hambourg…
– Non à Weimar, dit son frère le Comte.
– Bon, soit, à Weimar, Monsieur Bach était donc venu à Dresde. Il y avait là un Italien…
Nous avons alors entendu un bruissement de pas empressés, puis une voix tonitruante, sûre d’elle-même et dominatrice :
– Mais non, Monsieur le Général Gouverneur Fleming, ce n’était pas un Italien, c'était un Français, je me souviens fort bien de son nom : il s'appelait Marchand. J'aime bien ce nom de Marchand car il est pour moi, surtout ici, dans cette bonne ville de Leipzig, le symbole même de notre prospérité…
Tout le monde s'était tu : Auguste le Fort, Prince Électeur et Roi de Pologne, notre suprême Souverain s'était approché et avait parlé. Il était suivi de ministres et de dignitaires parmi lesquels je reconnus des membres du Conseil et du Consistoire de Leipzig. Près de lui se tenait une femme qui devait être une de ses maîtresses.
Après un temps d’arrêt, il continua en disant :
– Ce Marchand et Bach devaient rivaliser de virtuosité au clavecin. Figurez-vous que le français s'est enfui de Dresde au dernier moment ! Alors Bach nous a fait une si belle démonstration que tout le monde en était étonné et charmé. Je lui ai fait porter une bourse pleine d'or mais un de mes gredins de laquais s'est enfui avec elle, la trouvant sans doute fort bien garnie. Si on l'avait rattrapé celui-là, je l'aurais fait étriper, massacrer…
Je n'osai contredire le Souverain : son récit ne correspondait pas tout à fait à mon souvenir.
Puis il se tourna vers moi :
– Bach, dites-moi, au lieu de nous ennuyer en protestations sur vos problèmes de salaire, vous devriez nous faire un opéra. Vous seriez bien payé. Votre musique de ce soir, agrémentée de quelques airs plus légers et plus lestes, comme ceux de Hasse, ferait merveille… Pour moi, la musique c'est l'opéra.
– Sire, je ne suis qu'un musicien et pour moi, la musique, c'est la musique.
Un silence total et glacé gela tout à coup l'assistance. Le Souverain me regarda, surpris qu'on lui tienne tête.
Le Général Fleming toussota à nouveau et crut bon de dire :
– Sire, il a fait une très belle musique pour mon anniversaire !
– Je vous parle d'opéra et pas d'anniversaire, dit le Roi brutalement.
Silence à nouveau
Après un bref instant, le roi parla :
– Eh bien faites vos musiques, monsieur Bach, faites vos musiques. Elles conviendront sûrement mieux à ces deux tourtereaux qu'à moi, dit-il en désignant son fils le Prince Héritier et la jeune princesse.
Puis se tournant vers sa maîtresse :
– Nous, nous aimons autre chose, lui dit-il en souriant.
Elle se mit à glousser et ils nous tournèrent le dos, suivis du comte Fleming, de ses ministres et de ses dignitaires.
De ce souverain, on disait qu'il était impossible de compter le nombre de ses maîtresses et qu'il avait plus de 300 enfants…
Je restai donc là avec le Général Fleming, le Prince et la Princesse et… Bruhl, qui s'était approché dès qu’il avait vu le roi me parler, quand apparut un jeune homme fort bien mis qui se présenta en s’inclinant respectueusement devant le Prince Héritier :
– Prince, mon nom est Jean-Charles de Kirchbach. Prince, vous savez quelle vénération inspire madame votre mère parmi ses sujets de Saxe. Je suis un de ses admirateurs et voudrais vous demander de ses nouvelles.
– Relevez-vous monsieur. Eh bien…ma mère, actuellement, se sent un peu faible.
Nous avions pour la femme d’Auguste le Fort une sorte de vénération. Elle était luthérienne. Pour devenir roi de Pologne, son mari avait renoncé à notre religion, celle de Luther, et avait accepté de devenir catholique. Il avait demandé à sa femme de devenir catholique, comme lui. Elle avait osé refuser et tenir tête avec héroïsme au Souverain, préférant se retirer dans un château non loin de Leipzig. Ils ne se voyaient plus. Elle avait élevé son fils dans la pure tradition luthérienne. Malheureusement…
– Puis-je vous demander humblement de transmettre à madame votre Mère toute l'admiration du peuple de Leipzig.
– Je lui en ferai part, monsieur, soyez-en certain.
Je m'aperçus alors que s'étaient rassemblés autour de nous bon nombre de personnages de marque dont le silence et l'attitude respectueuse montraient combien ils approuvaient les paroles du jeune homme.
Quelques semaines plus tard, au début du mois de Septembre 1727, nous apprenions la triste nouvelle : notre Souveraine était retournée à Dieu.
Le deuil dura neuf mois, neuf mois durant lesquels aucune musique d’église ne fut jouée.
Sauf une cérémonie en l’honneur de notre Souveraine.
En effet quelques jours après l’annonce de sa disparition, Jean-Charles de Kirchbach vint me voir. Il me salua par ces mots :
– Monsieur, il y a deux hommes que je situe actuellement au sommet de leur art : pour la poésie c'est Gottshed et pour la musique, c'est vous, monsieur Bach. Je pense que pour notre Souveraine, nous avons avons le devoir sacré d’organiser une grande cérémonie : tout ce que Leipzig compte de Princes, de hautes personnalités, de nobles, d'étrangers, de chevaliers sera là pour célébrer cette femme sublime.
Tenez, voici le poème que Gottshed a écrit sur elle. Il sera imprimé par Monsieur Breitkopf et distribué à toute la foule. Je vous demande d'écrire sur ces paroles une musique digne d'elle et de nos sentiments à tous. Là-haut, près de notre Seigneur, elle entendra notre plainte, elle nous verra, figés près du royal tombeau, les yeux en pleurs, les lèvres gémissantes.
Ce jeune homme parlait avec une telle conviction que je ne pus que lui répondre :
– Et… et quand aura lieu la cérémonie ?
– Le 17 octobre, en l'église Saint Paul dans notre Université.
– Mais…
– Monsieur Bach, je me charge de tout et bien sûr vous serez défrayé de vos frais.
Moi aussi j’étais ému de la mort de cette Souveraine ! Je la connaissais depuis longtemps, depuis que je l'avais rencontrée à Carlsbad, l'année même où la mère de mes premiers enfants avait quitté ce monde.
Le texte de Gottsched me toucha profondément. Je me mis au travail et tout de suite les idées me vinrent en foule. Le rappel du temps qui fuit en évoquant les cloches funèbres de mon enfance. L'utilisation de sonorités d'instruments anciens. La plénitude d’une musique profonde adaptée au goût italien du moment…
Le jour de la cérémonie arriva. La procession me rappela dans son déroulement celle de l'anniversaire du Souverain. Mais ce jour-là, pour cette cérémonie à la mémoire de son épouse, Auguste le Fort n'était pas venu.
Les mêmes personnes défilèrent dans le même ordre, mais dans un silence dont les pierres elles-mêmes semblaient imprégnées. On entendait de loin l'orgue de l'église Saint Paul : mon ami Thiele en tirait des musiques merveilleusement tragiques. Dans l'église toute tendue de tissus noirs, on avait installé un catafalque sur lequel figurait un chronogramme de 1727, année de sa mort. C’est là que je dirigeai mon Ode Funèbre. J'eus la chance d'avoir pour interprètes de très nombreux étudiants attentifs et consciencieux.
Avec cette Ode Funèbre je voulais exprimer la profondeur de la peine éprouvée devant la mort d'une personne de haut rang. Je l’avais connue et j'admirais cette princesse avec ferveur. C’est pourquoi, quelques mois plus tard, lors des funérailles solenelles célébrant mon cher Prince de Cöthen, Léopold, mort à 34 ans, je repris certains éléments de cette Ode Funèbre ainsi que des extraits de Passion. J’allai à Cöthen avec Anne et Guillaume interpréter, chanter et diriger cette musique. Je repris aussi des parties de cette Ode Funèbre pour célébrer une autre mort, celle de notre divin Sauveur, dans ma Passion selon saint Marc.
La mort à nouveau venait rôder autour de moi.
La Souveraine nous avait quittés.
Mon bien aimé Prince Léopold de Cöthen était retourné à Dieu.
Ma sœur aînée mourut peu après à Erfurt : je restai le seul enfant vivant de mon père et de ma mère.
Quelques mois plus tard, j’eus l’immense douleur de perdre notre bien aimée Fridéléne, qui expira en souriant et en tendant les bras vers le Seigneur. Une petite Christiane née le premier janvier 1730, disparut trois jours après sa naissance.
Notre vieux Recteur de l'École, devenu à la fois un ami et un père pour nous tous, le cher Ernesti, rendit l’âme en octobre 1729, lui aussi dans la paix de Dieu.
Un office fut organisé pour célébrer la mémoire de celui qui avait si longtemps dirigé cette école et était devenu un ami (mais aussi dans mon esprit pour célébrer la mémoire de Fridélène et de tous ceux qui venaient de nous quitter). Lors de cette cérémonie, je dirigeai un motet pour deux chœurs à quatre voix.
Il se trouvait que pendant les quatre derniers mois de 1727, nous avions porté le deuil de notre Souveraine et qu’aucune musique n’avait été jouée à l’église. Ainsi je n’avais pas eu le souci des répétitions et des délais impératifs du dimanche ou des fêtes. J’avais ainsi pu travailler différents autres genres de musiques et en particulier certains motets.
Je mis un soin tout particulier à composer ou à parfaire ces motets. J’ai déjà dit l’importance que j’attachais à cette forme de musique. Mais je voudrais ajouter qu’en cette période de ma vie, je reprenais de plus en plus souvent certaines de mes œuvres. Dans ces motets, je voulais montrer tout ce que j’avais appris, depuis que j’étais enfant, depuis que mon cousin « Panier Percé » m’avait initié à la profondeur de ses compositions. Je voulais que ces motets soient les témoins de toutes mes connaissances, de toutes mes capacités, de tout mes talents. Chaque note, chaque suite de notes, chaque harmonie, la sonorité de chaque mot, avait une signification à la fois humaine et divine que moi seul connaissait. C’étaient autant de symboles, autant de clés de mon œuvre. Chacun pourrait prendre plaisir à découvrir quelques unes de ces clés : parfois ce seraient celles auxquelles j’avais pensé, parfois c’en seraient d’autres.
Il en est ainsi dans cette science mathématique à laquelle Guillaume, jeune élève à l’université, m’initiait : on y trouve des symétries imprévues, qui sont peut-être des clés qui nous sont montrées par Dieu pour nous faire découvrir les mystères de sa création.
Mais, dans ma musique, les symboles n’étaient pas l’essentiel.
L’essentiel était qu’avec ces motets j’abordais un monde ineffable.
J’éprouvais une joie sublime.
J’étais dans un état de totale harmonie.
Je souhaitais que ceux qui écouteraient ces motets partagent cette harmonie : c’était là le génie et la raison d’être de mon art. Était-ce aussi celle de mes collègues et amis musiciens ? Je n’osai leur en parler. Je craignais que le seul fait d’en parler ne vienne rompre cette harmonie.
Je célébrai par ces motets tous ces êtres chers qui nous avaient quitté et connaissaient désormais la félicité parfaite et éternelle. Moi, pauvre humain, je devais continuer à supporter ce monde.
Avec ces proches que j’aimais tant, disparaissait toute une époque de la vie
J’allais maintenant faire face à de nouveaux défis.
Je décidai donc de consacrer les premières semaines à la formation des élèves en reprenant et en adaptant d’anciennes musiques d’église que j’avais composées à Weimar.
Toutefois à la fin du mois de juin de cette année 1723, un mois à peine après mon intronisation, la mort de la femme du directeur de l’école Saint Nicolas vint contrecarrer mes plans. Il était de tradition de faire pour les personnages importants une cérémonie du souvenir, au cours de laquelle le chœur chantait à plusieurs voix, soit avec des instruments pour doubler certaines voix, soit sans instrument.
J’avais à peine quinze jours pour élaborer une œuvre de ce type, qu’on appelait un motet. Je connaissais bien cette forme de musique : on en chantait à tous les offices. Je n’en avais jamais composé qui soit vraiment achevé et dans le style que je souhaitais. Je me mis à la tâche en reprenant d’anciennes ébauches et ce fut passionnant. À chaque fois que je composais un motet, je me plongeais, je m’immergeais dans la conception de ces œuvres qui comportaient jusqu’à huit voix superposées, chacune suivant sa courbe, l’ensemble formant un tout dont la complexité envahissait totalement mon esprit. Je pouvais rester ainsi des heures dans cet état de création. Gare à celui ou à celle, fusse ma chère Anne, qui s’avisait alors de m’interrompre en entrant dans mon bureau. Rarement ai-je éprouvé le sentiment aussi fort d’entrevoir ce que peut être la perfection divine : je pensais dans ces instants me rapprocher de sommets inaccessibles.
Les répétitions de ce premier motet furent assez laborieuses. Même pour les meilleurs élèves, c’était un exercice difficile mais salutaire. Je pus ainsi leur faire comprendre ce qu’est une vraie discipline musicale. Il se trouve que j’avais alors un premier chœur formé d’élèves dont la plupart étaient assez doués. En les faisant travailler, j’obtins à peu près ce que je voulais. La cérémonie fut un succès et je fus chaleureusement remercié.
Dès la fin du mois de juillet de cette année 1723, je pus recommencer à composer une série de musiques religieuses avec chœur, récits chantés et airs variés ou cantates pour chaque dimanche de l’année. Je voulais absolument tenir ma promesse de donner une nouvelle musique ou un nouveau concert d’église chaque semaine. Je travaillais avec joie et ferveur à la plus grande gloire de Dieu par ma musique !
Je conçus des musiques totalement nouvelles.
Ainsi, pendant cette première période à Leipzig, selon mon inspiration, parfois je supprimai toute référence à des thèmes de chorals dans les chœurs et les airs. Parfois au contraire le thème d’un choral m’inspirait particulièrement 𝄐.
Je voulais surtout affranchir mes musiques d’habitudes du passé et y mettre plus de profondeur.
***
Ardeur et Joie.
Ardeur à chercher et à combiner des textes de la Bible et de Luther bien sûr, mais aussi, selon l’office et le sermon du jour, des écrits religieux récents incitant les fidèles à la réflexion sur le péché, la vanité du monde, le salut par le seul Christ et bien d’autres aspects de notre religion. Je choisissais ces textes avec l’accord des pasteurs : l’accord du pasteur de l’église Thomas, Christian Weiss, m’était toujours acquis ! Il était d’autant plus ravi de discuter avec moi que depuis plusieurs années le Seigneur l’avait privé de l’usage de la voix ce qui l’empêchait de faire des sermons ! Il ne pouvait parler qu’avec une voix basse et rauque. Son second, l’archidiacre était le frère de Régine Ernesti qui venait souvent nous voir. Avant leur publication, Salomo Deyling, le superintendant, exigeait lui aussi un contrôle de ces textes. Je veillais à ce que des copies en soient distribués aux fidèles plusieurs semaines avant le jour où la musique était jouée. Il est impossible de comprendre ma musique d’église sans lire en même temps les textes !
Joie de composer des musiques qui me venaient souvent à l’esprit comme des évidences. Mais c’était là le fruit d’un travail acharné et d’une réflexion incessante, menés depuis plus de 30 ans, avec l’aide de Dieu, de mes élèves, de ma famille et des instrumentistes.
Il arrivair que ma musique exprime (faut-il l’avouer ?) mes propres sentiments. Alors elle devenait ma confidente et traduisait ma tendresse, ma lassitude, mes soucis, mes colères, la maladie, le sommeil, l’amour, le désir de la mort… Je pensais être alors le seul à exprimer en musique mes propres émotions. Les musiques des autres me faisaient l’effet de descriptions de sentiments venus d’ailleurs plus que du fond d’eux-mêmes.
Joie, dans les chœurs en particulier, de faire surgir des harmonies, des constructions, des architectures, des thèmes, des chiffres, des correspondances, des symboles, des alternances que je n’avais entendu jusque là chez aucun autre musicien, puis de les mettre ensuite sur le papier : ils exprimaient la splendeur de Dieu et la misère des hommes.
Joie, dans les arias, d’utiliser souvent des formes de musique à la mode, en introduisant par exemple des rythmes de danse, ce qui me permettait d’exprimer une mélancolie, une gaieté, bref une joie de vivre pour la gloire du Seigneur bien dans l’esprit de Martin Luther.
Joie de donner aux récits chantés une expression musicale parfois un peu… théâtrale (mais oui !) par des descriptions instrumentales (le rire, le vent, le temps, la cloche de mon enfance, l’orage…).
Je demanderai au lecteur avant de poursuivre sa lecture d’écouter les musiques d’église que je jouai en 1723 et 1724. Il comprendra mieux qu’avec tous les mots du monde toute mon ardeur créatrice pendant cette période. J’avais l’impression que tous ceux que j’aimais et qui travaillaient auprès de moi y participaient et l’appréciaient, même si leur talent parfois était loin d’être parfait.
***
Dès le mois d’août 1723, j’eus l’occasion de composer par deux fois de grandes musiques officielles. La première fut chantée en latin à l’université au début du mois pour l’anniversaire d’un prince, l’autre le 24 août, le jour de la saint Barthélémy, qui était celui de l’élection du conseil municipal : cette année là Monsieur Steger succédait à Monsieur Lange comme Bourgmestre, qui avait contribué à mon élection comme Cantor.
Ces musiques avec chœurs et trompettes me valurent des félicitations de toutes parts : tout le monde aimait beaucoup cela, mais ce n’était pas le genre de musique que je préférais composer.
***
Avant de raconter les soucis que j’eus en cette fin de 1723, je voudrais parler de ma rencontre avec un personnage dont je ne savais pas qu’il allait plus tard tenir une grande place dans ma vie de compositeur de musique chantée, aussi bien pour l’église que pour les fêtes et anniversaires profanes.
Un dimanche du mois d’août, je crois, comme je m’apprêtai à quitter l’église avec mes fils après l’office, je vis s’avancer vers moi un jeune homme d’une vingtaine d’années, plein de déférence :
– Monsieur le Cantor, je ne veux surtout pas vous déranger, vous connaissez peut-être mon nom et peut-être avez-vous lu…
– Que puis-je pour votre service, monsieur… monsieur
– Mon nom est Henrici, Chrétien Frédéric Henrici, cela vous dit quelque chose ?
– À vrai dire, non… vous êtes italien ?
– Non, non pas du tout. Je suis né près de Meissen.
Que me voulait donc ce jeune homme, à me raconter ainsi sa vie ? Il y eût un silence. Mes deux garçons jetaient des regards furtifs et moqueurs sur cet homme qu’ils ne connaissaient pas. Il nous regarda encore puis, comme s’il se jetait à l’eau, il dit d’un ton rapide :
– Voilà… monsieur Bach… j’ai entendu vos œuvres… j’ai… j’ai… lu les livrets des textes des musiques d’église qui sont distribués aux fidèles, j’ai, enfin, je… moi-même j’écris aussi des textes.
– Ah oui, dans quel domaine ?
– Un peu de tout, des articles, des histoires, des poèmes religieux, et, depuis que je suis au service de Monsieur Koch… Vous connaissez monsieur Koch ?
– Ce nom me dit quelque chose…
– C’est un marchand, il est très riche… Oui, je donne des cours à son fils… C’est un jeune homme à qui il me faut apprendre beaucoup… Mais et je vous ennuie avec mes histoires, monsieur le directeur… Tenez je vous ai amené…
Puis il se mit à sortir de la poche de son pourpoint une feuille de papier qu’il commença à déplier. Un coup de vent soudain… et son manuscrit s’envola. Nous voilà tous les quatre en train de courir après le document volant. Guillaume fut le plus rapide : il l’attrapa et le rapporta, un peu froissé. Je ne sais pourquoi, mais je trouvai en cet homme, avec sa gaucherie et son bavardage, quelque chose qui m’attendrit.
– Allons jusque chez moi, monsieur, vous me…
– Monsieur c’est me faire trop d’honneur…
Il remit le document dans sa poche et nous suivit. En arrivant à la maison, je dis aux garçons :
– Guillaume et Emmanuel, allez donc voir votre mam…, allez voir Anne. Moi, je vais monter avec monsieur dans mon cabinet de travail.
Je montai l’escalier tout droit, comme toujours avec une sorte de recueillement. À chaque fois, c’était comme si je me rapprochais un peu du Seigneur. Là haut, au 1er étage, il n’y avait plus que Lui, Moi et la musique… Ce jour-là, la pièce était inondée de soleil. Elle comportait deux fenêtres: de l’une, qui donnait au sud, on pouvait voir la rue et la maison Bose, et de l’autre, qui donnait à l’ouest, on apercevait le mur de la ville, la rivière, le petit pont, puis les champs qui s’étendaient à perte de vue.
Henrici entra dans la pièce sur la pointe des pieds, comme s’il voulait ne pas faire de bruit. Il se mit à parler en chuchotant, tout bas et très vite, en me montrant son papier froissé.
– J’ai écrit ce poème après un incident de chasse qui s’est passé récemment chez Monsieur Koch, à Niederglaucha près de Düben, (c’est là que monsieur mon Maître a son domaine de chasse). J’ai cru tirer sur un oiseau, une pie ou un pic, mais je ne sais comment, j’ai atteint un paysan qui passait par là. J’ai été arrêté par les soldats. Depuis on me surnomme « pic-autre » ou confond-pie, en allemand « Picander ».
Je retins un sourire.
– Cela nuit à ma réputation et m’attriste énormément. Alors je me suis mis à écrire encore plus qu’avant et en particulier des textes religieux…
– Et le pauvre homme ?
– Ah oui, comme vous me comprenez, monsieur Bach.
– Ce n’est pas de vous que je voulais parler mais de ce paysan que vous avez blessé… enfin ça ne fait rien.
– Oui, monsieur Bach, je fais des poèmes, comme celui-ci, écrit comme je vous le disais après cette malheureuse chasse qui m’a inspiré ceci… écoutez…
Il me regarda, hésitant, puis se mit à lire :
– Tout comme un cerf qui brame quand il veut de l’eau fraîche, ainsi je crie, mon Dieu, vers toi
Il continua sa lecture et il le faisait sur un tel ton de sincérité que je me laissai bercer par les mots : pourquoi ne pas utiliser ce texte ? Après tout je puisais depuis longtemps dans les mêmes recueils les textes de mes musiques d’église: ceux de Lehms ou de mes amis Neumunster et Franck ou de quelques autres.
Pourquoi toujours prendre des textes existants et les mettre en musique sans vraiment les modifier ? Pourquoi ne pas demander à des gens qui écriraient sur place, auprès de moi, et ce qui me permettrait de changer leurs mots en fonction de ma musique ?
– Monsieur Henrici, pouvez-vous me prêter votre manuscrit ? Revenez me voir jeudi après-midi, c’est le jour où je n’ai pas de cours et nous pourrons discuter.
– Monsieur Bach, c’est pour moi un immense…
Le jeudi suivant, j’entendis sonner. J’étais dans mon bureau, au second étage. J’allai voir par la fenêtre qui était là. Je reconnus Henrici et criai :
– Montez, monsieur Henrici.
Je pouvais ouvrir la porte depuis mon cabinet grâce un système de bobinette qui n’était pas sans me rappeler certains mécanismes de l’orgue. J’accueillis Picander dans la pièce du bas où étaientt le clavecin et la grande table. C’est là que mes fils et mes élèves travaillaient à copier des partitions.
– Guillaume, mets-toi au clavecin et toi Jean-André, tu vas chanter (Jean-André était le petit fils de Kuhnau). Moi je jouerai du violon.
– Oui papa,
– Oui maître,
– Avez-vous terminé de copier le premier air ?
– Oui.
– Alors allons-y ! Six croches par mesure 1,2,3,4,5,6
Henrici écoutait, médusé.
– Alors qu’en pensez-vous ? Monsieur Henrici.
– Votre musique…
– J’ai un peu modifié votre texte mais la musique, enfin… les idées sont là. Venez là-haut avec moi.
Nous avons discuté longuement ce jour-là. Nous nous entendions à demi-mot. Il comprenait la raison des modifications que j’avais faites à ses textes.
Le ciel était clair : par la fenêtre, nous pouvions voir le soleil se coucher.
…Puis j’ai oublié Henrici.
***
Comme je le disais, c’est à cette époque que je connus quelques difficultés, en particulier quand, peu après début septembre 1723, je reçus ma paye. Je la montrai à Anne.
– Anne vois-tu ce que je vois ?
– Qu’y a t’il avec cette paye ?
Elle dit cela sur un ton agacé qu’elle avait très rarement. En fait elle était moins concernée que moi par les problèmes d’argent car elle n’avait jamais connu le vrai manque d’argent.
– Regarde, ils ne m’ont donné que 6 florins pour mon service à l’Université. Ça fait la moitié de ce qu’ils me doivent. C’est un coup de Görner : ce type est un envieux. Il se prétend compositeur : mais c’est un médiocre tant comme compositeur que comme organiste. J’en sais quelque chose, je l’entends souvent à l’église Saint Nicolas… Sous prétexte qu’il est aussi organiste à l’église de l’Université, il se croit tout permis. Dès le début, il s’est posé en concurrent vis-à-vis de moi. Tiens, je parie que c’est lui qui a dû demander… et obtenir l’autre moitié.
– Allons calme-toi,… tu es injuste, l’autre jour tu en disais du bien : après tout avant que tu n’arrives, il avait la charge la musique de l’Université
– Comment ? Tu prends son parti ?
– Mais non, mais non, ne te mets pas en colère pour si peu: six florins sur les 700 que tu gagnes par…
– Comment c’est très peu ? Mais Anne, tu oublies que mon salaire fixe n’est que de 100 florins (50 000 F) par an et que tout le reste ce sont ces « si peu » dont tu parles. Ah non, ça c’est trop fort. Même toi… Eh bien je vais écrire au Bourgmestre.
– Ne fais pas ça, tu sais bien que ce n’est pas de son ressort.
– Bon, alors je vais écrire au Conseil de l’Université… Je vais leur dire ce que je pense… et qu’il faut que justice soit faite. Je ne tolérerai pas cela… jamais je ne lâcherai… Je suis aussi directeur de la musique à l’Université. Tu vas voir… Tu ne m’as jamais vu vraiment en colère…
– Jean-Sébastien ! Calme-toi… je vais t’apporter ta pipe.
Elle se leva et eut une légère faiblesse. Je me précipitai vers elle :
– Anne, Anne, mais qu’as-tu ?
– Je… Je… Je… Je ne suis pas complètement sûre… mais je crois que je suis enceinte !
Ma colère tomba d’un coup, je me sentais vaguement ridicule. Ces trois je… je… je… me résonnèrent dans la tête. En fait je me souvins que je venais de les réutiliser au mois de juin dans une de mes musiques d’église : « Je… Je… Je… J’avais bien des tourments ». Je regardai Anne tendrement… Je l’aidais à monter dans notre chambre.
Quand elle se fut endormie, je me glissai hors du lit et j’écrivis ceci sur une feuille blanche qui restait inutilisée :
Quand je prends ma pipe
Remplie de bon gros tabac
Pour passer un moment agréable,
elle me fait voir une image de deuil
et y ajoute cette leçon
que je suis tout pareil à elle
La pipe est d’argile et de terre
Dont je suis fait également
Moi aussi, je retournerai à la terre
Elle tombe sans crier gare
S’est brisée souvent dans ma main
Mon destin est comme le sien
Je glissai la feuille sous son oreiller.
Le lendemain matin Anne vint me voir avec le papier à la main. Elle dit d’un ton un peu las :
– C’est bien joli, mais c’est un peu triste.
– Je te promets qu’un jour je te ferai un menuet sur ces paroles.
La réponse à ma lettre à l’Université arriva quelques jours après, fin septembre. On me répondait que j’avais fait ma demande trop tard. J’étais découragé. Je ressentais toute la profondeur de la pensée de Luther. Oui, il y avait bien deux univers en moi, deux univers bien réels : d’un côté il y avait l’univers de mes relations quotidiennes au monde, à ce monde de peines, de soucis, d’argent, de péchés et de joies éphémères, ce monde d’attente de la mort, et d’un autre côté il y avait l’univers de la musique, de la création, de l’ineffable et de la gloire de Dieu.
Dans le premier univers je rampais maladroitement, hargneux, teigneux, exaspéré et exaspérant. Vers l’autre je volais irrésistiblement dans un immense et indicible ciel de joie et j’essayais d’y entraîner tous ceux que j’aimais.
La réponse de l’Université à ma lettre me consternait…Et, curieusement, la nouvelle de la venue d’un nouvel enfant, le second d’Anne, qui aurait dû me remplir de joie, m’inquiétait, ce qui n’avait jamais été le cas pour les autres…
Je savais que parfois, devant l’adversité, je pouvais sombrer dans une telle mélancolie que le désir même de la mort et du désespoir pouvait m’envahir. Et ce fut le cas, quand j’appris une autre mauvaise nouvelle : le règlement de l’école allait être modifié avec comme conséquence une diminution de mes salaires. Je vis alors tout en noir : j’étais ruiné, mes enfants mendiaient,dans les rues, les épidémies et la guerre revenaient…
En cette fin de 1723, je manifestai mes sentiments dans plusieurs musiques qui étaient d’une brève intensité et montraient ma hargne, ma colère et ma mélancolie. A part moi qui pouvait le comprendre ? Anne, peut-être s’en doutait. Mais Guillaume lui, ne s’y trompait pas.
Un soir, tard, comme la nuit était tombée, et que tout était silencieux, j’étais en train de travailler dans mon cabinet de travail. Je mettais la dernière main à un air pour alto. La chandelle jetait une lueur vacillante sur mes papiers et mes livres. Par la fenêtre, je pouvais voir la campagne éclairée par la triste lumière de la lune. Tout me semblait triste. J’avais du mal à retenir mes larmes. J’entendis très nettement un petit frottement sur ma porte fermée, puis ce frottement se répéta sous la forme d’un petit coup. J’entendis alors une petite voix (qui n’avait pas encore mué) :
– Père, père…
J’essuyai machinalement mes yeux, pris la chandelle, me levai et allai ouvrir la porte.
– Père, Père, regarde… mais qu’est ce que tu as ? Ton visage est comme le jour de la mort de maman ! Père, père…
Je pris Guillaume dans mes bras sans pouvoir dire un mot. Ces mots : père, père et la façon dont mon fils les avait prononcés restèrent à jamais gravés dans ma mémoire. Ce mot de père…
– Père, je n’arrivais pas à dormir.
– Mais Guillaume, il faut que tu dormes…
– Père, tu as l’air si triste en ce moment. Alors je t’ai amené un poème que m’a montré Régine Ernesti. Tu sais que son père aimait beaucoup faire des sermons sur les artisans ?
– Oui, je le sais, mon fils.
– Eh bien ce texte a été écrit par un cordonnier de Nürnberg, qui s’appelait Hans Sachs. Et comme la semaine dernière, pour le 14ème dimanche après la Trinité, tu as choisi de parler des médecins…
– Comment cela ?
– Oui tu te souviens bien de ce texte si triste ? Tiens, montre moi la partition !
Mon fils me fit une telle impression que sans rien dire j’allai chercher les feuillets.
– Tiens, écoute : alors que l’Évangile nous parlait de la guérison de lépreux par Jésus, ce qui est plutôt gai, voici le triste texte que tu as choisi: "Le monde est comme un hôpital, où les humains innombrables et aussi les enfants au berceau sont terrassés par la maladie : l’un sent dans sa poitrine la chaude fièvre de l’envie, …un autre est rongé par l’argent… car le péché a souillé tout le monde. Ah ! ce poison pénètre aussi dans mes membres. Où est le médecin qui m’aidera ?"
Père, je comprends que tu sois triste: moi aussi, il m’arrive d’être triste. Alors la musique me console. Quand je suis triste, c’est la musique triste qui me console. Et alors je reprends espoir.
J’étais sidéré que cet enfant soit aussi proche de moi.
– Père je me disais donc que comme tu as parlé des médecins, tu pourrais prendre le texte de cet artisan de Nürnberg, Hans Sachs. Voici ce texte :
"Ah ! je suis pauvre et de gros soucis m’oppressent. Du soir jusqu’au matin ! …Qui me libérera de ce monde si… méchant ? La misère est autour de moi. Ah si seulement j’étais mort ! Dieu traite correctement les animaux… moi, je ne sais pas comment me procurer un morceau de pain ! Ah vous, les soucis, chaque matin, chaque jour, vous revenez".
Et maintenant, écoute, Père, voici l’espoir qui revient :
"Le monde entier peut me haïr, je lance mes soucis à mon Seigneur. S’il ne m’aide pas aujourd’hui, il m’aidera bien demain : mes soucis, je les mets sous l’oreiller. Vous, mes soucis, je vous demande le divorce : alors je pourrai aller vivre comme au ciel !"
Ce texte me séduisit tout de suite. Les pasteurs l’apprécièrent aussi.Pour le traiter en musique, j’eus l’idée de revenir aux formes archaïques que j’avais utilisées autrefois, ce qui marquait mes doutes face à l’avenir.
Je montrai souvent mon travail à mon fils Guillaume. Il fut enchanté quand pour le 22° dimanche après la Trinité, le 24 octobre 1723, j’utilisai des passages qui évoquaient les problèmes financiers (l’artisan usurier ?):
"Il me manque beaucoup, ce que je veux avoir est tout à mon profit
Toi, juste Dieu, est-ce que tu comptes ?
Vous pressez vos débiteurs, la vengeance doit s’allumer.
Ah ! Mets la somme à mon compte'..
Mais le fonds de ma mélancolie fut atteint, je crois, quand je mis en musique, sans même en parler à Guillaume, le 21° dimanche après la Trinité, le 17 Octobre, mes doutes en choisissant ce texte : " La main du Père… me viendra en aide : mais non, j’enfonce dans la terre devant les soucis et je tombe au sol avec eux… Le Très Haut n’entend pas les pêcheurs".
Heureusement j’avais Guillaume, heureusement, dans ces périodes de mélancolie, j’avais tous les miens car je suppose que dans la solitude, je serais devenu triste et inerte, un peu comme le serait mon pauvre fils qui allait naître quelques mois plus tard et dont Anne était enceinte. Mais je n’avais pas le temps d’être seul : la solitude est un luxe accessible aux nobles ou aux jeunes hommes (comme moi autrefois à Arnstadt) et aux vieillards.
J’avais autour de moi Anne, mes enfants, mes élèves, mes disciples, tous ceux qui avaient fait de la musique leur métier et venaient chez moi quand ils passaient à Leipzig.
On venait de bien loin pour me voir : on appréciait mes qualités d’organiste, d’instrumentiste et de musicien et j’en étais heureux. Je remerciais le ciel de m’avoir donné ces dons et cette capacité à les travailler. Cela me donnait aussi l’occasion de faire la connaissance de gens souvent fort agréables, presque toujours intéressants. J’avais aussi en permanence sur place une dizaine d’élèves privés. Ils participaient à la vie de la maison : les copies à organiser, les enfants à éduquer ou à soigner, le courrier à écrire. Tout mon petit monde mettait la main à la pâte.
Les élèves de l’École de Thomas n’avaient pas toujours la vie facile : pour dormir, ils n’avaient en général qu’une seule paillasse pour deux ou trois, ils ne mangeaient pas toujours à leur faim, et en hiver ou en cas d’épidémie, ils tombaient souvent malades. C’est à la fois avec envie et admiration que l’on considérait la partie du bâtiment où nous habitions, avec sa chaleur, sa joie de vivre et ses allées et venues constantes, reflets des heurs et malheurs de la vie.
Les autorités savaient tout cela et, à défaut d’apprécier ma conduite, avaient à cette époque pour moi une certaine indulgence. De plus, ces messieurs savaient que j’avais une grande réputation en tant qu’organiste et en tant que musicien. J’étais d’ailleurs souvent convié à expertiser des orgues nouvelles qui se construisaient dans la région. C’est ainsi qu’au début du mois de novembre : je me souviens, c’était un mardi, j’eus une grande joie, grâce au recteur Ernesti.
Comme le lecteur l’aura remarqué, Ernesti, le vieux recteur de l’école de Thomas, avait pour moi beaucoup de gentillesse. Nous avions souvent l’occasion de nous voir, et j’ai même l’impression qu’il recherchait ma compagnie :
– Bach, je vous fais une totale confiance en ce qui concerne la musique. Vraiment Kuhnau avait raison de vous apprécier ! Mais essayez tout de même de satisfaire aussi à vos obligations de professeur.
– Mais je ne peux pas perdre mon temps à donner des leçons à des enfants qui n’ont aucun don ! Je préfère faire travailler les meilleurs pour qu’ils arrivent à chanter les chœurs que je compose !
– Il est vrai que vous leur faites faire des prouesses. Kuhnau se plaignait toujours de voir le nombre d’élèves et le niveau musical diminuer, ce dont il m’attribuait bien sûr la responsabilité ! Eh bien je suis sûr qu’il aurait été heureux d’entendre le résultat de votre travail en quelques mois. Mais Bach, montrez-vous un peu arrangeant avec les autres élèves et nos dirigeants de la ville.
– Comment ? Avec des gens qui ne tiennent pas leurs engagements ?
– Écoutez, Bach. De nos jours, dans l’enseignement, tout le monde n’apprécie pas la musique autant que moi. Je suis de la vieille école : vous vous rendez compte que je suis là depuis bientôt quarante ans ? Moi je pense que la musique est la meilleure formation.
– Et d’autres… ?
– …considèrent que le droit, les sciences et tout cela est plus important.
– Monsieur le Recteur, j’ai une immense faveur à vous demander… Je voudrais… Enfin, on m’a demandé…
– Mais dites… monsieur Bach
– Eh bien voilà, vous savez que l’église de Störmthal est en réparation ?
– Ah non… euh… attendez, je vais demander à ma femme. Régine… Régine…
– Oui, qu’y a t’il, Jean-Henri ?
Régine entra : elle était beaucoup plus jeune que son mari. On disait qu’il l’avait épousée quand lui avait plus de 40 ans, alors qu’elle était loin d’avoir 20 ans. Régine Carpzov avait l’air un peu austère : elle était sans doute bien la fille de son père, qui avait été pasteur à Saint Thomas et était réputé dans toute la Saxe pour sa rigueur dans notre foi luthérienne, mais aussi pour son originalité. C’est lui qui, pendant toute une année, chaque dimanche, avait fait des sermons sur les différents types d’artisans. Quand on connaissait bien sa fille Régine et qu’elle était en confiance, elle devenait une femme pleine d’esprit.
– Ma chère, dit le Recteur, vous qui savez toujours tout, savez-vous qu’à Störmthal…
– Il n’y a que vous, Jean-Henri, pour ne pas savoir ça ! Je sais même qu’on cherche quelqu’un pour expertiser le nouvel orgue construit par Monsieur Hildebrandt et pour organiser la musique de l’office.
Elle dit cela en me regardant avec un sourire appuyé. Et je crois même savoir que certains amis de monsieur Bach…
– Pardonnez-moi de vous interrompre, madame, dis-je tout d’un trait, mais je voulais justement demander à Monsieur le Recteur de m’accorder la permission d’aller à Störmthal pour expertiser l’orgue et pour emmener le premier chœur et les instrumentistes. Nous pourrions y jouer une de mes musiques.
– Mais Bach, il n’en est pas question, vous avez votre office à assurer le dimanche.
– Mais Monsieur le Recteur, cela ne se passera pas un dimanche mais un mardi.
– Dans ce cas, Jean-Henri, dit Régine, je n’y vois que des avantages. Notre Cantor est mis à l’honneur et nos choristes sortent un peu de leur école !
– Mais que vont dire les autorités de l’église de Thomas ?
– Ne vous inquiétez pas de cela, vous savez bien que mon frère y est archidiacre et que notre ami Christian Weiss, le pasteur, est hors d’état de parler depuis quatre ans.
– Dans ce cas, je me rends, dit le recteur Ernesti.
– Et vous pourrez ainsi entendre Anne chanter en public !
– Comment, vous feriez ça ? Vous savez qu’à Leipzig les femmes ne sont pas autorisées…
– J’ai demandé au pasteur Fischer…
– Ah oui, le pasteur Fischer : c’est lui qui exerce actuellement à Störmthal ! Je me souviens bien de lui… Il avait écrit une thèse quand il faisait ses études ici, sur le fait de savoir si on pouvait imiter les apôtres…
– Et il est tout à fait favorable à ce qu’Anne vienne chanter.
– Mais Anne est enceinte, dit Régine, elle ne doit pas…
– Au contraire, elle ne rêve que de cela. Et d’ailleurs pourquoi les femmes enceintes ne pourraient-elles pas chanter à l’église ? Peut-être vos universitaires pourraient-ils écrire une thèse là dessus ?
Je devais avoir l’air furieux… Des images confuses me remontaient à la mémoire du temps où je chantais avec une jeune fille dans l’église d’Arnstadt…
– Oh monsieur Bach, ne vous moquez pas de l’université ainsi ! dit Le Recteur Ernesti sur un ton très sérieux. Je crois qu’effectivement ce serait un sujet intéressant.
– Mais vous-même, Madame Ernesti, qu’en pensez-vous ? Des femmes enceintes peuvent-elles chanter à l’église ?
– Oh moi… eh bien… je pense que Martin Luther ne s’y serait pas opposé !
– Bien, dis-je soulagé.
Il y eut un silence, comme si plus personne ne savait quoi dire. Je pris mon courage à deux mains.
– Monsieur le Recteur, je voudrais vous demander une faveur.
– Que voulez-vous encore ? Aller jouer à Berlin chez le Roi de Prusse ?
Il avait dit cela comme une chose tout à fait inconcevable, lui qui n’avait pas quitté Leipzig depuis quarante ans.
– Non, non, rassurez-vous ce n’est pas cela. Ce que j’ai à vous demander vous concerne beaucoup plus directement.
– Ah oui et qu’est-ce donc ?
– Eh bien voilà, monsieur le Recteur, accepteriez-vous d’être le parrain de l’enfant qu’Anne porte en son sein ?
– Oh vous savez, Bach, moi je suis trop vieux, ce ne serait pas un bon service à rendre à l’enfant
– Oh ! Monsieur le Recteur…
– Allons Bach, pas de faux semblants entre nous. Approchez-vous, je voudrais vous dire un mot.
Puis, il me chuchota à l’oreille
– Je suis sûr que Régine…
– Mais bien sûr, dis-je tout haut, j’en serais très honoré et Anne aussi, j’en suis sûr… Madame Ernesti, vôtre époux propose que vous soyez marraine de l’enfant qu’Anne porte.
Régine Ernesti ne trouvait plus ses mots :
– Oh Monsieur Bach… Comme c’est gentil à vous. Mais je n’accepterai que si votre épouse accepte…
– Je vais chercher Anne…
Juste à ce moment, on cogna à la porte, c’était justement Anne. Elle était resplendissante : avec ses 22 ans, elle paraissait parmi nous trois comme une enfant… Elle accepta avec joie. Les deux femmes s’embrassèrent.
– Et savez-vous quoi ? dit Anne de sa voix claire. Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule !
– Non
– Eh bien, je vais chanter à Störmthal…
J’étais confus. Je venais à peine de demander au recteur si je pouvais aller à Störmthal… Mais un regard entre le recteur, sa femme et moi et tout le monde éclata de rire devant Anne éberluée…Et c’est ainsi que par une belle journée d’automne 1723, quelques temps après avoir fait l’expertise du petit orgue de Störmthal, situé à deux heures de marche de l’école, je dirigeai une des musiques d’église que j’avais composées au temps où j’étais à Cöthen. Anne chanta très bien.
Après ce charmant intermède, la vie habituelle reprit à Leipzig. Ma mélancolie avait fait place à de la hargne. Décidément, cette histoire de salaire à l’université ne passerait pas comme ça. Je ne voulais pas m’avouer vaincu. Je n’ai jamais songé à m’avouer vaincu. Passé le premier découragement, les plus grandes difficultés, les paris apparemment impossibles, les obstacles insurmontés, me donnent une énergie farouche : je m’y incruste, j’y adhère, je m’y accroche, je ne lâche pas prise. D’où cette réputation d’opiniâtreté et d’entêtement, dont je m’accommode d’ailleurs fort bien.
Il ne restait plus que quelques semaines avant le temps de Noël, si bien que je décidai de ne plus créer de nouveau grand chœur, ce qui était à chaque fois un travail considérable. J’avais entrepris en effet de composer pour le mois de décembre une œuvre sur le texte de la prière du Magnificat. J’aimais beaucoup cette prière du Magnificat : Marie la dit pour remercier le divin Créateur au moment où elle apprend qu’elle attend un fils qui sera Jésus, le fils de Dieu. Alors elle court dans la montagne annoncer la nouvelle à sa cousine Elizabeth. Marie, la Mère par excellence, chante la gloire et la puissance de Dieu. Quand je fermais les yeux et que je me représentais la scène, cette Mère de Dieu avait toujours le visage de ma propre mère. Je portais en moi tant de hargne, tant d’ardeur, tant d’énergie, tant de zèle que je tentai par ma musique d’en exprimer les forces d’éternité. Des idées surgissaient sans cesse pour ce Magnificat dont je sentais les tressaillements en moi ! J’étais comme Marie dans une sorte de travail d’enfantement.
Tout ce travail et cette rage firent qu’au moment où se réalisèrent les mauvaises nouvelles annoncées et qui m’avaient tant tourmenté (nouveau règlement, diminution de salaire, non-paiement de mon dû pour l’université etc…), je n’en fus pas impressionné. Ainsi, quand le nouveau règlement fut publié, j’envoyai simplement et comme automatiquement, une protestation. Ce n’est pas pour autant que je n’avais pas l’intention de continuer à me battre.
Pour moi, quand les choses prévues arrivent, elles appartiennent déjà au passé : c’est exactement ce que j’éprouve quand j’improvise. Au moment où je joue les notes sur le clavier, elles appartiennent déjà au passé car je pense déjà à ce moment, à celles que je jouerai plusieurs dizaines de secondes après.
Avant le grand jour du Magnificat, je rendis visite au prince de Cöthen pour son anniversaire, en décembre. Cette visite devenait pour moi une sorte de tradition. Je me contentai de prévenir le recteur de ce voyage sans lui demander désormais l’autorisation de partir. Je n’aimais pas me sentir contraint ainsi dans mes voyages ou mes absences. Le prince Léopold, encore mal remis de la mort de sa femme, entouré de l’affection de sa mère, n’avait d’yeux que pour sa petite fille qui commençait à marcher et à parler. Il prit la peine de s’inquiéter de ma vie à Leipzig et regretta le temps passé. J’avais l’impression d’avoir quitté Cöthen depuis des années.
Autre bonne nouvelle et qui me remplit de fierté. L’inscription de Guillaume à l’Université. Bien sûr dans mon impatience, je m’y étais peut-être pris un peu en avance (plusieurs années), mais il était inscrit.
Et puis il y avait la satisfaction que me donnait mes bons élèves comme Wagner, que j’avais formé au violon, au clavecin et aussi à la composition et qui devait rester avec moi encore deux ans.
Enfin arriva le jour tant attendu de ce Magnificat que j’avais fait beaucoup travailler à mes élèves. C’était le jour de Noël, 25 décembre 1723. Tout se passa bien. À la fin, je vis mon petit Emmanuel venir vers moi, l’œil brillant d’excitation :
– Père, crois-tu qu’un jour je pourrai faire une aussi belle musique ?
J’entendis derrière moi une voix de fausset qui cherchait à imiter la mienne :
– Oui, mon fils, si tu travailles autant que moi.
C’était la voix contrefaite de Guillaume qui prétendait m’imiter : je ne voulus pas le gronder en un si beau jour, mais c’était là encore une des facéties de mon cher aîné. Je lui souris en lui pinçant l’oreille.
Toute la période de Noël, du Nouvel an et de la fête des Rois Mages est pour moi une période de fête qui se situe hors du temps de l’année. Les musiques que je compose pour cette période prennent toujours un caractère plus doux et plus serein. Je suis alors dans une sorte de bonheur, de joie calme, de détachement que rien ne saurait ébranler.
À partir du 6 février, je ne composai plus rien, repris quelques anciennes musiques et me concentrai entièrement sur la musique que je préparais pour le dimanche de Pâques qui tombait, en cette année 1724, le 9 avril.
Mais le destin semblait m’être contraire. Le second enfant d’Anne, son premier garçon dont j’attendais et, je ne sais pourquoi, redoutais tant la venue, naquit à la fin du mois de février : il était malingre et faible.
Autre mauvaise nouvelle, on m’annonça que Monsieur Pezold ne pouvait plus assurer ses cours de latin et j’étais obligé de les faire moi-même.
Je n’avais plus que deux mois devant moi pour préparer les fêtes de Pâques! Les difficultés décuplaient mes forces. Ces messieurs de Leipzig avaient autorisé depuis quatre ans une grande représentation de la Passion à Saint Thomas. J’allais produire l’œuvre la plus grandiose jamais conçue sur le récit de la Passion et la mort de Jésus le Christ, d’après l’évangile de Saint Jean.
Une œuvre capable de rivaliser avec la Passion de mon ami Telemann sur le fameux texte de Brockes. Mais moi je voulais que ce soit le texte même de l’Évangile qui soit le socle de l’ensemble. Je commençai par faire un plan impressionnant : le texte de l’Évangile était chanté dans des récits et commenté dans des airs, des chorals, des chœurs dont j’avais pris les textes un peu partout, y compris dans Brockes lui-même. Je m’aperçus que j’avais conçu pas moins de 68 morceaux. Ce chiffre n’était pas voulu mais on peut faire dire à ce chiffre que 6+8=14, chiffre de B A C H
Comme d’habitude, mais plus encore que d’habitude, je mis à contribution tous ceux qui autour de moi aimaient la musique.
Je permettais à Guillaume de venir me voir fort tard dans la nuit :
– Père, pourquoi ne pas réutiliser comme vous le faites souvent vos musiques déjà composées à Weimar ou à Cöthen : cela vous fera gagner du temps.
– Pas question, mon fils : j’écris sur le texte même de l’Évangile et je veux que tout ce que je conçois autour de cette passion soit totalement nouveau.
– Père, pourquoi fais-tu des chœurs si compliqués au moment où la foule crie ? Par exemple quand au début les brigands viennent arrêter Jésus. Jesus demande : « Qui cherchez-vous ? » et ils répondent : « Jésus de Nazareth » !
– Mais je ne peux pas faire un chœur qui ne va durer que quelques secondes !
– Et pourquoi pas ?
– Attends, je suis dans le récit et là, tout le chœur se lève et crie « Jésus de Nazareth » ? Tu vois ça dans l’église de Saint Thomas ?
– Mais pourquoi pas ?
- Mais on dira que c’est du théâtre !
– Et alors ? Ce pourrait être si beau, ce cri, dans l’église !
J’eus alors l’idée de faire un chœur apparemment tout simple sur les mots « Jésus de Nazareth », où tous chanteraient en même temps en prononçant trois fois « Jésus de Nazareth ». L’ensemble durerait moins de vingt secondes.
Je dis à Guillaume :
– Chante avec moi, mon fils et voyons ce que cela donne.
Alors je me mis au clavicorde et nous avons crié ensemble : « Jésus de Nazareth » si fort qu’Anne se réveilla et vint nous voir :
– Mais qu’est-ce qui vous prend en pleine nuit…
– Attends Anne, écoute ! et puis chante avec nous : « Jésus de Nazareth » !
Et Anne chanta.
Alors Emmanuel arriva et il chanta avec nous :
– « Jésus de Nazareth » !
Puis un élève qui logeait chez nous se joignit à nous en criant :
– « Jésus de Nazareth » !
Guillaume avait raison : l’effet était extraordinaire. Et nous nous laissions emporter par notre enthousiasme jusqu’à ce que le préfet chargé de la discipline cette semaine-là arrive et nous dise :
– Mais on vous entend jusque dans les dortoirs là-haut !
Alors tout le monde alla se coucher. Mais une fois Anne endormie, je revins à mon cabinet de travail et continuai mon œuvre.
Une autre fois, je mettais en musique le moment où Pierre, le disciple de Jésus, a si peur, lorsque Jésus est emmené par les soldats, qu’il prétend par trois fois ne pas le connaître. Jésus, pourtant, quelques heures avant, avait prédit à Pierre qu’au moment où il le renierait pour la troisième fois, on entendrait un coq chanter.
Guillaume regarda attentivement le texte que je mettais en musique et me dit :
– Mais, Père, il manque une phrase !
– Comment cela, il manque une phrase ?
– Mais oui. Après « Et aussitôt le coq chanta », il y a dans le texte « …et Pierre pleura amèrement ».
– Mais non, mon fils, tu confonds avec l’Évangile selon Matthieu. Tiens regarde !
Et je lui montrai la Bible traduite par Luther dont je prenais fidèlement le texte. Guillaume lut attentivement : il était à l’âge où l’on ne croit plus sans preuve. Il avait l’air plongé dans un abîme de réflexions. Puis il plissa le front.
– Père…
– Oui, mon garçon, qu’y a t-il ?
– Père, tu ne peux pas laisser ce passage comme ça… Il faut que Pierre pleure… Écoute.
Et il se mit à me chanter une vocalise qui m’impressionna tellement que j’avais du mal à retenir mes larmes. Je m’empressai de la noter sur le papier. Et c’est ainsi qu’elle paraît telle quelle dans ma Passion.
Les deux mois avant Pâques passèrent si vite que je ne pensais pas beaucoup à l’organisation matérielle. Je répétais le plus souvent avec mes élèves à Saint Thomas. Le « Jésus de Nazareth » et les chœurs brefs où ils devaient crier leur haine, leur plaisaient tellement que les difficultés techniques disparaissaient comme par enchantement. J’avais prévu au début un double chœur, comme Dieu l’avait lui-même décrit au début de la Bible, au chapitre 15 verset 1 à 21 de l’Exode. Je voyais déjà le jour où ils chanteraient dans cette église de Saint Thomas le vendredi saint, avec la foule. Devant moi la tribune, avec les instruments et à ma gauche dans la tribune le 1° chœur, à ma droite dans l’autre tribune le 2° chœur. Derrière moi en bas, au milieu de la nef, les femmes, et, sur les bas côtés, tous les hommes assemblés. J’étais heureux que cette première Passion soit jouée à Saint Thomas, car j’avais donné aux chœurs une grande place.
La semaine avant celle qui précédait Pâques, je fus convoqué devant le Conseil. Le Président de l’église Saint Nicolas était là.
– Monsieur Bach, vous avez commis une erreur !
– Laquelle, monsieur ?
– Nous devons vous dire que vous nous mettez dans une position difficile.
Je m’attendais à quelque catastrophe… j’étais dans un tel état de tension, en raison de l’effort que m’avait demandé mon travail !
– Mais qu’ai-je fait encore, que trouvez-vous donc tous…
– Monsieur Bach, je vous arrête avant que vous ne prononciez des paroles excessives. Voilà, je crois savoir que vous pensez jouer votre Passion à Saint Thomas alors que vous devrez la jouer à Saint Nicolas. Et en tant que Directeur de cette Église je me dois de vous dire qu’il a été prévu que, pour la première fois cette année, la Grande Passion doit être jouée dans mon Église et…
– Mais ce n’est pas possible. J’ai prévu un double chœur d’entrée et seules les tribunes de Thomas sont assez vastes pour me permettre de jouer ce chœur avec tous les garçons et puis le clavecin de Nicolas est injouable et puis mes textes sont imprimés à l’adresse de l’église de Thomas… et puis…
– Et puis… quoi ? Monsieur Bach ?
– Et puis… ce n’est pas possible…
– Monsieur Bach, ceci est un ordre. Je veux bien faire réparer ce clavecin et payer une nouvelle impression du programme…
– Mais mon double chœur au début… je le voyais… avec tous mes garçons, disposés en deux groupes dans la grande tribune de l’Église de Saint Thomas.
– Demandez au sacristain qu’il vous aide pour aménager la tribune de Saint Nicolas. Et, puisque nous parlons de vos chœurs, monsieur Bach, nous sommes plusieurs à penser que depuis quelque temps, on y entend pas assez les thèmes de choral et qu’ils sont souvent fort longs.
– Mais… le chœur d’entrée à deux chœurs dont je vous parle est couronné par un choral. D’ailleurs il… il… n’y pas une note à changer à ma musique.
– Je ne dis pas cela, monsieur Bach. Je dis que, depuis quelque temps, on n’entend pas assez les thèmes de choral… On dit que votre amour pour les parties d’alto et de ténor…
Je sentis que j’allais exploser. Mais heureusement, comme en plusieurs occasions déjà, je réussis à rentrer en moi ma colère et fis une grimace plutôt qu’un sourire et je quittai les lieux le plus vite possible. Sur le chemin du retour, je fus pris d’une sorte de vertige.
J’entendais, venant du fonds des temps, une musique inimaginée. J’entendais une immensité d’eau, frémissante de mouvements immobiles, de pulsations divines d’où allait surgir un cri créateur. C’était ce que j’avais commencé à percevoir à Lübeck quand je m’étais trouvé face à la mer. J’entendais maintenant les cris d’enfants en train de naître. J’entendais chanter, venant des quatre coins du ciel, tous les peuples du monde…et je voyais au dessus de moi, dans un ciel clair, le Christ en croix inondé de soleil : je ne distinguais que sa couronne d’épines et ses cheveux sanglants, tout près de moi, et ses pieds, très loin, à l’autre bout du ciel, là où le ciel rejoint la terre.
Les paroles du Psaume 8 résonèrent à mes oreilles : « Seigneur, ton nom est puissant à travers toute la terre… »
Je courus à la maison, ne vis personne, je n’entendis personne, je me jetai dans mon cabinet de travail. Je restai toute une journée et toute une nuit sans même entendre qu’on voulait me déranger.
Le lendemain je réunis tout le chœur et les instrumentistes.
– Venez, je vous emmène à l’église Saint Nicolas
Ils ne m’avaient jamais vu dans cet état. Certains se jetaient des regards pleins de doutes et d’interrogation.
– Allez, entrez, serrez-vous un peu ! Serrez-vous ! De toutes façons on m’a promis plus de place pour le jour où le public sera là ! Le sacristain va s’en occuper, paraît-il ! Messieurs, vous allez devoir apprendre en quatre jours le chœur d’entrée de ma Passion selon l’Évangile de Saint Jean.
Quelques voix s’élevèrent :
– Mais nous l’avons déjà appris !
– Non, j’ai tout changé, comprenez-vous ? J’ai tout changé. Car ce chœur, nous devrons le chanter ici, à Saint Nicolas.
– Mais nous pensions…
– Moi aussi, mais tout est changé. Vous m’entendez ? Tout est changé ! Alors écoutez-moi bien. Ce n’est pas souvent que je vous dis de crier. Mais là, sur la première note, sur le mot « Père », chantez le plus fort que vous pourrez, de toute votre voix, comme si vous vouliez faire écrouler l’église ! Imaginez que vous êtes dans la nuit depuis toujours et que pour la première fois vous allez voir le ciel.
Les instruments commencèrent, sans fausse note, doucement ; les garçons prenaient leur respiration au rythme de ce doux balancement des cordes et tout à coup leur cri emplit toute l’église. Bonheur immense, joie divine !
Je m’aperçus que ce chœur impressionna tellement les enfants qu’ils s’en trouvaient un peu distraits pour les chœurs suivants. Je décidai donc les deux années suivantes de le mettre à la fin et de le remplacer par un choral. Plus tard, beaucoup plus tard, lorsque j’approchai la vérité suprême, je revins à mon idée première. Mon œuvre était accomplie, j’étais certain d’avoir fait plus grand, plus haut, plus fervent que Telemann ou même que Kuhnau.
Plus d’un mois après je fus convoqué par le surintendant Deyling qui avait en charge toute l’organisation financière et matérielle de la ville de Leipzig. Il était de plus Pasteur de l’Église de Nicolas.
– Monsieur Bach, malgré la sympathie que j’ai pour vous et pour votre musique, je dois vous confirmer que vous me mettez dans l’embarras… Ce billet que voici m’est venu par hasard entre les mains… il a été distribué… avant la Passion. Écoutez : « Il a plu au très sage conseil de décider que l’exécution aurait lieu à Saint Nicolas… » Qui a rédigé ce billet, Monsieur Bach ?
– Mais c’est moi…
– Ah vous le reconnaissez ! Avouez que cela manque d’élégance. On a l’impression que notre décision est une sorte de caprice. C’est une offense à notre conseil, Monsieur Bach. À qui avez-vous montré ce papier avant de le distribuer ?
– Mais à personne, pourquoi ? C’était une simple annonce !
– À l’avenir je veux voir tout ce que vous faites publier…
– J’espère qu’on me pardonnera, mais je ne connais pas encore bien les usages, dis-je en baissant les yeux, surpris de ma propre mauvaise foi.
Le superintendant Salomon Deyling fit comme s’il n’avait rien entendu.
– Ah autre chose, Monsieur Bach, je vous confirme aussi que beaucoup d’entre nous pensent que dans vos musiques, on entend pas assez les thèmes de choral.
– Que voulez-vous dire ?
– Quand les enfants chantent, on doit entendre les chorals qui font partie…
– Mais je peux faire un chœur sans y introduire un choral…
– Je ne vous le conseille pas, monsieur Bach. En tant que Pasteur, je dois enseigner par ces chorals, la doctrine de Luther, et c’est également vôtre rôle.
– Mais depuis que Neumunster a écrit ses recueils, on ne joue plus de musiques avec choral. Le choral vient seulement à la fin, pour conclure. Car la musique, même sans choral, élève l’âme…
– Pas quand elle est trop savante. D’ailleurs les thèmes des sermons qui vont être faits par le prédicateur cette année seront des commentaires de chorals de Luther et de ses disciples.
– Mais… alors, je ne devrai plus composer un seul air sans qu’on y entende un thème de choral ?
– Il suffit, Monsieur Bach. Ne tombez pas dans l’extrême inverse… Les gens de Leipzig sont sensibles à de jolis airs, même sans thème de choral. Cela marque un moment de détente pendant l’office. Mais quand les enfants chantent en chœur… il faut qu’on entende les chorals.
J’avais réussi à garder mon calme. Je n’aimais pas que les autorités interviennent trop dans la conception de mes musiques. Cet impératif était contraire à l’évolution que j’avais entamée. Puis je me mis à trouver dans cette exigence de chorals, une nouvelle inspiration. Je composai des musiques et des polyphonies totalement nouvelles à l’époque et même encore maintenant : je n’ai jamais entendu rien de comparable ailleurs, même dans les compositions de mes fils aînés et des gens de leur âge. Je ne cherchais plus des textes de révolte contre mes soucis quotidiens et le monde en général comme certains de ceux que j’avais mis en musique l’année d’avant. J’avais repris confiance en Notre Seigneur et dans les chemins par lesquels il nous conduit vers la mort. J’étais plus serein.
C’est ainsi que, pour tous les dimanches après la Trinité de 1724, je repris la tradition ancienne : je composai des musiques avec des chœurs et même de nombreux airs et récits, dans lesquels on pouvait facilement entendre les thèmes des chorals.
Cela ne m’empêchait pas de progresser dans le projet que j’avais toujours eu depuis que j’avais 20 ans : composer assez de musique d’église pour pouvoir les jouer régulièrement tous les dimanches pendant plusieurs années. Anne riait quand je lui disais que j’arrêterais un jour de composer des musiques d’église pour me consacrer à nouveau au clavecin, à l’orgue, à d’autres musiques :
– Mais mon Sébastien, ce n’est pas possible. Depuis que je te connais, tu travailles des nuits entières pour les cérémonies religieuses à la gloire du Seigneur. D’ailleurs, regarde tes collègues, Telemann par exemple : ils continuent avec les années pour chaque dimanche à composer une musique.
– Oui, mais ils se répètent et moi je ne sais pas me répéter. Ce qu’ils font est beau et souvent original, mais après, dès qu’ils ont du succès, ils se copient eux-mêmes et leurs œuvres se ressemblent. Moi, je ne peux pas. Ou je reprends une pièce ancienne ou je fais quelque chose de nouveau : il faut que je progresse, toujours. Et puis j’ai tellement d’autres choses en tête… Tu verras dans deux ou trois ans j’arrêterai de composer ce type de musique.
– Tu serais bien le premier ! Et puis tu dois respecter les souhaits des pasteurs et des prêcheurs. Et notre avenir, Jean-Sébastien…
– Ne t’inquiète pas, Anne. Tu verras…
Anne m’embrassa alors sur le front comme si elle n’en croyait pas un mot.
Après plus d’un an passé à Leipzig, nous connaissions de plus en plus de monde : j’avais un poste officiel et obligation d’assister à certaines réceptions. Heureusement, j’avais la chance de pouvoir penser mes musiques à tout instant, n’importe où. Une fois ces musiques conçues dans ma tête, il me restait à les mettre sur le papier : pour cela tous ceux qui étaient autour de moi m’apportaient une aide essentielle. Il y avait dans une des pièces du bas une table autour de laquelle je faisais travailler tous mes « copistes ». Parfois, pour la musique du dimanche suivant, il y a avait plusieurs dizaines de copies à faire, une pour chaque instrument et chaque groupe de chanteurs.
J’ai toujours besoin de contact avec des gens : c’est en partie pour cela que j’aime tant notre religion luthérienne et sa vie communautaire. Ainsi, tout près de nous, habitait la famille Bose : la porte de notre logement et la leur se faisaient presque face dans la petite rue. Ils faisaient commerce de bijoux et de joaillerie. Ils étaient très riches. Mais la différence de fortune ne nous gênait absolument pas. Ils avaient fait aménager en dehors de la ville de beaux jardins où nous allions parfois nous promener. Ils adoraient la musique. Nos aînés avaient à peu près le même âge : les Bose avaient des filles qui guettaient toutes les occasion de venir écouter de la musique, d’aider Anne et Fridélène et… de voir les nouveaux nés.
Nous voyions aussi souvent bien d’autres amis, des musiciens, des professeurs à la Faculté, juristes, théologiens, écrivains : avec eux j’adorais discuter et parler par exemple des textes liés à la religion.
Après la période de Pâques 1724, je fis deux voyages : en juin à Gera j’allai inaugurer un orgue à environ 100 km au Sud, ce fut un long voyage mais qui me rapprochait de ma chère Thüringe. Le second voyage, je le fis à Cöthen, en Juillet, avec ma femme : le prince, qui avait tenu à ce que je garde le titre de Maître de Chapelle de Cöthen, nous accueillit chaleureusement. Sa mère était là aussi, toujours vaillante.
Ma chère femme, Anne, nous fit entendre sa fort jolie voix et elle eut beaucoup de succès.
L’automne 1724 se passa dans une surabondante activité de création et de mise au point de musiques d’église, pratiquement chaque semaine, de surveillance d’élèves et de musiciens, de leçons données à mes élèves.
Un jour de décembre, je revenais de contrôler des trompettes à l’Hôtel de Ville de Leipzig. J’avais emmené mon troisième fils, Bernard (10 ans), un petit garçon espiègle et encore plus fantasque que ses deux aînés : les enfants (sauf Guillaume) adoraient voir « mes » trompettes qui sonnaient des chorals en haut de la tour de l’Hôtel de Ville. Au retour, nous en avions profité pour regarder par la même occasion les petites échoppes des commerçants de la petite foire du marché de Noël.
Avant de rentrer à la maison, je passai comme souvent voir mon ami Georges Bose. Au moment où j’allais entrer dans sa boutique, une femme en sortit. Elle me regarda avec un sourire que je perçus ironique et narquois. Nos regards se croisèrent. Elle hésita un instant, puis s’éloigna. J’avais eu le temps de voir son visage : elle devait avoir une trentaine d’années mais j’avais cru voir dans ses yeux une vivacité d’esprit rare chez les femmes.
J’entrai dans la boutique :
– Ah ! Sébastien, comment allez-vous ?
– Bonjour, ami Georges, mais je ne veux pas vous déranger. Je vois que vous recevez du beau monde en ce temps de Noël.
– Comment, vous ne savez pas qui est cette dame qui vient de sortir ?
– Au risque de vous décevoir, je vous assure que non.
– Mais c’est Christiane de Ziegler !
– Comment ? La fille de Romanus l’ancien maire ? À propos est-il toujours en prison ?
– Oui, depuis… vingt ans, je crois.
– C’est elle dont on dit qu’elle est femme de lettres et qu’elle va créer une revue ?
– Mon pauvre Sébastien, me dit Georges Bose, que va t’on devenir si les femmes se mêlent de tout ?
– Ici, à Leipzig, ça me paraît difficile puisqu’on leur interdit même de chanter dans les églises…
À ce moment la porte de la boutique s’ouvrit et j’entendis une admirable voix de femme, grave et bien timbrée qui disait :
– Finalement, je vais vous le prendre…
– Quoi donc, madame ?
– Mais ce collier bien sûr…
Je restai là, un peu gêné, tenant mon garçon par la main, sans savoir trop quoi faire… Alors Georges Bose se retourna vers moi et dit :
– Ah mais… Ah… où avais-je donc la tête ? Je n’ai même pas fait les présentations : Sébastien je vous présente Madame Christiane de Ziegler, connue dans toute la ville pour la qualité de son esprit et ses talents de femme de lettres.
– Madame je vous présente…
– Inutile, Monsieur Bose. Quand on suit, comme moi, régulièrement les offices, on connaît forcément Monsieur Bach.
– Très Honoré, madame.
– Je vous avoue, monsieur, qu’à l’église, chaque dimanche, j’attends la fin du sermon avec impatience car je sais que j’entendrai après, un peu de votre musique. Un sermon, quand il est en quelque sorte inséré entre des œuvres de Monsieur Bach, me paraît si long qu’il me met au supplice…
– Mais madame…
– Je dois vous dire que j’apprécie d’autant plus votre musique qu’elle est en bonne harmonie avec ces petits livrets de textes qui nous sont distribués d’avance.
– Mais madame…
– Mais quand je vous entends diriger vos chanteurs et vos instrumentistes depuis le clavecin…, j’avoue que je me surprends parfois à écouter davantage le clavecin que les instruments. Vous me pardonnerez ma franchise mais je ne sais plus mentir…
Cette femme parlait avec une ironie mordante sur un ton qui me rappelait singulièrement le pédantisme des Français à Celle. Mais à travers cette ironie on sentait poindre comme une grande tristesse.
À ce moment, entra Christine, l’aînée des Bose, petite jeune fille épanouie chez qui on sentait déjà percer la future femme. Elle avait décidé, je ne sais pourquoi, de m’appeler « papa Bach ».
– Papa Bach, papa Bach, tout le monde vous attend. Vous nous avez promis de nous faire chanter ce soir avec Anne, votre femme !
– Ah oui, c’est vrai, l’air de ma musique de Noël.
Je ne sais pourquoi, mais je m’entendis dire alors :
– Madame, si vous vouliez me faire l’honneur… J’ai voulu créer un effet particulier dans un récit en y incluant un choral.
Anne chantera le récit, les enfants le choral et moi je jouerai l’orchestre… avec mon clavecin ! Je serais heureux d’avoir votre sentiment sur l’harmonie entre textes et musique, dis-je avec un petit sourire.
– Monsieur, je ne saurais…
– Oh si, madame, venez, dit mon jeune fils Bernard, qui depuis son entrée dans le magasin semblait subjugué par madame de Ziegler, venez, s’il vous plait.
Christiane de Ziegler sourit en caressant la tête de mon garçon avec une tendresse triste qui me surprit. Je ne savais pas alors que ses enfants avaient déjà rejoint le Seigneur, ainsi d’ailleurs que ses deux maris.
– Votre petit garçon ferait fondre n’importe quelle femme… Eh bien, c’est d’accord, mon garçon, dit-elle sans me regarder, je vais venir, mais je ne voudrais pas…
Je fis semblant de ne pas écouter. Je me tournai vers George Bose :
– Mais je suis sûr que vous aussi Georges, vous allez venir, si vous voulez entendre chanter vos filles. D’ailleurs pour vous, il est l’heure de fermer boutique… Vous autres commerçants, vous avez des heures pour fermer. Moi, je ne ferme jamais dis-je en montrant ma tête et mes oreilles et en me baissant vers mon fils pour lui faire une grimace.
C’était le temps de Noël. Je voulais que tout le monde soit heureux.
Mon fils Bernard avait alors 10 ans : il éclata de rire. Il ne perdait pas une occasion de faire le pitre, ce qui ne l’empêchait pas d’être aussi doué que ses deux aînés dans notre art.
Christiane de Ziegler paraissait tout à coup pleine de gaieté et d’espièglerie. Elle prit la main de Bernard et nous suivit. Avant d’entrer chez nous, nous sommes allés chez les Ernesti pour leur demander s’ils voulaient venir. Régine accepta avec joie mais son mari préféra aller se coucher.
Anne nous accueillit avec le sourire. Rien ne la surprenait : elle accueillit cette femme comme si elle l’avait toujours connue.
– Anne, je te présente Madame de Ziegler…
– Madame, dit Anne, je suis très honorée de vous accueillir dans notre modeste demeure…
– Madame, c’est moi qui suis confuse…
– Allons, dis-je, prenez place… Les enfants, mettez-vous devant moi, que je vous voie bien. Anne, viens près de moi, tu liras sur la même partition que moi. Catherine, peux-tu avancer quelques sièges pour nos invités ?
À 18 ans ma fille Catherine était devenue une jolie jeune femme et, comme il sied à son âge, un peu réservée. Elle regardait madame de Ziegler, comme hypnotisée. Guillaume et Emmanuel ne la lachaient pas des yeux non plus.
– Non, pas trop près, là, voilà. Le siège de Madame de Ziegler sera celui-ci, à côté de Fridélène. Tout le monde est prêt ? Allons-y 1, 2, 3…
Christiane de Ziegler écouta attentivement. Après la fin de la musique, le silence dura quelques secondes. Puis madame de Ziegler demanda :
– Mais… de qui est le texte ?
– C’est… euh… une adaptation d’un texte de Luther !
– Ça, je m’en doute ! Mais une adaptation de qui ?
– C’est sans importance. Vous savez… c’est une collaboration des uns et des autres…
– Tiens à propos, papa, dit Guillaume, j’ai croisé Andreas Stübel, tout à l’heure. Il avait l’air étrange. Il m’a raconté qu’il avait été co-recteur de notre école et qu’il travaillait avec toi sur des textes.
– Oui, c’est vrai, il a bien été co-recteur, mon fils. Il a été mis à l’écart parce qu’il se prenait pour un prophète. Mais c’est un homme remarquable, un grand théologien et spécialiste du latin.
– En tout cas, il m’a impressionné en me disant : « Je te prédis qu’avant la fin du mois je serai mort ». Sa voix paraissait venir d’un autre monde…
Christiane de Ziegler regarda Guillaume puis me dit d’air entendu :
– Alors, ainsi, vos textes sont de lui ?
– Je n’ai rien dit de tel, madame…Euh…si vous le voulez bien, nous allons faire de la musique, maintenant.
Ensuite, nous avons chanté. Après un silence Christiane de Ziegler se tourne vers moi :
– Monsieur Bach, j’aime beaucoup les émotions qu’exprime votre musique.
Quelques pièces suivirent, chantées par les uns et les autres. Puis arriva l’heure où les enfants devait aller dormir.
– Allons, au lit tout le monde.
– Papa, ne pourrais-je pas rester un peu ? dit ma fille aînée
Régine intervint :
– Elle a raison, c’est une jeune femme maintenant
Christiane de Ziegler semblait ailleurs. Je devais sans doute avoir la même expression car je pensais très fort à une de mes compositions. Tout à coup, elle sembla descendre d’un songe.
– Monsieur le Cantor, pensez-vous que vos supérieurs et vos pasteurs accepteraient que j’écrive des textes de musique d’église ?
– Comme Messieurs Frank ou Neumunster ? dit Fridélène, à qui ces noms rappelaient les souvenirs de Weimar et de Cöthen, époque bénie où sa sœur, ma défunte épouse, était encore de ce monde.
– Ou comme Henrici ? dit Guillaume
Tout le monde, sauf moi, éclata de rire.
– Cet Henrici est impayable ! Vous savez qu’il se fait appeler Picander ?
– Ah oui et pourquoi donc ?
– Mais parc…
– Allons parlons sérieusement : moi je trouve l’idée de Mme de Ziegler excellente.
C’était Régine Ernesti qui avait parlé : elle connaissait tout le monde grâce à son mari et à son frère. Si elle disait oui, c’est qu’elle ferait tout pour que les autorités acceptent.
– Pour une fois qu’une femme…
Je me mis à taquiner Régine.
– Mais, Régine, ne pensez-vous pas qu’il faudrait faire d’abord demander à des théologiens de faire une thèse sur le sujet : « Une femme a t’elle le droit d’écrire des tex…
– Vous vous moquez de moi, dit-elle en souriant
– Eh bien moi, je trouve que le sujet de cette thèse est une bonne idée, dit Georges Bose. Après tout, les femmes…
Anne, Régine et Christiane ne lui laissèrent pas le temps de finir et couvrirent sa voix.
– Monsieur Bach je vous propose de faire des textes pour les prochaines fêtes de Pâques
– À une condition, Madame…
– ?
– C’est que nous travaillerons ensemble…
– Qu’est-ce que vous entendez par là, Monsieur Bach ?
– Eh bien, vous écrirez les textes selon votre inspiration et…
– Et ?…
– Et nous verrons ensemble, si, en fonction de la musique que j’écris, il ne convient pas de modifier, disons certains mots ou certaines tournures de phrases…
Christiane sembla très étonnée. Elle ouvrit la bouche, comme si elle allait dire quelque chose, puis elle sembla se raviser et dit :
– Mais… tout à fait d’accord, Monsieur Bach.
– Dès mon retour de Cöthen où je vais fêter l’anniversaire du Prince, nous commencerons à travailler.
Je tenais beaucoup à ce voyage à Cöthen chaque année, d’une part parce que j’avais toujours le titre de Maître de Chapelle, mais aussi parce que j’y retrouvais le Prince et ses amis. Cette année-là, toute une délégation de Weissenfels était là, à commencer par le Prince Christian lui-même, ainsi que plusieurs membres de la famille Wilcke, celle de ma chère femme.
Le Prince Christian de Weissenfels était accompagné de plusieurs personnes de qualité parmi lesquelles je reconnus Henri Scherling, un commerçant de Leipzig, ami de George Bose.
– Monsieur Scherling, comment se fait-il que j’ai l’honneur et le plaisir de vous voir ici ? lui dis-je
Il m’emmena à l’écart et me dit :
– Monsieur le Cantor, vous voyez le jeune homme là bas ?
– Oui…
– C’est monsieur Frédéric Lösner. Son nom ne vous dit rien ? Vous l’avez peut-être vu quand vous êtes allé à Dresde ?
– Peut-être, vous savez, on voit tellement de monde là-bas !
– Bon, ça ne fait rien. Eh bien ce monsieur a en charge tous les problèmes de transport sur les fleuves et les rivières au nom de notre Roi, sa Majesté Auguste le Fort, l’Électeur de Saxe et roi de Pologne !
– Ah bon ? Et pourquoi est-il ici ?
– Il est venu avec le Prince Christian de Weissenfels : il ont des projets de bateaux sur la Saale, la rivière qui passe à Weissenfels et ces projets m’intéressent pour mes affaires mais aussi parce que ce monsieur… va épouser ma propre fille.
– Je vous félicite, monsieur Scherling !
– Merci, Monsieur Bach. Tenez, approchons-nous !
Le Prince Christian était en grande discussion avec ce Monsieur Lösner et une charmante jeune femme. Je m’inclinai respectueusement devant le Prince de Weissenfels.
Le Prince Christian me reconnut tout de suite :
– Monsieur le Maître de Chapelle, bonjour !
– Permettez-moi de vous présenter Monsieur Lösner et la fille de Monsieur Scherling, Elisabeth.
– Monsieur et moi-même sommes de vieilles connaisances : vous rappelez-vous, Bach, quand vous avez fait de la musique pour mon anniversaire : c’était… attendez…
– Il y a presque 22 ans Prince !
– Vous avez une bonne mémoire, monsieur Bach.
Monsieur Scherling fit un signe à sa fille, d’un air de dire « Vas-y, c’est le moment ! ». La jeune fille s’avança vers moi en faisant une révérence :
– Monsieur le Cantor, nous savions que vous seriez ici aujourd’hui et nous avons une grâce à vous demander. Monsieur le Cantor, vous savez que mon futur mari s’occupe des fleuves et des rivières. Votre nom, Bach veut aussi dire rivière. Nous avons pensé qu’il y avait là un signe. Et alors… nous nous marions le 12 février prochain et nous voudrions que vous nous fassiez une belle musique.
– …
– Votre prix sera le nôtre, bien sûr.
– C’est quel jour ?
– Un lundi. Mais j’ai quelque chose à vous montrer.
Elle sortit un papier sur lequel étaient griffonnés quelques mots.
– Regardez. Ce sont des passages de la Bible dans lesquels la parole de Dieu se réfère à l’eau, aux fleuves, aux bateaux. À commencer par les fleuves du Paradis décrits dans le Livre Saint, au début de l’Exode.
J’étais étonné de l’ardeur et du sérieux de cette jeune fille. Tout le monde la regardait avec admiration puis les regards se tournèrent vers moi. J’étais bouleversé de ce signe venu de Dieu lui-même : Dieu et l’eau, Dieu et Bach-Le Ruisseau.
– Je vous promets un beau mariage, mademoiselle.
– Oh merci, Monsieur le Cantor, je…
Le Prince Christian lui coupa la parole :
– Mais au fait j’y pense : pourquoi ne pas faire pour moi aussi une nouvelle musique à l’occasion de mon anniversaire en février prochain ? Avec une histoire de chasse ou de bergers, comme il y a 20 ans.
Les bergers, la campagne, je ne sais pourquoi, mais je pensai aussitôt à Picander. Cela lui irait sûrement très bien. Il aimait bien mettre en scène des gens et des choses, il aimait les grecs et les romains, comme c’était alors la mode. Il ferait sûrement un bon texte. De notre travail commun naquit notre musique composée pour beaucoup d’instruments, qui fut jouée à Weissenfels le vendredi 23 février 1725, tout juste 22 ans après la cantate de la Chasse. De mon ami Salomon Franck à Picander, combien de textes avais-je cherché, lu, choisi, parfois remanié ou adapté !
Ce voyage à Cöthen avait été fructueux à tous points de vues. Dès mon retour je me mis au travail pour les musiques d’église avec Christiane de Ziegler. Le plus souvent, nous avions choisi de placer en entrée les textes de l’évangile de Jean, choisis comme d’habitude pour les lectures des offices de cette période d’après Pâques. J’ai une telle vénération pour ces textes des Évangiles, que je les mets plus souvent sous forme de chœurs ou de récits chantés par la voix de basse. Les textes de Christiane de Ziegler ne venaient qu’en appoint.
Notre collaboration me permit d’apprendre beaucoup de choses sur la vie et les salons de la ville. Nous avions déjà travaillé sur 9 textes de cantate, lorsqu’un jour, ce devait être au mois de mai, elle m’invita à venir chez elle. Elle me dit qu’elle recevait quelques amis. Quand j’arrivai, je pus constater qu’il y avait là tout ce que la ville comptait de beaux esprits. Je fus surpris de la jeunesse de la plupart d’entre eux. D’ailleurs, je fus accueilli comme par un murmure de respect qui montrait bien qu’ils me considéraient comme leur aîné.
Christiane de Ziegler s’avança vers moi suivie d’un jeune homme d’une vingtaine d’années dont le regard hautain m’effraya chez un homme aussi jeune.
– Je vous présente Jean-Christophe Gottsched, poète et professeur, membre du collège marianiste.
– Professeur, déjà ? dis-je en voulant être aimable.
Ce trait d’esprit involontaire fit rire toute l’assemblée. Tout le monde me regardait d’un air entendu, comme s’ils voulaient dire : «Ah, ces artistes, il n’y a qu’eux pour dire des choses pareilles »
– Jean-Sébastien Bach, directeur de la musi…
– Ne me présentez pas monsieur Bach, chère amie, c’est lui faire offense et faire offense à la musique de notre pays.
Puis il me regarda de toute sa hauteur un peu méprisante :
– Avec Telemann et Haendel, vous êtes, monsieur, l’une des trois grandes gloires musicales actuelles de notre Allemagne et votre renom s’étend en Italie et en France.
Sa phrase terminée, il alla vers d’autres invités. On avait un peu l’impression qu’il était le maître de maison. Je vis alors s’approcher de moi un homme assez jeune que je ne reconnus pas tout de suite tant son apparence avait changé. Il est vrai que cela faisait plus de deux ans que nous nous étions vu et qu’à cet âge, on change beaucoup. C’était Henrici : il avait l’air plus sûr de lui qu’avant mais sans arrogance. Je reconnus son sourire interrogateur, comme s’il demandait toujours s’il ne dérangeait pas.
– Monsieur Henrici ! Comment allez-vous ? Que devenez-vous ? Justement je voulais vous voir. Le Prince de Weissenfels veut une musique pour son anniversaire avec des bergers grecs, alors j’ai pensé à vous.
Henrici devint rouge de joie contenue.
– Oh Monsieur le Cantor, je vous en suis si rec…
– J’ai vu que vous avez publié chaque semaine jusqu’à Noël un recueil des poèmes religieux.
– Vous les avez lu ?
– Hélas quelques uns seulement mais, faute de temps, pas tous. Mais cela m’a permis de penser à vous de temps en temps et je l’avoue de m’en inspirer parfois, jusqu’à ce que je rencontre Madame de Ziegler, avec qui j’ai travaillé neuf textes de cantate. Nous arrivons au dixième, au début de la période de Pâques. Vous ne m’en voulez pas j’espère ?
– Oh Maître… Vous savez bien qu’au contraire…
Tout à coup on entendit des chchchchch ! ce qui signifiait qu’on demandait le silence. Le jeune Gottsched prit la parole :
– Mes amis, vous savez que nous vivons une période passionnante : les Français nous ont ouvert la voie en nous apprenant comment faire régner la raison dans nos pensées et donc dans nos écrits. « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement », disent-ils. Il nous faut être simples, rester naturels et abandonner toutes les exagérations et les outrances des siècles passés. Je pense, pour ma part, que cela vaut en particulier dans les écrits religieux.
– Que veut-il dire ? soufflai-je à l’oreille de Henrici, sentant monter mon irritation.
– Je vous expliquerai.
– Nous avons la chance d’avoir dans notre ville de Leipzig, des livres provenant de tout l’univers. Nous avons aussi le bonheur d’avoir des esprits ouverts aux idées nouvelles. Parmi eux, il est des femmes de grand talent : Christiane de Ziegler est l’une d’entre elles.
Christiane sourit d’un air modeste.
– Elle a souhaité que je vous annonce une grande nouvelle : elle va publier avec d’autres femmes une Revue qui s’appellera : « La Critique des Femmes de Raison ». Cette revue diffusera des textes conformes aux nouvelles idées.
Tout le monde applaudit.
– Mais qu’est-ce qu’il veut dire sur les écrits religieux ?
– Il pense qu’il ne faut plus utiliser des comparaisons ou des correspondances trop expressives.
– Par exemple ?
– Je ne sais pas… Ah si !… Par exemple la comparaison entre le cerf qui cherche de l’eau et le chrétien qui cherche le Christ, comme dans notre texte d’il y a deux ans…
– Mais j’ai trouvé votre texte excellent au contraire, c’est même ce qui m’a convaincu lors de notre première rencontre : toutes ces comparaisons, ces mystérieuses correspondances, ces allusions à la création divine élèvent notre esprit vers Dieu…
– Oh, vous savez, je crois qu’il se fait de Dieu une idée différente de la vôtre.
– Ah oui ? Et pourquoi donc ? Il vient souvent à l’office à Saint Thomas… C’est apparemment un bon chrétien qui croit en Dieu.
– Oui, mais disons que, peut-être, il croit aussi beaucoup en la Raison…
Je compris alors pourquoi je trouvais les textes de Christiane de Ziegler trop abstraits, pas assez intenses, pas assez tendus vers Notre Seigneur… Je décidai à cette minute de cesser toute collaboration avec cette femme.
Toute cette histoire de Gottsched me fit revenir pour mes musiques suivantes à des textes de Salomo Franck
et d’autres « anciens ». Sans doute avais-je fait fausse route avec Christiane de Ziegler.
En sortant je passai prendre congé de Christiane de Ziegler. Henrici était derrière moi. Elle était entourée d’un groupe d’admirateurs au milieu desquels était l’inévitable Gottsched. J’entendis ce jeune homme dire à voix basse :
– Celui-là, c’est un poète qui écrit parce qu’il a faim, une sorte de poète affamé !
Puis il jeta un regard vers Henrici qui était derrière moi et il mit son doigt sur ses lèvres en chuchotant
– Mais chut le voici !
Je mis cette impolitesse sur le compte de la jeunesse. Je pris congé. Mme de Ziegler me dit :
– À très bientôt, cher Cantor. Comme j’aimerais que nous puissions continuer à travailler ensemble !
– Mais, madame…, vous allez avoir tant à faire avec votre Revue.
Et je quittai les lieux.
Un groupe de jeunes hommes sortit en même temps que moi. Parmi eux je reconnus des étudiants qui aimaient la musique et avaient des dons suffisants pour venir chanter ou jouer mes musiques d’église avec les élèves de l’école de Thomas. Ils étaient en compagnie d’un homme de mon âge qui souriait et avait l’air très bon.
Henrici était toujours près de moi, comme s’il attendait quelque chose.
– Monsieur le Cantor, bonjour, dit l’un des étudiants sur un ton un peu moqueur en tirant une révérence.
– Bonjour mes amis, je compte sur vous dimanche prochain, c’est la fête de la Trinité !
– Y aura t’il un beau Chœur ?
– Comment ! Vous n’avez pas lu le livret distribué à tous les fidèles ?
– N…nnnon !
– Eh bien oui, il y aura un beau chœur sur un texte du prophète Jérémie.
– Et les autres parties, airs et récits : toujours sur des textes de votre amie Christiane ?
– Oui, mais ce sera le dernier !
– Ah bon ? Euh… Monsieur le Cantor, permettez-nous de vous présenter monsieur Auguste Frédéric Müller, membre éminent de notre Université et qui enseigne le droit.
– Mais nous nous connaissons déjà !
Je ne sais pourquoi, mais j’étais tout à coup gai et détendu.
– Mais bien sûr, dit Müller, monsieur le Cantor m’a déjà parlé de son fils qui veut faire du droit… dans quelques années !
– Mais… dit un étudiant, nous pensions que vous étiez en mauvais termes avec l’Université !
– Mais pas du tout, c’est elle qui est en mauvais termes avec moi : elle ne veut pas me payer !
Tout le monde était joyeux en cette chaude fin d’après-midi.
Je les quittai et me dirigeai vers l’École. Je traversai la place du marché. Comme je m’engageais dans la rue qui mène vers l’Église de Thomas, je fus rattrapé par deux étudiants, Frédéric Wild et Christophe Wecker, que je connaissais bien. Ils avaient couru jusqu’à moi. L’un d’eux, tout essoufflé, me dit :
– Nous… voudrions… vous dire maître… il y a certains professeurs que nous aimons beaucoup monsieur… Müller et d’autres… nous voudrions leur faire une surprise… pour leur anniversaire et ce serait des musiques chantées et jouées… par nous. Pour Monsieur Müller, nous avons déjà trouvé le thème… ce serait l’histoire du dieu du vent qui tout à coup se met à déchaîner les tempêtes et ne veux plus s’arrêter et ce serait monsieur Müller qui apaiserait le vent et en plus il a pour prénom Auguste ce qui fait très romain, et puis… Si vous vouliez bien faire la musique…
– C’est vous qui avez eu l’idée de cette histoire ?
– Oui, enfin, c’est plutôt Monsieur Henrici qui vient souvent à l’Université…
– Mais c’est une excellente idée mais il a d’autres fêtes prévues ?
– Oui, Monsieur Mencke par exemple qui va fêter ses cinquante ans.
– Quand ?
– Le 9 avril.
– Et monsieur Müller ?
– Le 3 août.
– Mais vous maître, si vous…
– J’ai tant à faire déjà… Croyez-vous que j’ai bien le temps ? Et puis mon épouse est enceinte… Savez-vous que c’est très cher d’organiser une musique comme cela. Il vous faut des musiciens…
– Mais nous jouerons et chanterons, cela se passera en plein air, on voudrait des tambours, des timbales, des chœurs, des airs.
– Mais… il vous faut des textes !
– Monsieur Henrici nous a dit qu’il voulait bien…
– Et la musique et les chanteurs et les chanteuses solistes ?
– Nous avons pensé que vous… nous… vos fils et peut-être votre épouse si elle est en bonne santé…
– Savez-vous combien ça coûte, rien que pour la musique ?
– N…non
– Minimum 25 000 F
– Rien que pour la musique ?
– Mais oui, bien sûr, avec tous les frais de papier et de copie !
– Cela devrait aller : nos parents, les professeurs, les notables, nous irons voir tout le monde.
– Écoutez, je ne dis pas non, et puis vous êtes parmi mes bons élèves.
Et effectivement, le lundi 9 avril et le 3 Août furent célébrés ces anniversaires. Le professeur Müller était rayonnant. J’avais un imposant orchestre avec de nombreux instruments à percussion au début et à la fin. Quelle joie de diriger ces étudiants enthousiastes, capables et pour qui la musique était une passion. Tout le monde était enchanté.
Notre petit Christian fut baptisé le samedi suivant. Le choix des parrains montrait combien, moi, le petit musicien de province, j’avais acquis une reconnaissance auprès des autorités les plus influentes de la ville. À Cöthen le prince avait choisi pour nous des grands pour être parrains et marraines. Maintenant, c’est moi qui choisissait parmi les grands: un membre de la suite du Prince électeur, des femmes de commerçants importants, et le fils d’un des maires les plus prestigieux de Leipzig, Paul Wagner qui m’avait tant aidé lors de mon arrivée à Leipzig.
Un jeudi après-midi, Anne s’était rendue je ne sais plus où, je restai seul avec Fridélène.
Fridélène, la sœur de… Maria-B…, la mère de mes premiers enfants.
Elle était devenue une vieille femme. Nous avions fêté cette année-là ses cinquante ans. Elle parlait peu et était sans cesse occupée aux travaux de la maison. Mais elle avait toujours été la confidente de mes moments de doute.
– N’est-il pas temps de prendre un peu de repos, Fridélène ? Tu es toujours la première levée, la première à l’ouvrage.
– Le seul repos que nous méritons, Sébastien est celui que nous accordera un jour le Seigneur dans sa maison. Pour toi non plus, tu le sais bien, le repos n’existera jamais. Toi aussi, tu dois travailler, pour tes enfants, pour la Musique, pour la Gloire de Dieu. Tu as la chance d’avoir reçu de notre divin maître des dons dont tu es le seul dépositaire. Tu dois transmettre aux autres cette parcelle de Dieu qui est en toi.
– Mais je cours toute la journée. Je vais de leçon en cours, de requêtes en recommandations, de cérémonies en fêtes. Et pourtant, il me reste tant à dire !
– À dire ?
– En musique, Fridélène, bien sûr ! Sois tranquille jamais je n’écrirai de mots sur la musique. Les autres, les sourds (j’avoue que mon allusion à Mathesson manquait de gentillesse) par exemple, le font très bien.
– Oui… qu’est-ce qu’un livre, même très savant, devant une belle musique !
– Comme tu comprends les choses, Fridélène ! Mais quand trouverai-je le temps, Fridélène, quand ?
– Je te regarde, Sébastien. Je sens que tu deviens différent. Tes musiques d’église ne te suffisent plus. D’ailleurs tout devient différent : plus rien n’est respecté, même les préceptes de Luther ne sont plus respectés. Depuis longtemps déjà, notre Prince a renié notre foi et s’est fait catholique pour devenir Roi de Pologne. Il paraît qu’il vit dans la débauche. Maintenant j’entends parler partout de libelles et de revues qui sont rédigées par des femmes apparemment pieuses mais qui, au fond de leur cœur, j’en suis sûre, méprisent la religion. Les gens racontent des choses que je ne comprends plus. Même les offices et la musique, dans nos églises, ne sont plus suivis comme avant. Je vois déjà que certains dimanches, tes musiques si belles ne sont plus jouées. Tous ces gens autour de toi, aiment de moins en moins notre musique faite à la gloire du Seigneur. Ici, le vieil Ernesti est fatigué. Il ne fera plus rien pour changer les choses. Ah où est le temps…
Je souris. Oui, vraiment Fridélène, était restée la même qu’il y a vingt ans, la même qu’à Arnstadt. Elle était bien la seule à ne pas changer. Et pourtant, c’était bien vrai : tout changeait autour d’elle, autour de nous.
– Tu as raison, Fridélène, tout change, mais moi, je dois changer avec les temps qui viennent. Les gens veulent des œuvres plus grandioses, même en musique d'église. J’ai de grands projets…
– Mais pourquoi, Sébastien, ce que tu fais est si beau. Ainsi, encore une fois, tu vas douter, peut-être repartir ailleurs, toujours ailleurs. Tu as toujours voulu aller ailleurs.
– Eh bien oui, je suis comme ça !
À ce moment Anne passa la tête par la porte :
– Qu’est-ce que vous mijotez tous les deux ? Savez-vous ce qu’on m’a dit ? Pisendel, Weiss, et Quantz sont de passage à Leipzig. Le violon, le luth et la flûte ! Ils reviennent d’un voyage en Italie. Ils vont venir nous voir.
– Quand, mais quand sont ils arrivés, Anne ?
– Ce matin, je crois.
– Mais pourquoi ne sont-ils pas venus ce soir ?
– Mais je ne sais pas !
Le lendemain matin, mes trois amis vinrent nous rendre visite.
– Racontez-moi ! Alors qu’y a t’il de nouveau en Italie ?
– Tout est opéra là-bas. Tout le monde chante. Vivaldi lui-même ne fait plus que des opéras, toutes les scènes s’illuminent. Il faut que tu voies ça. La prochaine fois, nous t’emmenons.
– Vous savez bien que ce n’est pas possible. J’ai tant à faire. Et la musique est-ce qu’ils en font vraiment ?
– Mon pauvre Sébastien !
– Dites-moi qu’ils ne font pas que des chansonnettes, des traits brillants à l’orgue ou au clavecin ! Dites-moi qu’ils font aussi de la vraie musique, cette musique profonde qu’on ne peut tenter d’atteindre qu’en travaillant, travaillant, encore et toujours. Je voudrais que tous les gens doués pour la musique fassent de la musique… Je voudrais…
– Écoute Bach, tu es vraiment un être à part ! Tu sais très bien que personne ne peut arriver à ton niveau… pour l’orgue ou pour le contrepoint par exemple.
– Mais si, celui qui travaillera autant que moi arrivera à la même chose !
– Tu ne penses pas un mot de ce que tu dis !
Je devais avoir un regard d’une telle sincérité qu’ils s’arrêtèrent de raisonner pour me dire :
– Ne te vexe pas, Sébastien, mais nous avons l’impression à la fois que tu es un des nôtres et que pourtant tu es si différent. On dirait que tu vis hors du temps !
– Mais non ! Je m’intéresse à tout ce qui se fait de nouveau.
– Oui bien sûr, mais tu as ta façon à toi de t’y intéresser. Peux-tu te libérer ce soir, nous pourrions faire un peu de musique !
– Eh bien d’accord, j’ai promis à mon fils de l’aider à compléter notre nouveau cahier, je vous montrerai quelques pièces pour clavecin !
– Votre nouveau cahier ?
– Oui, c’est un cahier que j’ai fait relier spécialement aux initiales de ma femme. Tenez, le voici, il est toujours à portée de main… Regardez cette belle couverture verte avec les trois lettres dorées A M B : Anna Magdalena Bach. Eh bien toute la famille y note les musiques jugées intéressantes. Bien sûr, j’y ai écrit quelques pages. Écoutez !
Je me mis au clavecin et commençai à jouer des œuvres de ce nouveau cahier qui était toujours à portée de main. Quand j’eus fini, l’un d’eux (je crois que c’était Pisendel) me dit :
– J’aurais tant aimé t’entendre aussi jouer de l’orgue ! Peux-tu nous emmener à Saint Thomas ou à Saint Nicolas ?
– Non, c’est impossible aujourd’hui à cause des offices.
– Écoute, cher confrère, je te propose de venir à Dresde jouer sur le nouvel orgue de Sainte Sophie, nous pourrons t’accompagner avec nos instruments. Nous donnerons des concerts dans cette église de Sainte Sophie. Qu’en penses-tu ?
– Mais mes élèves ? L’école ?
– Bah, tu te feras remplacer !
Quelques temps après, je partais. Au moment du départ, je remarquai l’air désespéré de Guillaume, comme si je l’avais trahi !
Dresde était en permanence transformé en chantier par la volonté d’Auguste le Fort, Prince Électeur et Roi de Pologne.
Le château était en pleine rénovation. Ce Roi faisait construire une sorte de théâtre et de lieu pour les fêtes en plein air appelé Zwinger.
Je retrouvai l’orgue de Sainte Sophie qui sonnait si bien. Et, avec les instrumentistes de la cour, nous avons fait pendant ce séjour de la belle musique d’église. Mes amis me racontaient leur vie : le salaire d’un simple musicien de cour était presque deux fois plus élevé que le mien pour simplement jouer d’un instrument! Il y avait beaucoup de postes à pourvoir : par exemple, il y avait un Cantor Catholique et un Cantor Luthérien. Tous voulaient que je vienne à Dresde.
Mais qu’aurais-je pu faire à Dresde au milieu de tous ces faiseurs de chansonnettes ? De l’opéra, de la musique imposée par le Prince ? Je pensai à ce que Fridélène m’avait dit : que je voulais toujours être ailleurs. Finalement rester à Leipzig ou j’étais le Directeur de toutes les musiques et chercher à y améliorer la situation de la musique en ayant des relations privilégiées avec la cour de Dresde, n’était-ce pas la meilleure solution ?
J’avais toujours en tête cette histoire de salaire pour l’Université payée à moitié de ce qui m’était dû. J’avais rédigé avant de partir une lettre destinée au Roi lui-même pour qu’il règle cette affaire. Je comptais la remettre au château. Au moment où j’arrivai, je vis descendre quelqu’un que j’avais vu lors d’un de mes précédents voyages à Dresde : c’était le comte Fleming. Nos regards se croisèrent mais il ne me reconnut pas. Un instant, il jeta un regard sur moi. Je n’osai lui parler. Une autre fois peut-être…
Le soir nous jouions avec les autres musiciens de bien jolies musiques. Je découvris d’excellentes choses, chez Zelenka par exemple. Il faisait parfois preuve d’une grande tendresse. Cela me comblait le cœur… mais pas complètement. Pourquoi ? Je ne comprenais pas et cela me mettait dans un état de grande songerie.
La période de Noël 1725 arrivait avec la douce magie qu’elle exerçait toujours sur moi.
Je commençais toutefois à me lasser de ce rythme trop exclusif des musiques composées ou reprises chaque semaine, sans compter les jours de fête. Pour moi, les élèves de l’école devenaient un fardeau. La discipline se relâchait. Ernesti vieillissait. Dans ces conditions en 1726 et début 1727, c’est de plus en plus rarement que je composais de nouveaux grands chœurs sauf à l’occasion de fêtes comme la Saint Michel ou quand je trouvais vraiment une piste nouvelle. J’en profitais alors pour donner à ces chœurs une ampleur telle qu’elle correspondait à des ébauches pour un nouveau grand projet : une Passion selon l’Évangile de Matthieu.
Désormais, seuls les élèves doués m’intéressaient vraiment : à ceux-là j’adorais enseigner et voir le plaisir qu’ils éprouvaient à progresser chaque jour. C’est pourquoi je faisais pour eux, pour mes fils, ma fille ou Anne des airs chantés à un ou deux : je pouvais m'y exprimer plus intimement. Nous les jouions à la maison et Anne était si heureuse ! Cela me permettait d’explorer de nouvelles musiques en particulier pour mon grand projet. Rien, pas mêmes les autorités, ne pourraient m’empêcher de proclamer la gloire de Dieu, par le langage le plus proche de Lui : la musique ! Ce que j’étais en train de concevoir, ce projet immense commençait à prendre forme. Je devais m’éloigner de mes tâches quotidiennes !
Cela me fut rendu plus facile grâce à la visite de mon cousin Jean-Louis.
Vous vous souvenez peut-être que je vous avais parlé du cousin Jacques et de sa mauvaise réputation dans la famille : on disait qu’il avait volé, avait voulu se marier trop jeune et avait été obligé de se faire soldat pour pouvoir survivre.
Je vous ai aussi parlé de ces fêtes entre membres de la famille Bach. Avec le temps et la famille grandissant, elles devenaient de plus en plus difficiles à organiser. Mais cela arrivait encore de temps à autre. Ce fut le cas cette année-là.
Au moment où nous commencions, comme le voulait la tradition, par la prière chantée tous en chœur, nous avons vu apparaître à cheval un homme d’une si grande beauté qu’on ne pouvait pas lui donner d’âge. Il avait fière allure et je me dis qu’il devait être quelque dignitaire de la Cour de Dresde. Mais je fus surpris de la tristesse sereine de son expression qui disparaissait dès qu’on le regardait. Comme je m’apprêtai à venir le saluer respectueusement, il sauta de son cheval fort élégamment et s’avança vers moi. Son beau visage triste s’illumina alors d’un sourire. Ce sourire, je pouvais le reconnaître entre mille : ce sourire à la fois interrogateur, dubitatif et profond, ce ne pouvait être que le sourire d’un Bach.
– Jean-Sébastien, me dit-il comme je suis heureux de te voir !
– Mais…
– Souviens-toi, la première fois que je t’ai vu, c’était en 1703, je me souviens de la date car c’est l’année où le Prince de Meiningen venait de m’accorder la fonction de Cantor. Tu parcourais la Thüringe à la recherche d’un emploi. Tu avais peut-être 17 ou 18 ans… Tu es passé à Meiningen. J’avais été sidéré par tes dons à l’orgue. Mais je me présente : je suis Jean-Louis, le fils de Jacques Bach…
Ce nom de Jacques m’avait toujours paru comme une honte pour la famille, bref c’étaient pour nous les cousins à ne pas fréquenter. Il fut néanmoins accueilli unanimement par la famille et participa à notre prière. J’avais pour l’occasion fait une musique sur le thème « Je suis content de moi » sur un poème de Menantes.
Suivirent des chansons et des « quodlibet » (improvisations collectives) dans lesquels, Jean-Louis fit preuve de telles qualités musicales, que cela se transforma en une sorte de duel amical entre lui et moi. Plus la journée avançait et plus ce duel se transformait en une connivence. Après la fête, il vint vers moi. Je ne pus m’empêcher de lui dire avec mon habituelle, maladroite et brutale franchise :
– Tu sais, cousin, ton père Jacques, n’avait pas très bonne réputation dans la famille.
– Oh je sais, il y a des médisants partout. Je vais te dire quelque chose mais… surtout ne te fâche pas.
Ainsi ma réputation d’avoir un caractère parfois difficile était connue partout, même à Meningen !
– Je te promets de rester calme.
– Eh bien, voilà, mon père comme tu le sais a volé quand il était à Eisenach: il n’avait plus aucune ressource !
– Mais cela se passait quand ?
– Environ quinze ans avant ta naissance…
– Mais à l’époque notre cousin « Panier percé » était déjà en poste à Eisenach, à l’orgue de l’Église Saint Georges. Il n’a pas cherché à l’aider ?
– Justement… non. Un geste de lui aurait suffi. Et pourtant mon père était un organiste remarquable…
Une vague de souvenirs déferla dans ma tête. Je ne sais pourquoi, mais je fis tout de suite confiance à Jean-Louis.
– Il était à l’école de latin où j’étais avec mon frère ?
– Oui, sûrement la même… Et il s’est fait renvoyer
– Et le cousin n’a rien fait ?
– …Non, je te le dis, rien…
Je restai songeur et tout à coup je compris pourquoi mon cher grand frère avait tant tenu à m’emmener avec mon frère à Ohrdruf et à m’éloigner de Eisenach. Ah si j’avais su !
Jean-Louis me dit :
– N’en parlons plus. Mon père a eu ensuite une fort belle carrière et il a fort bien éduqué ses enfants, comme tu peux le voir ! Mais… parlons plutôt de toi. Tu sembles faire une carrière magnifique, à Leipzig.
– Oui, à première vue cela semble vrai. Mais la vie est si chère. Les tracasseries de mes supérieurs sont insupportables, les gens s’intéressent de moins en moins à la musique d'Église…
– Comment, Jean-Sébastien, tu parles sérieusement ? On vient de partout pour te voir et suivre ton enseignement. Dans une ville immense comme Leipzig, tu dois avoir de bons revenus : les fêtes, les enterrements, les leçons, les ventes de partitions, les réceptions de princes… Et en plus tu fais une musique que tout le monde admire. Les personnalités les plus célèbres t’encensent. Tu sais, j’ai vu des partitions de toi qui circulent. C’est splendide.
– Allons… Allons… Et toi Jean-Louis, que fais-tu ?
– Oh moi, tu sais, je n’aime pas me plaindre, mais en ce moment j’ai quelques problèmes. J’ai été engagé comme je te l’ai dit en 1703 par le Prince Bernard de Meiningen. Bernard était fort bon avec moi. Mais il avait un petit problème : il croyait pouvoir s’enrichir en créant de l’or par magie ! ! ! Les conséquences pour les finances de son état étaient désastreuses ! J’étais engagé comme Cantor, et, tiens-toi bien, comme chef des pages. Je devais tout leur enseigner.
– Comme moi à Leipzig avec mes élèves !
– Sauf que toi tu n’es pas page en tenue et tu as donné à d’autres le soin de faire certains enseignements !
– Oui, c’est vrai, tu vois, je me plains encore.
– Mon père voyant que je ne pouvais pas vraiment me consacrer à la musique…
– Un peu comme moi ici, dis-je en souriant
– …m’a proposé pour remplacer Monsieur Dedekind à Eisenach…
– Quoi, Dedekind, celui qui était Cantor du temps de mon père ? Mais c’était donc à l’époque où mon frère Jean-Jacques travaillait comme musicien à la mairie avec Monsieur Halle, le successeur de papa ?
– Exactement !
– Mais c’est une coïncidence incroyable…
– Finalement, comme tu le sais, c’est notre cousin Jean-Bernard qui a eu le poste de Cantor (il était déjà sur place au palais du Prince comme Maître de Chapelle) et moi je suis resté à Meiningen. Le nouveau Prince de Meiningen, Ernest-Louis, le fils du Prince Bernard m’a nommé directeur de l’orchestre.
– C’est cet orchestre qui joue de ville en ville ? C’est la première fois qu’un orchestre voyage ainsi. Et l’idée est de toi ?
– Si l’on veut. Et toi qui es toujours inquiet pour tes revenus, réfléchis à une solution d’orchestre. Sais-tu que tu peux bien gagner ta vie avec ça.
– Mais j’ai ma musique d’Église, mes élèves.
– Tu ne vas pas écrire toute ta vie des musiques d’église. Quand tu en as deux ou trois prêtes pour chaque dimanche…
Jean-Louis parlait d’or, il disait tout haut ce que je pensais encore tout bas et que j’avais avoué un soir à Anne. Il m’ouvrait des horizons nouveaux.
– À propos, monsieur le directeur de la Musique à Leipzig, j’ai écrit des cantates que je voudrais te montrer.
– Tu les as apportées ici ?
Il alla jusqu’à son cheval et ramena un cahier.
– En voilà 18.
Je les parcourus en tournant chaque page avec attention.
– Mais ce que tu fais là est merveilleux. L’idée de mettre un grand chœur en avant dernier et un choral après. Je vois que tu prends à chaque fois des textes de la Bible tirés de l’Ancien et du Nouveau Testament. Je vois aussi que quand tu fais parler le Christ, tu mets toujours des cordes à l’Orchestre. Et puis… bravo pour l’utilisation du hautbois et surtout de l’orgue… Il faudra que j’y réfléchisse. D’ailleurs…
– Mais, Jean-Sébastien, …comment as-tu pu voir tout cela en feuilletant simplement ? C’est absolument incroyable !
– Oh, l’habitude, tu sais. Tiens, si tu veux bien, nous allons chanter cet air là, le n°5 de cette cantate n°4. Tu te mets au clavecin et moi je chante.
Je réunis la famille encore présente et, à la surprise de mon cousin, après l’avoir relu une nouvelle fois, je chantai par cœur la partition qu’il venait de me montrer. Tout le monde nous applaudit. Après cet intermède, je le pris par le bras et l’emmenai un peu à l’écart.
– Dis-moi, Jean-Louis, les textes de tes musiques, comment les choisis-tu ?
– C’est le prince qui les écrivait… Il avait même eu l’idée de faire des textes assez généraux pour qu’ils puissent convenir à n’importe quel dimanche !
Décidément Jean-Louis me surprenait. Jamais, à l’époque, je n’aurais imaginé cela. Et pourtant, plus tard, je repris certaines de ses idées. Il se mit à me dévisager comme s’il ne me connaissait pas, j’en fus surpris et gêné, puis tout à coup il me dit :
– Tu sais que tu as un visage, et un regard surtout, qui n’est pas banal du tout. J’aimerais faire ton portrait…
– Ah, parce que tu es peintre aussi ? Et sans doute, homme de loi, avocat, enseignant l’hébreux, le grec et le latin, et poète, jongleur et saltimbanque par dessus le marché, comme tous mes confrères.
J’étais hors de moi. La musique était pour moi un métier si sacré, si plein, si proche de Dieu et de toutes ses créations que je ne comprenais pas qu’un musicien fasse autre chose que de la musique.
– Moi je n’ai de temps que pour la musique, pour la créer, la jouer et l’enseigner aux autres et d’ailleurs…
Jean-Louis m’interrompit d’un air de dire : calme-toi, voyons.
– Mais, la peinture est une autre forme d’art, comme la musique. Tout comme l’architecture que pratique le père de ma femme. Tous ces arts ont pour seul but d’exprimer la beauté et sois sûr, Jean-Sébastien, que c’est là tout mon souhait : exprimer la beauté. Et toi, par ta musique, tu le fais mieux que personne.
Je me jetai dans ses bras, j’avais les larmes aux yeux. Je me confiai à lui, comme un enfant à son père :
– Pardonne-moi, cousin, mais il y a tant de mal autour de nous, de gens qui ne cherchent pas Dieu et sa beauté mais uniquement les richesses de ce monde. Je croyais que tu étais l’un d’entre eux. Je vais te faire une confidence : il m’arrive de considérer mes partitions comme des dessins. Je soigne le tracé des courbes et des notes pour que l’ensemble ait une belle apparence. Je fais des pleins et des déliés qui soulignent ce que je ressens.
Jean-Louis sourit.
– Jean-Sébastien, écoute-moi. Mon prince, Ernest-Louis de Meiningen, est mort l’année dernière. J’ai composé une cantate pour sa mort sur des paroles qu’il avait écrites lui-même. Depuis je ne suis plus payé. Je vis d’expédients. Mais finalement, je n’en suis pas mécontent. Cela me donne une nouvelle jeunesse.
– Comment ? Mais… Mais tu… tu as des enfants ?
– Oui, cinq : l’aîné a 12 ans et la petite dernière 4 ans. Et j’ai une femme aussi !… qui est fille d’un architecte. Tu comprends pourquoi je n’ai pas pu venir avec tout ce petit monde !
– Mais… mais…
Devant mon air affolé, il poursuivit en disant :
– Mais ne t’inquiète donc pas pour moi. Papa nous a appris qu’on pouvait toujours s’en sortir et il l’a prouvé ! D’ailleurs, je ne comprends pas ton inquiétude : tu sais bien qu’avec tes dons et ta réputation, tu as tort de t’inquiéter…
En entendant ces mots de Jean-Louis, je bénis Dieu de m’avoir accordé mon poste à Leipzig, malgré tous mes problèmes. Si j’étais resté à Cöthen mon poste aurait pu être supprimé et alors…
Pourquoi donc avais-je si peur ? À cause de ma nombreuse famille ? Non, cette peur de manquer était plus profonde en moi. Je ne pouvais y résister. Peut-être était-elle due au fait que mon père était mort et que j’avais vu alors ma famille sans ressources. Mais au fonds de moi-même, je savais que Jean-Louis avait raison. C’était une grande âme : il me parlait de moi alors que c’était lui qui avait des problèmes.
Je me pris d’admiration pour le courage de Jean-Louis :
– Écoute, Jean-Louis. Je vais te demander une faveur : puis-je copier ces belles partitions. Tu comprends pourquoi ?
– Je crois que oui.
– Je pourrai les jouer ici, ce qui ne peut être que bon pour toi.
– Mais bien sûr, ce serait merveilleux !
Mon cousin était venu juste au bon moment, il m’avait ouvert les yeux sur tout ce que je ressentais confusément. Le temps que je passais à composer chaque semaine une musique d’église me semblait prendre sur les autres travaux qui m’attendaient. En jouant les musiques de mon cousin le dimanche à l’église, je lui rendais service et cela me permettait de m’en imprégner pour en tirer des idées pour mon grand projet.
Ainsi en 1726, je jouai 18 dimanches les 18 musiques de mon cousin et le vendredi Saint, je dirigeai une Passion selon Marc de Reinhardt Keiser, oui le Keiser que j’avais rencontré un certain soir avec mon cousin, à Hambourg où il dirigeait un opéra. J’y apportai certaines modifications. Comme tout cette période de Hambourg était loin dans mon esprit ! Ainsi, de février à l’été, pendant près de 6 mois, je ne dirigeai aucune œuvre de moi dans les églises de Leipzig ! L’année suivante je serais peut-être prêt pour mon grand projet de Passion selon Saint Matthieu !
J’avais en tête tant d’autres idées !
Guillaume faisait de surprenants progrès à l’orgue. Il était sans cesse avide de découvrir de nouvelles œuvres. C’est peut-être une des raisons pour lesquelles, durant cette période, je fus saisi d’une furieuse envie de retourner plus souvent à mes chères orgues. Je me mis à écrire des musiques d’église dans lesquelles les orgues prenaient une part importante, aussi bien dans les chœurs que dans les airs. Je l’avais fait en partie pour que Guillaume puisse montrer ses capacités à tenir un orgue.
Et, de plus en plus souvent, j’allai à l’Église Saint Paul, accompagné de mes fils et de 3 ou 4 étudiants qui voulaient m’entendre et à qui je demandais d’actionner les soufflets, et restai de longues heures à jouer combinant les jeux, touchant les claviers et le pédalier de cet instrument que j’aimais tant. J’avais alors une prédilection pour les pièces en forme de trio: j’en repris et adaptai certaines anciennes, j’en ajoutai de nouvelles. C'étaient des œuvres non religieuses, légères et dans l'humeur du temps !
Je submergeais mon esprit de lignes mélodiques entrelacées, plus épurées et plus joyeuses que celles de l’Orgelbüchlein.
Je voulais que mon fils me surpasse dans cet art de l’orgue comme dans toute la musique. Il était plus doué que moi, il ne lui restait qu’à travailler autant.
Quand je jouais ainsi, je ne pensais plus à des musiques construites sur des textes religieux avec leurs mystérieux symboles et leurs correspondances mathématiques qui s’inspiraient de ma religion, transmise par mes parents. Parfois je pensais que cette religion n’étaient peut-être qu’un moyen que Dieu avait trouvé pour nous donner une croyance commune et une volonté de vivre ensemble.
La musique dépourvue de symboles est peut-être ce qui nous permet le mieux d’approcher notre créateur… et de mieux transmettre mes connaissances. Cette interruption dans la composition de la musique d’église me permit de réaliser un autre projet : une série de partitas pour clavecin.
J’aimais me promener dans les rues de Leipzig avec mes enfants, particulièrement pendant les périodes de foire : il y a alors tant de choses à voir et à apprendre ! Déjà à cette époque Leipzig était une ville de livres et d’imprimerie. Ce jour-là, je me promenais avec Emmanuel et Bernard: je tombai en arrêt devant une boutique de livres avec un ours comme enseigne. Je la connaissais bien, c’était celle de Monsieur Breitkopf. Je ne sais pourquoi, mais je ne peux pas passer devant une de ces boutiques sans y entrer. Mon fils Emmanuel est comme moi. Au fonds du magasin, il y avait une étagère avec de la musique :
– Regarde papa, ce qui est écrit sur cette partition, dit Emmanuel : Telemann ! Des œuvres de mon parrain, imprimées et puis de Keiser aussi… et ton ami Mathesson ! Mais, papa, il n’y a rien de toi !
– Pour une bonne raison mon fils, c’est que, à part une musique du temps de Mühlhausen et récemment une musique de mariage, je n’ai jamais eu d’œuvres imprimées.
Bernard, 11 ans, nous écoutait, il s’écria :
– Mais pourquoi, papa ? Alors c’est pour ça que tu nous fait toujours tout recopier !
– Toi, Bernard, tu n’es pas le premier à la tâche !
– C’est toujours la même chose dans cette famille, on me critique tout le temps, je suis considéré comme un incapable, mais vous verrez plus tard !
– Bernard, ce n’est pas le moment ni le lieu pour parler de ces choses !
– Avec vous, ce n’est jamais le mom…
Ma main partit. L’enfant reçut une taloche qui le fit fondre en larmes… Puis il releva la tête l’air plein de haine :
– Tout le monde me hait, personne ne m’aime !
Et il s’enfuit dans la rue. Je courus pour le rattraper. Je ne le voyais plus. Je regardai autour de moi. Il s’était caché derrière une porte. Il bondit sur moi en éclatant de rire. Je me mis à courir après lui. Tout le monde nous regardait. Certains me reconnurent et paraissaient éberlués. Je le rattrapai et le serrai dans mes bras : comme il était attendrissant, ce petit homme avec ses colères et son caractère difficile ! Comme nous revenions vers la librairie pour retrouver Emmanuel, nous avons vu de dos un jeune homme qui s’amusait à marcher à cloche pied et tenait des documents sous le bras. Au fur et à mesure que nous nous approchions de lui, nous pouvions entendre qu’il chantait à tue tête, à la surprise des passants qui se retournaient sur lui. Bernard et moi l’avions reconnu : c’était Guillaume.
Nous l’avons alors dépassé sans qu’il nous voie et sur un signe, nous sommes retournés d’un coup. Il était tellement absorbé qu’il mit une fraction de seconde à nous reconnaître.
– Mais… qu’est-ce que vous faites là ?
– Mais… et toi ?
– Je viens de l’église Saint Paul où, avec quelques amis étudiants qui m’ont aidé, je me suis entraîné à jouer ta musique de dimanche prochain.
– Mais où as-tu trouvé la musique ?
– J’ai recopié la partie d’orgue cette nuit.
– Tu vois papa, copier toujours copier…
– Allons retrouver Emmanuel chez Breitkopf.
– Ça, c’est une bonne idée ! Il y fera plus chaud que chez nous, avec ce poêle qui ne marche plus. À propos, papa, sais-tu quand ils vont venir remplacer le poêle ?
– Allons, tu exagères, il marche encore…
– Tu vas voir, ils viendront au printemps, quand il fera chaud !
Tout le monde sourit de la plaisanterie du petit Bernard.
En entrant, j’aperçus Breitkopf et lui fit un signe.
– Bonjour Monsieur Breitkopf. Vous voyez, la famille Bach se réunit chez vous ! Vous connaissez mes trois fils aînés ?
– Oui, bien sûr, mais je crois que c’est la première fois que je vous vois tous les quatre ici, vous me faites un grand ho…
– Serait-il possible d’en profiter pour leur montrer vos ateliers ?
Les machines m’ont toujours subjugué : qu’il s’agisse d’orgues, de clavecin, de luth, de clavicorde ou de machines à imprimer, je suis pris d’une irrésistible envie de comprendre comment ça marche. Je demandai à Breitkopf :
– Mais pourquoi ne faites vous pas une machine pour imprimer la musique ?
– Monsieur Bach, cela reviendrait beaucoup trop cher : d’abord, il faut graver des plaques, c’est très long et très coûteux et puis pour imprimer, il faut des centaines d’exemplaires, pour récupérer les frais !
– Mais pourquoi ne pas faire des caractères mobiles pour les notes, comme vous le faites pour les lettres ?
Breitkopf me regarda d’un œil incrédule et en hochant légèrement la tête, l’air de dire : « Ah ces artistes, on se demande parfois ce qui leur passe par la tête ». Il ne croyait pas aussi bien dire…
– Mais papa, dit Emmanuel, tu es connu, ce serait facile pour toi d’en vendre des centaines de tes œuvres.
– Tu sais que ton parrain, qui sait tout faire, grave lui-même ses plaques pour l’impression ?
– Mais… il y a toute une technique, dit Monsieur Breitkopf. Un amateur ne p…
– Tiens, vous avez un livre splendide, ici.
– Oui, c’est le premier livre que j’ai édité, il y a 6 ans maintenant : une bible de Luther !
– Quelle belle édition !
Je regardai fixement M. Breitkopf. Monsieur Breitkopf me regarda, eut un petit toussotement, puis me dit :
– Eh bien Monsieur Bach, pour fêter votre visite, je vais vous faire découvrir un livre paru récemment à Vienne et qui fait fureur, c’est un livre de Monsieur Fux, le titre est plutôt curieux…
– Oui, c’est Gradus ad Parnassum, mais je voulais tant l’avoir. Ah ! c’est merveilleux… Combien est ce que je vous dois ?
– Comment, mais monsieur Bach, vous êtes au courant de tout ! Ce livre est sorti il y a quelques mois seulement. Tenez, je vous le laisse pour… 6 thalers.
– Monsieur Breitkopf…
– 5 Thalers, monsieur le Cantor.
– Monsieur Breitkopf…
– Mais il est relié, monsieur le Directeur.
– Monsieur Breitkopf…
– 4 Thalers et 20 groschen
– Retirez 8 groschen et je vous le prends.
Les enfants me regardaient en riant sous cape…
Comme nous allions sortir de la boutique, nous nous sommes heurté à un homme qui, plongé dans sa lecture, nous barrait le passage. Il leva la tête, l’air d’être complètement ailleurs : c’était Picander.
– Monsieur Picander, comment allez-vous ? Nous ne nous sommes pas revus depuis la Saint Michel quand j’ai dirigé une musique sur vos textes.
– Maître, c’était merveilleux !
– Vos paroles ont très bien sonné avec ma musique : le furieux serpent, cet horrible dragon.
Vous avez entendu le sifflement du serpent dans ma musique ?
On entendit une petite voix
– Ah oui, le jour de la Saint Michel ? Moi, j’ai adoré, on avait l’impression que toute l’église allait exploser ! Boum !
– Bernard… tu exagères.
– À propos, Henrici… Picander, dites-moi, je voudrais vous parler de quelque chose…
Je vis alors que mes trois fils faisaient discrètement un mouvement de retraite vers la sortie de la boutique en croyant que je ne les voyais pas. Ils savaient que, quand je commençais à discuter avec Henrici Picander, je pouvais en avoir pour des heures. Je leur criai :
– Attendez-moi dehors, j’arrive… Deux mots, cher ami, avez-vous pensé à notre projet de musique pour la Passion du Vendredi Saint? J’ai déjà de nombreuses idées !
– Mais j’y pense sans cesse. Nous allons faire encore plus grand que Telemann ou Haendel avec le texte de Brockes.
– Oui
– Il faut que comme dans votre Passion selon saint Jean, on retrouve le texte exact de l’Évangile. D’ailleurs ces messieurs du consistoire l’exigent.
– Oui
– …Mais il faut que les textes des airs des récits et des chorals enserrent ce texte d’un écrin merveilleux et aux couleurs harmonieuses. Qu’à la révolte de votre première Passion selon Jean succède la Paix selon Mathieu. Que les fidèles…
– Comme vous maniez les mots, cher ami. Et encore vous oubliez la Passion que j'ai composée à Weimar… Moi, je préfère dire tout cela en musique. Nous avons du travail, beaucoup de travail… Je voudrais vous voir chaque Jeudi après-midi chez moi…
– Mais Maître, vous savez bien que jeudi, je dois aller à la mairie…
– Pour votre poste aux douanes ? Mais vous n’êtes pas encore nommé !…
– C’est que le maréchal von Fleming m’a promis…
– S’il vous dit quelque chose, nous irons le voir ensemble.
– Le Maréchal de Fleming, mais c’est un homme important : il est frère du ministre de sa majesté et dirige toute la garnison de la ville.
– Ne vous inquiétez pas pour Fleming, vous dis-je… Et bien, c’est d’accord, à Jeudi… Veuillez m’excuser, je vais rejoindre mes fils…
Je laissai Picander éberlué de la désinvolture avec laquelle je parlais de Fleming. Depuis des années il faisait des travaux d’approche auprès de von Fleming pour avoir un poste aux douanes…
– Papa, tu es fâché avec Picander ? dit Guillaume au moment où je sortais du magasin.
– Pourquoi ?
– D’habitude, tu restes des heures avec lui…
– …
– Papa, dit Emmanuel, le Sérieux de la petite bande. J’ai eu une idée en t’attendant : pourquoi ne pas éditer et vendre nous-même tes œuvres ? Il y a toujours quelqu’un à la maison ! Et beaucoup d’amis passent, viennent du monde entier pour te voir, te parler, t’écouter et puis repartent. Au début, nous n’en tirerons que quelques dizaines.
– Je n’y avais pas pensé.
– Mais cela me paraît une excellente idée, dit Guillaume le Fantasque… Et pourquoi ne pas commencer par cette partita que tu viens de terminer avec des danses : Sarabande, Allemande, Menuet et cette Gigue très gaie que j’aime tant et que tu as récemment terminée. Tu sais, je me suis exercé à la jouer au clavecin. Je suis sûr qu’elle remporterait un franc succès dans toute notre famille et auprès de tes élèves et de tes amis.
– Ah oui, tu croisais sur le clavier les mains comme ça, dit Bernard le Pitre qui se mit à faire des gestes de jongleur de foire tout en chantant la gigue avec une parfaite justesse et en esquissant un pas de danse. Les passants le regardaient en souriant.
– Arrête de faire le pitre, Bernard. Mes fils, je vais vous dire un secret…
Nous remontions le passage qui mène de la Grand Place à l’école, quand nous avons vu arriver deux jeunes femmes portant chacune un enfant dans les bras. Avec le contre-jour, je ne les reconnus pas tout de suite : c’était Anne et ma fille aînée, on aurait dit qu’elles avaient presque le même âge. Anne portait notre pauvre petit Henri qui avait du mal à marcher. Ma fille Catherine portait Elizabeth que nous avions surnommée Liesgen, notre dernier bébé qui devait avoir cinq ou six mois… Catherine, qui ressemblait tant à sa mère… Dieu avait-il voulu cette ressemblance afin que la disparue soit toujours présente à mon esprit ?
Anne souriante comme toujours dit :
– J’avais fini de copier l’air que tu m’avais demandé de mettre dans notre cahier, nous sommes sortis pour voir si l’un de vous, messieurs, arrivait. Et justement, vous voilà tous les quatre.
– Eh bien, toute la mille est là : attendez que je compte, 1, 2… 6, mais non. Où est donc le petit Christian ? Et tante Fridelène ?
– Ils ont préféré rester à la maison.
Comme nous remontions vers l’École, je pris Emmanuel à part et lui dit en chuchotant :
– Après tout, je vais te dire le secret à toi seul, mais tu ne le diras à personne : je sais que toi, tu peux garder un secret. Voilà, c’est une surprise pour l’anniversaire d’Anne. En réalité je voudrais que cette première partita soit le début d’une série que j’ai l’intention d’écrire pour « la délectation de l’âme des amateurs », c’est la formule que j’écrirai sur la page de titre. Et en mémoire de mon cher prédécesseur Kuhnau, je l’appellerai « Études de Clavier ». Je veux montrer la page de titre et l’annoncer le jour de l’anniversaire d’Anne.
– Mais alors tu pourras faire imprimer toute cette série ?
– Mais oui, l’idée me paraît excellente.
Et c’est ainsi que, tout comme Telemann, et d’autres musiciens de Hambourg, je me décidai à me lancer dans l’édition d’une de mes œuvres, en l’occurrence cette partita. Et, à la grande fierté de mes enfants et de ma femme, le 1° Novembre 1726 parut dans le journal « Les Nouvelles de Leipzig » l’avis suivant :
"Nous faisons part, de l’intention du très Honorable Maître de Chapelle d’Anhalt Cöthen et Directeur des Chœurs et Musiques à Leipzig, monsieur Jean-Sébastien Bach, d’éditer des Suites pour Clavecin, et qu’il en a déjà fait le début avec une première partita, qu’ainsi, étape par étape, il a l’intention de continuer jusqu’à ce que l’œuvre soit terminée : cela sera ainsi porté à la connaissance de ceux qui aiment le Clavier. Il faut ajouter pour ceux que l’information intéresse, que l’auteur est le propre éditeur de cette œuvre".
Les enfants étaient enchantés de voir le nom de leur père dans le Journal.
Je décidai de dédier cette partita au tout jeune Prince Emmanuel Ludwig d’Anhalt-Cöthen qui venait de naître : son père était mon cher Prince Léopold (dont c’était le premier enfant mâle) et sa mère était la princesse Charlotte, sa seconde femme.
Cette année là, je ne fis pas de grandes œuvres pour Noël ni pour la fête des rois mages que j’avais pourtant mis en musique chaque année depuis que j’étais à Leipzig. J’étais si absorbé dans mon grand projet de Passion ! Plus qu’au moment de ma Passion selon saint Jean, j’avais alors trouvé une certaine sérénité et mon esprit était complètement accaparé, concentré, tendu sur l’histoire de Jésus et de sa Passion. J’écoutais chaque scène, j’entendais les sentiments de chacun.
Je voulais que ma musique commence par une entrée grandiose, encore plus grandiose que tout ce que j’avais entendu jusque là. Je me souvins du double chœur que j’avais voulu faire pour une Passion deux ans auparavant et que j’avais supprimée parce qu’on m’avait obligé au dernier moment à la jouer à Saint Nicolas. Je décidai d’aller au delà. Le jeudi suivant notre visite chez Breitkopf, j’accueillis Henrici. J’étais dans un grand état d’excitation :
– Cher ami, j’ai en tête de commencer notre passion par un triple chœur
… Trois groupes de personnes…
– Qui ?
– D’abord le chœur des voix célestes, qui dans une lente marche, pleure le martyr de Jésus. Ensuite le chœur de la foule inquiète (c’est à dire nous, vous et moi, nous tous qui vivons dans ce bas monde). Le troisième groupe chante un choral, le choral de l’Agneau (c’est-à-dire Jésus). Chaque groupe joue un rôle symbolique. Le premier groupe avance…
– Comment ?
– …en exprimant sa tristesse devant…
– Quoi ?
– L’Agneau sacrifié, symbole de Jésus mourant : c’est le choral. J’entends tous ces groupes qui marchent en procession et avancent.
– Où, mais où ?
– …Henrici, savez-vous que vous êtes extraordinaire ? Grâce à vous, je viens de trouver les paroles du deuxième chœur.
– Mais comment est-ce possible ? C’est la première fois que nous en parlons.
– Justement, je cherchais comment exprimer l’inquiétude de la foule des fidèles que nous sommes. Eh bien, comme vous à l’instant, ils diront, mais en chantant : Qui ? Comment ? Quoi ? Mais où ?
– Ah maître, vous… vous… mais… moi aussi j’ai une idée : et si nous prenions pour le thème du groupe céleste les Filles de Sion, symbole des voix célestes, cher à Brockes ?
– Excellente idée Pican…, Monsieur Henrici : voilà l’ébauche de notre chœur d’entrée. Il ne vous reste qu’à trouver des paroles.
– Mais maître, j’ai déjà écrit des textes pour la Passion…
– Il faut prendre le meilleur de ce que vous avez fait. Pour le reste, nous travaillerons ensemble.
À ce moment entra Guillaume :
– Mon fils, nous avons commencé à travailler avec Monsieur Henrici. Nous allons faire une passion imposante.
– Mais tout de même pas aussi importante que la passion de Brockes mise en musique par Telemann ?
– Si, elle sera beaucoup plus importante ! À propos, Henrici, vous connaissez Müller ?
– …Nnnnon
– Heinrich Müller.
– …Nnnnon
– C’est un pasteur qui a écrit des sermons merveilleux, sur la Passion.
– J’ai parcouru cela l’autre jour en passant chez Breitkopf. Oui, il me faut ce livre. Tenez, voici 4 thalers, allez prendre l’air, les jeunes ! (il y avait 10 ans d’écart entre eux). Et revenez vite ! Et en descendant dites qu’on ne me dérange pas, dis-je avec un petit signe à Guillaume qui disparut avec Henrici.
En fait j’avais besoin d’être seul : j’entendais ce chœur d’entrée. J’avais devant moi une heure environ. Et alors, la foule m’apparut en sons. Le chœur se construisit. Et je sus que j’avais créé quelque chose de grand. J’eus l’idée d’intégrer des doubles chœurs très brefs, chacun accompagné d’un orgue, car il y avait deux orgues, un à chaque bout de l’église.
Bien plus tard je retrouvai dans la Bible commentée par Carlov dont je m’étais procuré un exemplaire, un passage concernant les chants des hommes et des femmes durant l’Exode ch15, vers20 : « et de l’un et de l’autre chœur ont du s’élever un chant puissant et un bruit extraordinaire répercuté de l’un à l’autre chœur, puisque des centaines de milliers d’hommes se trouvaient rassemblés et chantaient ». Je mis en marge : « Premier Prologue à exécuter à la Gloire de Dieu ». J’avais créé quelque chose de grand et je pensai que la Bible est « le vrai fondement de toute musique d’Église ». Je n’ai jamais écrit rien d’autre sur la musique.
Pour le reste, je ne peux que me répéter : écoutez cette Passion !
Henrici et Guillaume étaient de retour.
– Voici le livre de Müller.
– Ami Henrici, je vous le prête et revenez avec de bonnes idées.
– Mais j’ai déjà écrit pour le comte Sporck…
– Oui, je sais vous avez déjà eu de bonnes idées dans d’autres écrits. Et je connais bien le comte, vous savez qu’il m’a demandé d’écrire une musique pour lui. Il aime tous les arts… Il a des théories troublantes sur Un Grand Architecte. Henrici, écoutez-moi bien : partout dans nos pays, il y a des églises mais il paraît qu’en France, il y a les plus belles cathédrales du monde. Partout on joue des musiques d'église : eh bien moi, je voudrais que notre Passion soit construite pour être la plus belle Passion du monde !
– Maître, je peux me flatter que peut-être le manque de grâce poétique de mes écrits sera racheté par le charme…incomparable de votre musique !
– Allons, ami, pas de grandes phrases entre nous.
Et il partit. Avec Henrici, nous avions trouvé une unité, une ambiance homogène pour décrire la tragédie de la mort de Notre Seigneur Jésus. Ainsi, avant presque tous les airs, je mis un commentaire qui expliquait l’évangile et l’air qui suivait. Henrici m’aida beaucoup pour donner à l’ensemble une structure pleine et pour me suggérer des symboles musicaux à inclure dans ces textes :
– Là, monsieur Bach, peut-être pourriez-vous mettre une forme de mélodie suggérant le symbole de la Croix
– Ici, Picander je vais symboliser par des chiffres les paroles de vos textes.
J’eus aussi l’idée de superposer airs et chœur, avec toujours cette idée du commentaire de la foule soulignant le texte que chante le soliste.
Les répétitions furent longues et difficiles (depuis quelque temps les élèves étaient de plus en plus distraits) mais le vendredi 11 avril 1727, on joua cette Passion à Saint Thomas. À la fin, plusieurs personnes restaient assises dans l'église, alors que d'habitude tout le monde sortait. Je fus surpris aussi de voir Gottsched venir me féliciter.
– Monsieur Bach me dit-il, l’Allemagne vous sera à jamais reconnaissante pour cette œuvre, l’Allemagne et peut-être le monde entier. Avec Telemann et Haendel, vous êtes, monsieur, l’une des trois grandes gloires musicales actuelles de notre Allemagne et votre renom s’étend en Italie et en France.
J'avais l'impression d'avoir déjà entendu cette phrase…
***
Mais il ne fallait pas perdre de temps, car 15 jours après, à l'occasion de la Foire de Pâques, la Ville accueillait le Prince Électeur et Roi de Pologne, le Très Puissant Auguste le Fort. Il vint lui-même du 3 au 18 mai. Le sommet des fêtes données en son honneur était le 12 mai 1727, jour de son anniversaire.
Ce Prince faisait régner la prospérité sur le Pays et il aimait tous les plaisirs et en particulier les fêtes. Qui s’en plaindrait ? Leipzig connaissait une richesse extraordinaire. Les Foires étaient toujours plus importantes. On y voyait des gens du monde entier. Les occasions de fêter la paix, notre joie et notre santé devaient être aussi nombreuses que possible.
Tout le monde savait qu’à Cöthen j'avais eu pour fonction de faire de la musique presque uniquement pour le plaisir et les fêtes de mon cher Prince Léopold.
J’avais ainsi à Leipzig une solide réputation d’organisateur de fêtes en musique. Mes "amis" organistes Görner et Gerlach proposaient souvent de faire des musiques pour ces fêtes. Mais il se trouve qu'étant directeur de la musique et peut-être aussi à cause de mes modestes talents, c'était moi qu'on choisissait le plus souvent.
Il fallait donc pour le 12 mai organiser une grande fête. Monsieur Haupt avait pour l'occasion rédigé un poème que j'étais chargé de mettre en musique. Le titre était « Éloignez-vous, sereines étoiles ».
Autrement dit : quand arrive le Souverain, symbole de la lumière, du jour, du soleil, à ce moment les étoiles et donc la nuit sont chassées.
Le soir du 12 mai, on avait justement attendu la tombée de la nuit, après 8 heures du soir. Alors commença le grand défilé à travers toute la ville.
D'abord, il y avait les Anciens qui marchaient fièrement et s'éclairaient avec des flambeaux.
Suivait l'auteur du texte, Monsieur Haupt, portant l'exemplaire destiné au Souverain : le livre reposait sur un coussin de velours d'argent avec des franges d'or. Deux autres personnes le suivaient présentant chacune des parties du poème.
Suivaient après d'autres personnages de l'Université.
Suivaient plus loin mes musiciens, les trompettes et les tambours, comme toujours dans ces fêtes, qui rythmaient le défilé.
Suivait enfin le reste de l'assistance avec des flambeaux qui illuminaient les rues.
Pour protéger le Souverain, des soldats formaient, tout au long du cortège, une barrière humaine.
Au total plus de 300 personnes défilèrent ainsi.
Puis tout ce monde arriva à l'immense jardin Monsieur Apel. Là, je dirigeai, dans le recueillement et le respect dû au puissant Auguste le Fort, ma musique de fête. J'avais avec moi plus de 40 musiciens, plus nombreux encore que pour ma Passion selon Matthieu !
Tout ce monde revint ensuite vers le Collège de Paul où eut lieu l'embrasement général sous les vivats de la foule.
À la fin de la cérémonie, j'étais en train de discuter avec mes musiciens quand j'entendis dans la foule une voix :
– Monsieur Bach, Monsieur Bach !
Je me retournai : c'était Joachim Frédéric Fleming, le Gouverneur militaire de la ville, que j'avais déjà rencontré souvent, homme jovial et toujours prêt à rire, sauf quand il était en uniforme devant ses soldats.
– Monsieur Bach, je tiens à vous féliciter de votre musique de ce soir, c'était fort beau… mais je vous avoue que je suis content que le séjour de notre Souverain se termine bientôt : la sécurité, comprenez-vous, la sécurité, et s'il arrivait quelque chose ?
– Mais, Monsieur le Gouverneur…
– Appelez-moi Général : n’oubliez pas que je serai toujours d’abord un militaire, général de cavalerie…
Je pensais que devant le Prince…
– Appelez moi Général, vous dis-je. Vous disiez ?
– Mon Général, que voulez-vous qu'il arrive, tout le monde est heureux ici.
– Un militaire doit toujours être sur ses gardes monsieur Bach, dit-il en éclatant de rire. À propos, mon jeune frère Jacob est là. Lui se fait appeler Comte, Ministre et accessoirement Maréchal : c’est toute la différence entre nous, moi j’aime d’abord qu’on m’appelle Général…
– Le comte Fleming ? Mais…
– Oui, c’est bien lui, et il m’envoie vers vous car il vient de suggérer au Prince Héritier et à son épouse de vous rencontrer. Comme vous le savez, ils sont ici. Lui adore la chasse et tous deux adorent les Arts.
– Mais… mais, jamais je n'oserai… Moi, avec mes si modestes talents ?
– Allons, allons Bach, ne faites pas le timide. Depuis le temps : vous avez fréquenté assez de Princes pour savoir leur parler. Venez, suivez-moi…
Parmi tous ces grands personnages au milieu desquels j'avançais en suivant le Général Fleming, je vis un homme que j'avais connu autrefois chez le Prince Christian de Weissenfels, prince pour qui j'avais composé ma première musique de la Chasse. Cet homme était alors jeune page : il s’appelait Bruhl. Depuis, il était devenu un des plus hauts personnages de l'État, après le comte Fleming. Au passage je lui fis un sourire mais il fit semblant de ne pas me reconnaître.
Nous arrivions enfin vers le Prince Héritier qui était accompagné de son épouse, la Princesse Marie-Josèphe, fille de l'empereur d'Autriche. Le Prince Héritier devait avoir alors une trentaine d'années. Il avait le visage épais. La Princesse n'était pas très belle ; elle avait l'air d'une petite fille un peu triste d'être devenue femme.
Le Général Fleming s’approcha de son frère Ministre et lui dit à l’oreille :
– Tu vois, petit frère, je l’ai trouvé, notre Bach.
Il ne laissa pas le temps au comte de réagir et se tournant vers le Prince, il annonça triomphalement :
– Prince je vous présente notre Champion ! Monsieur Jean-Sébastien Bach, Maître de Chapelle du Prince de… de…
– Cöthen, lui soufflai-je
– De Cöthen, Directeur des Musiques de Leipzig et Cantor de l’Église de Saint Thomas
– Ah oui, dit le Prince, c'est lui qui, en présence de mon père, a vaincu ce français dans une bataille… en musique dont on a beaucoup parlé.
– Racontez-moi, dit la Princesse.
Je vis alors Bruhl se rapprocher de moi et me saluer ostensiblement comme s'il venait de m'apercevoir.
Le Général s'empressa de prendre la parole avant son frère. Il toussota, bomba légèrement le torse, prit une pause comme s’il commençait un grand récit :
– Eh bien, voilà, euh… cela se passait chez mon frère à Dresde, il y a bien… euh.
– Exactement 15 ans, dit son frère le Comte
– Il se trouve que Monsieur Bach, qui était à l'époque en poste à Hambourg…
– Non à Weimar, dit son frère le Comte.
– Bon, soit, à Weimar, Monsieur Bach était donc venu à Dresde. Il y avait là un Italien…
Nous avons alors entendu un bruissement de pas empressés, puis une voix tonitruante, sûre d’elle-même et dominatrice :
– Mais non, Monsieur le Général Gouverneur Fleming, ce n’était pas un Italien, c'était un Français, je me souviens fort bien de son nom : il s'appelait Marchand. J'aime bien ce nom de Marchand car il est pour moi, surtout ici, dans cette bonne ville de Leipzig, le symbole même de notre prospérité…
Tout le monde s'était tu : Auguste le Fort, Prince Électeur et Roi de Pologne, notre suprême Souverain s'était approché et avait parlé. Il était suivi de ministres et de dignitaires parmi lesquels je reconnus des membres du Conseil et du Consistoire de Leipzig. Près de lui se tenait une femme qui devait être une de ses maîtresses.
Après un temps d’arrêt, il continua en disant :
– Ce Marchand et Bach devaient rivaliser de virtuosité au clavecin. Figurez-vous que le français s'est enfui de Dresde au dernier moment ! Alors Bach nous a fait une si belle démonstration que tout le monde en était étonné et charmé. Je lui ai fait porter une bourse pleine d'or mais un de mes gredins de laquais s'est enfui avec elle, la trouvant sans doute fort bien garnie. Si on l'avait rattrapé celui-là, je l'aurais fait étriper, massacrer…
Je n'osai contredire le Souverain : son récit ne correspondait pas tout à fait à mon souvenir.
Puis il se tourna vers moi :
– Bach, dites-moi, au lieu de nous ennuyer en protestations sur vos problèmes de salaire, vous devriez nous faire un opéra. Vous seriez bien payé. Votre musique de ce soir, agrémentée de quelques airs plus légers et plus lestes, comme ceux de Hasse, ferait merveille… Pour moi, la musique c'est l'opéra.
– Sire, je ne suis qu'un musicien et pour moi, la musique, c'est la musique.
Un silence total et glacé gela tout à coup l'assistance. Le Souverain me regarda, surpris qu'on lui tienne tête.
Le Général Fleming toussota à nouveau et crut bon de dire :
– Sire, il a fait une très belle musique pour mon anniversaire !
– Je vous parle d'opéra et pas d'anniversaire, dit le Roi brutalement.
Silence à nouveau
Après un bref instant, le roi parla :
– Eh bien faites vos musiques, monsieur Bach, faites vos musiques. Elles conviendront sûrement mieux à ces deux tourtereaux qu'à moi, dit-il en désignant son fils le Prince Héritier et la jeune princesse.
Puis se tournant vers sa maîtresse :
– Nous, nous aimons autre chose, lui dit-il en souriant.
Elle se mit à glousser et ils nous tournèrent le dos, suivis du comte Fleming, de ses ministres et de ses dignitaires.
De ce souverain, on disait qu'il était impossible de compter le nombre de ses maîtresses et qu'il avait plus de 300 enfants…
Je restai donc là avec le Général Fleming, le Prince et la Princesse et… Bruhl, qui s'était approché dès qu’il avait vu le roi me parler, quand apparut un jeune homme fort bien mis qui se présenta en s’inclinant respectueusement devant le Prince Héritier :
– Prince, mon nom est Jean-Charles de Kirchbach. Prince, vous savez quelle vénération inspire madame votre mère parmi ses sujets de Saxe. Je suis un de ses admirateurs et voudrais vous demander de ses nouvelles.
– Relevez-vous monsieur. Eh bien…ma mère, actuellement, se sent un peu faible.
Nous avions pour la femme d’Auguste le Fort une sorte de vénération. Elle était luthérienne. Pour devenir roi de Pologne, son mari avait renoncé à notre religion, celle de Luther, et avait accepté de devenir catholique. Il avait demandé à sa femme de devenir catholique, comme lui. Elle avait osé refuser et tenir tête avec héroïsme au Souverain, préférant se retirer dans un château non loin de Leipzig. Ils ne se voyaient plus. Elle avait élevé son fils dans la pure tradition luthérienne. Malheureusement…
– Puis-je vous demander humblement de transmettre à madame votre Mère toute l'admiration du peuple de Leipzig.
– Je lui en ferai part, monsieur, soyez-en certain.
Je m'aperçus alors que s'étaient rassemblés autour de nous bon nombre de personnages de marque dont le silence et l'attitude respectueuse montraient combien ils approuvaient les paroles du jeune homme.
Quelques semaines plus tard, au début du mois de Septembre 1727, nous apprenions la triste nouvelle : notre Souveraine était retournée à Dieu.
Le deuil dura neuf mois, neuf mois durant lesquels aucune musique d’église ne fut jouée.
Sauf une cérémonie en l’honneur de notre Souveraine.
En effet quelques jours après l’annonce de sa disparition, Jean-Charles de Kirchbach vint me voir. Il me salua par ces mots :
– Monsieur, il y a deux hommes que je situe actuellement au sommet de leur art : pour la poésie c'est Gottshed et pour la musique, c'est vous, monsieur Bach. Je pense que pour notre Souveraine, nous avons avons le devoir sacré d’organiser une grande cérémonie : tout ce que Leipzig compte de Princes, de hautes personnalités, de nobles, d'étrangers, de chevaliers sera là pour célébrer cette femme sublime.
Tenez, voici le poème que Gottshed a écrit sur elle. Il sera imprimé par Monsieur Breitkopf et distribué à toute la foule. Je vous demande d'écrire sur ces paroles une musique digne d'elle et de nos sentiments à tous. Là-haut, près de notre Seigneur, elle entendra notre plainte, elle nous verra, figés près du royal tombeau, les yeux en pleurs, les lèvres gémissantes.
Ce jeune homme parlait avec une telle conviction que je ne pus que lui répondre :
– Et… et quand aura lieu la cérémonie ?
– Le 17 octobre, en l'église Saint Paul dans notre Université.
– Mais…
– Monsieur Bach, je me charge de tout et bien sûr vous serez défrayé de vos frais.
Moi aussi j’étais ému de la mort de cette Souveraine ! Je la connaissais depuis longtemps, depuis que je l'avais rencontrée à Carlsbad, l'année même où la mère de mes premiers enfants avait quitté ce monde.
Le texte de Gottsched me toucha profondément. Je me mis au travail et tout de suite les idées me vinrent en foule. Le rappel du temps qui fuit en évoquant les cloches funèbres de mon enfance. L'utilisation de sonorités d'instruments anciens. La plénitude d’une musique profonde adaptée au goût italien du moment…
Le jour de la cérémonie arriva. La procession me rappela dans son déroulement celle de l'anniversaire du Souverain. Mais ce jour-là, pour cette cérémonie à la mémoire de son épouse, Auguste le Fort n'était pas venu.
Les mêmes personnes défilèrent dans le même ordre, mais dans un silence dont les pierres elles-mêmes semblaient imprégnées. On entendait de loin l'orgue de l'église Saint Paul : mon ami Thiele en tirait des musiques merveilleusement tragiques. Dans l'église toute tendue de tissus noirs, on avait installé un catafalque sur lequel figurait un chronogramme de 1727, année de sa mort. C’est là que je dirigeai mon Ode Funèbre. J'eus la chance d'avoir pour interprètes de très nombreux étudiants attentifs et consciencieux.
Avec cette Ode Funèbre je voulais exprimer la profondeur de la peine éprouvée devant la mort d'une personne de haut rang. Je l’avais connue et j'admirais cette princesse avec ferveur. C’est pourquoi, quelques mois plus tard, lors des funérailles solenelles célébrant mon cher Prince de Cöthen, Léopold, mort à 34 ans, je repris certains éléments de cette Ode Funèbre ainsi que des extraits de Passion. J’allai à Cöthen avec Anne et Guillaume interpréter, chanter et diriger cette musique. Je repris aussi des parties de cette Ode Funèbre pour célébrer une autre mort, celle de notre divin Sauveur, dans ma Passion selon saint Marc.
La mort à nouveau venait rôder autour de moi.
La Souveraine nous avait quittés.
Mon bien aimé Prince Léopold de Cöthen était retourné à Dieu.
Ma sœur aînée mourut peu après à Erfurt : je restai le seul enfant vivant de mon père et de ma mère.
Quelques mois plus tard, j’eus l’immense douleur de perdre notre bien aimée Fridéléne, qui expira en souriant et en tendant les bras vers le Seigneur. Une petite Christiane née le premier janvier 1730, disparut trois jours après sa naissance.
Notre vieux Recteur de l'École, devenu à la fois un ami et un père pour nous tous, le cher Ernesti, rendit l’âme en octobre 1729, lui aussi dans la paix de Dieu.
Un office fut organisé pour célébrer la mémoire de celui qui avait si longtemps dirigé cette école et était devenu un ami (mais aussi dans mon esprit pour célébrer la mémoire de Fridélène et de tous ceux qui venaient de nous quitter). Lors de cette cérémonie, je dirigeai un motet pour deux chœurs à quatre voix.
Il se trouvait que pendant les quatre derniers mois de 1727, nous avions porté le deuil de notre Souveraine et qu’aucune musique n’avait été jouée à l’église. Ainsi je n’avais pas eu le souci des répétitions et des délais impératifs du dimanche ou des fêtes. J’avais ainsi pu travailler différents autres genres de musiques et en particulier certains motets.
Je mis un soin tout particulier à composer ou à parfaire ces motets. J’ai déjà dit l’importance que j’attachais à cette forme de musique. Mais je voudrais ajouter qu’en cette période de ma vie, je reprenais de plus en plus souvent certaines de mes œuvres. Dans ces motets, je voulais montrer tout ce que j’avais appris, depuis que j’étais enfant, depuis que mon cousin « Panier Percé » m’avait initié à la profondeur de ses compositions. Je voulais que ces motets soient les témoins de toutes mes connaissances, de toutes mes capacités, de tout mes talents. Chaque note, chaque suite de notes, chaque harmonie, la sonorité de chaque mot, avait une signification à la fois humaine et divine que moi seul connaissait. C’étaient autant de symboles, autant de clés de mon œuvre. Chacun pourrait prendre plaisir à découvrir quelques unes de ces clés : parfois ce seraient celles auxquelles j’avais pensé, parfois c’en seraient d’autres.
Il en est ainsi dans cette science mathématique à laquelle Guillaume, jeune élève à l’université, m’initiait : on y trouve des symétries imprévues, qui sont peut-être des clés qui nous sont montrées par Dieu pour nous faire découvrir les mystères de sa création.
Mais, dans ma musique, les symboles n’étaient pas l’essentiel.
L’essentiel était qu’avec ces motets j’abordais un monde ineffable.
J’éprouvais une joie sublime.
J’étais dans un état de totale harmonie.
Je souhaitais que ceux qui écouteraient ces motets partagent cette harmonie : c’était là le génie et la raison d’être de mon art. Était-ce aussi celle de mes collègues et amis musiciens ? Je n’osai leur en parler. Je craignais que le seul fait d’en parler ne vienne rompre cette harmonie.
Je célébrai par ces motets tous ces êtres chers qui nous avaient quitté et connaissaient désormais la félicité parfaite et éternelle. Moi, pauvre humain, je devais continuer à supporter ce monde.
Avec ces proches que j’aimais tant, disparaissait toute une époque de la vie
J’allais maintenant faire face à de nouveaux défis.